Fabien ROUX Master 2 Comptabilité Contrôle Audit Séminaires de Recherche Appliq
Fabien ROUX Master 2 Comptabilité Contrôle Audit Séminaires de Recherche Appliquée Guide du mémoire de recherche appliquée Année 2019 ‐ 2020 Ce document est réservé à un usage strictement personnel. Il a été rédigé par Benjamin Williams, Professeur, Université Clermont Auvergne, CRCGM et Benoît Raynaud, Maître de Conférences, Université Clermont Auvergne, CMH. Les auteurs ont autorisé l’utilisation de ce guide dans le cadre du Master CCA. LE GUIDE DU MEMOIRE Auteurs : Benjamin Williams Professeur, Université Clermont Auvergne, CRCGM Benoît Raynaud Maître de Conférences, Université Clermont Auvergne, CMH Version : septembre 2017 Ce document est réservé à un usage strictement personnel. Il est interdit de le distribuer sans l’autorisation expresse des auteurs. Illustration : adaptation d’un dessin US des années 40, libre de droit sur https://openclipart.org/ Williams, B. et Raynaud, B., Le guide du mémoire, 2017. Page 2 e petit guide du mémoire n’a pas vocation à dresser une liste exhaustive des choses à faire de A à Z. C’est plutôt un aide‐mémoire, sans mauvais jeu de mots, qui vous suivra tout au long de sa rédaction. Il présente tour à tour les éléments de fond et les éléments de forme, bien que les deux aillent de pair : « la forme, c'est le fond qui remonte à la surface », écrivait Victor Hugo (Les Contemplations, 1856) ; à moins que vous ne préfériez cette citation de Nicolas Boileau : « ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément » (L’art poétique, 1674). Avant‐propos : qu’est‐ce qu’un mémoire ? Le mémoire est un premier travail de recherche qui conclut cinq années d’études supérieures. Il pose une question clairement identifiée et énoncée avec minutie : la problématique. Sans elle, le mémoire se borne à un catalogue fastidieux qui perd tout intérêt scientifique. Pour répondre à la problématique, vous devez faire un état de l’art, c’est‐à‐dire une revue de la littérature académique. Votre travail synthétise l’existant (première contribution) et complète l’édifice par des apports critiques, méthodologiques, empiriques, etc. (seconde contribution).1 Le mémoire est aussi – et avant tout – un travail de communication écrite, et orale, quand vient le temps de la soutenance. N’oubliez pas que vous n’écrivez pas pour vous mais pour un lecteur. Votre pensée se doit donc d’être claire, concise et précise. Les mots ont un sens et la langue française compte finalement peu de synonymes. Le mémoire est un travail collectif : vous devez mettre vos réflexions en commun, écrire de concert et éviter que le mémoire ne soit un patchwork. Le mémoire est enfin l’apprentissage de l’autoformation : vous allez parcourir une documentation abondante, sérier les problèmes pour, finalement, produire votre propre vision des choses. Vous devrez répéter cet exercice maintes et maintes fois dans votre vie professionnelle. I– Les étapes de l’écriture du mémoire Étape n°1 : Choisir un sujet et ses partenaires de travail Une liste des sujets de mémoire vous a été distribuée : chacun comporte un titre et, le cas échéant, des éléments de bibliographie jugés incontournables par l’enseignant‐référent. Prenez le temps de lire attentivement le titre : chaque mot compte. En cas de doute, vérifiez dans un dictionnaire ou une encyclopédie de quoi il en retourne : allocation d’actifs n’est pas synonyme de gestion de portefeuille et le démembrement d’une obligation par le Trésor public ne consiste pas à démembrer la propriété de l’obligation en usufruit et nue‐propriété… Ces premières vérifications vous éviteront le cas échéant de perdre un temps précieux. Si le sujet vous intéresse, lisez les références bibliographiques qui vous donneront les grandes directions. Après discussion et concertation, faites votre choix et faites‐le nous savoir. 1 Voir : http://www.academie‐francaise.fr/second‐deuxieme C Williams, B. et Raynaud, B., Le guide du mémoire, 2017. Page 3 Concernant la formation des groupes, vous pouvez naturellement les composer par affinités personnelles. Certains font par ailleurs le choix d’un mémoire qui entre dans leur champ de compétence initiale, d’autres, au caractère plus aventurier, choisissent d’investir un champ distinct de leur formation d’origine. Ce choix est naturellement respectable, mais veillez néanmoins à ce qu’au moins un membre du groupe ait une formation initiale relevant du champ disciplinaire auquel le sujet appartient. Dans tous les cas de figure, une règle fondamentale est l’intérêt pour le sujet retenu dès lors qu’il va vous suivre tout au long de l’année universitaire. Étape n°2 : Faire la revue de la littérature Un mémoire universitaire ne peut pas être construit à partir de rien : il s'appuie nécessairement sur les travaux de recherche précédemment effectués sur des thèmes similaires. Autrement dit, les travaux existants constituent des matériaux à partir desquels le mémoire sera effectué. Avant de vous lancer dans le choix d’une problématique et la définition d’un plan, il faut donc dresser l’état de l’art des connaissances en la matière. Nombreux sont ceux qui ont déjà écrit sur le sujet : manuels, ouvrages collectifs, articles de recherche, etc. Vous ne devez pas partir de zéro et cette étape vous évitera aussi de « réinventer la roue ». Prenez soigneusement des notes, établissez des fiches de lecture car surligner ne suffit pas à faire une synthèse de ce que l’on a lu. Umberto Ecco racontait les méfaits de l’arrivée des premiers photocopieurs dans les universités américaines : les fiches bristol cédèrent le pas aux copies en noir et blanc stabilobossées2. Version moderne à éviter aussi : les fichiers au format PDF qui s’entassent sur le disque dur de son ordinateur et qu’on ne lit jamais ; au mieux sont‐ils survolés. Lisez du général au particulier : commencez par un manuel généraliste puis allez vers des écrits de plus en plus spécialisés. Les publications scientifiques dans les revues académiques parachèvent vos lectures et constituent un passage obligé pour un mémoire de Master. Rappel utile : les articles de presse et la webographie n’ont pas de valeur scientifique, tout au plus servent‐ils à illustrer votre propos. Il convient par ailleurs de toujours partir des sources bibliographiques les plus récentes possibles avant de remonter « dans le temps ». En effet, partir de sources documentaires anciennes fait courir le risque de manquer, en droit par exemple, une évolution législative, jurisprudentielle ou doctrinale. Ces lectures achevées, vous aurez une idée des points à éclaircir, des éléments à creuser et donc de la manière d’organiser votre travail en définissant une problématique. Étape n°3 : Définir une problématique La problématique est tout à la fois l’« art, [et la] science de poser les problèmes »3 et le problème posé. Le sujet que vous avez choisi doit maintenant être problématisé sous la forme d’une question de 2 Voir : https://fr.wiktionary.org/wiki/stabilobosser 3 Voir : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/probl%C3%A9matique Williams, B. et Raynaud, B., Le guide du mémoire, 2017. Page 4 recherche. Question à laquelle il faudra bien sûr répondre à la fin du mémoire : il s’agit en quelque sorte du contrat moral passé avec le lecteur. L’erreur courante consiste à multiplier les questions posées ; une question de recherche appropriée doit être univoque. La confection d’une carte heuristique s’avère souvent fort utile pour faire émerger une problématique : elle aide à mettre en perspective les idées force et à identifier les relations de causalité. Adoptez‐vous une démarche « positive » ou normative ? Cette question épistémologique est fondamentale. L’approche positive (de positivisme) vise à expliquer le fonctionnement des choses ; par exemple : comment la courbe des taux affecte‐t‐elle la rentabilité des banques commerciales ? L’approche normative (de norme) tend à définir de bonnes pratiques ; par exemple : faut‐il couvrir le risque de change d’un portefeuille sur le long terme ? Étape n°4 : Structurer son travail Soignez le plan, l'introduction, la conclusion, les transitions entre les parties et sous‐parties : à leur seule lecture, on doit être capable de suivre le fil conducteur de la pensée et de supposer le contenu traité. C'est d'ailleurs un exercice fort utile, et qui devrait être systématisé, en fin de rédaction du mémoire, que de supprimer (sur un fichier informatique séparé, cela s'entend…) l'ensemble du corps du texte pour ne conserver que l'introduction, les transitions, les titres et sous‐titres et la conclusion : si l'ensemble restant, ainsi dépouillé, permet de suivre l'évolution de la pensée, cela signifie que le test aura été passé avec succès. Dans le cas contraire, il convient de remettre son métier sur l’ouvrage pour améliorer ce qui ne convient pas. 1) Plan Le plan constitue un élément fondamental de la qualité d'un mémoire universitaire : un bon plan ne suffit pas à faire un bon mémoire mais un mauvais plan, quelles que soient les qualités rédactionnelles par ailleurs, conduit nécessairement à un mémoire médiocre. Le sommaire, sur une page maximum et dont la présence est indispensable en début de mémoire, constitue pour le lecteur un premier indicateur de la qualité du plan : les intitulés sont‐ils clairs et pertinents ? La clarté des intitulés reflète en effet bien souvent la clarté de la pensée et la maîtrise de son sujet par le rédacteur du mémoire. Les intitulés choisis doivent par ailleurs impérativement correspondre au contenu uploads/Litterature/ 2017-b-williams-b-raynaud-guide-du-memoire.pdf
Documents similaires



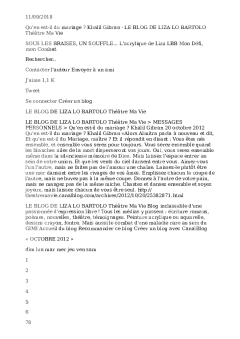






-
81
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 30, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4488MB


