Revue d'histoire et de philosophie religieuses Les sept puissances divines dans
Revue d'histoire et de philosophie religieuses Les sept puissances divines dans l'Inde et l'Iran. Communication faite à Rome, le 28 septembre 1935, au XIXe Congrès International des Orientalistes Jean Przyluski Citer ce document / Cite this document : Przyluski Jean. Les sept puissances divines dans l'Inde et l'Iran. Communication faite à Rome, le 28 septembre 1935, au XIXe Congrès International des Orientalistes. In: Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 16e année n°6, Novembre- décembre 1936. pp. 500-507; doi : https://doi.org/10.3406/rhpr.1936.2980 https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1936_num_16_6_2980 Fichier pdf généré le 22/11/2019 * Note et Etude critique Les sept puissances divines dans l'Inde et l'Iran (1) Hérodote dit, à propos de la religion des Perses : « ... Mais leur coutume est de monter sur les plus hauts sommets des montagnes et de sacrifier à Zeus, donnant le nom de Zeus à toute la circonférence du Ciel (ουρανός) ; et ils sacrifient aussi au Soleil, à la Lune, à la Terre, au Feu, à l'Eau et aux Vents » (I, 131). Ce texte est important, parce qu'il témoigne d'un effort systématique pour ordonner l'ancien polythéisme ira¬ nien. Les principaux dieux qui peuplent l'univers sont ici groupés et forment une hiérarchie au sommet de laquelle trône Ouranos. Le Ciel occupe dans ce système la même place que Zeus dans le panthéon grec. En étudiant naguère la théo¬ rie des Éléments (2), j'ai essayé de montrer qu'on avait d'abord reconnu trois Éléments : Terre, Feu, Eau, et que plus tard les Vents, conçus d'abord comme un groupe de quatre dieux, s'étaient unifiés de manière à constituer un nouvel Élément, le Vent. Si l'on suppose ce progrès réalisé, les puis¬ sances divines énumérées par Hérodote se réduisent à sept : Ciel, Soleil, Lune, Terre, Feu, Eau, Vent. Pour simplifier l'exposé, nous appellerons cette série « l'heptade iranienne ». Cette hiérarchie a bientôt été dérangée par l'introduction dans le panthéon iranien d'une divinité étrangère, la Grande Déesse. C'est ainsi que, dans la mythologie des Perses d'après Strabon, la liste des sept puissances divines est portée à huit par l'adjonction d'Aphrodite qui vient alors après le Soleil et la Lune. Un autre facteur tardif tendait à bouleverser la hiérarchie, à savoir la prééminence accordée au Feu dans cer¬ tains milieux. Strabon s'en fait aussi l'écho lorsqu'il déclare qu'en Cappadoce « les mages sont nombreux et appelés prêtres du feu (πύρχώοι) ». Et ailleurs : « Quel que soit le dieu auquel (1) Communication faite à Rome, le 28 septembre 1935, au XIXe Congrès International des Orientalistes. (2) L'Influence iranienne en Grèce et dans l'Inde. ( Revue de l'Uni¬ vers. de Bruxelles , n° 3, 1932, p. 287-93.) Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses, 1936, n" 6. LES SEPT PUISSANCES DIVINES 501 les mages sacrifient, ils commencent par une invocation au Feu (1). » Passons maintenant dans l'Inde. Un très ancien sutianta bouddhique, le Mahâsamaya, énumère ainsi les dieux accou¬ rus à une Grande Assemblée : Y vinrent aussi les dieux Eau, Terre, Feu, Vent, Varuna, les dieux Varuna et la Lune avec le Soleil. Vinrent (aussi) les dieux de la suite de Mitra et de Varuna (2). Si nous éliminons les dieux secondaires rattachés à une grande divinité dont ils constituent l'entourage, il reste sept puissances divines : Eau, Terre, Feu, Vent, la déesse Varuna, c'est-à-dire la Grande Déesse qu'Hérodote appelait Ouranie, la Lune et le Soleil. On voit que l'heptade indienne du Mah⬠samaya reproduit l'heptade iranienne avec cette différence que le Ciel, Ouranos, est remplacé par sa parèdre, la déesse Ouranie. Dans la liste d'Hérodote, le Ciel était au premier rang. Dans la liste du Mahâsamaya bouddhique, où les dieux sont probablement énumérés dans l'ordre de dignité crois¬ sante, Ouranie vient immédiatement au-dessous du Soleil et de la Lune, comme dans l'énumération de Strabon. Tout se passe donc comme si les idées religieuses avaient évolué parallèlement dans l'Inde et dans l'Iran. Nous allons voir qu'en explorant la littérature indienne, on peut découvrir d'autres faits qui éclairent ce parallélisme. * ·!» Dans la Chändogya-upanisad, V, 11-18, six brahmanes de grand savoir vont interroger le roi Asvapati Kaikeya sur l'Ätman Vaiévânara. Chacun des brahmanes expose sa doc¬ trine. Pour l'un, l'Ätman Vaisvänara est le Ciel ; pour l'autre, le Soleil ; pour l'autre, le Vent, l'Espace, l'Eau, la Terre. Asvapati leur expose qu'ils n'ont en vue, respectivement, qu'un seul aspect, une partie de l'univers. L'Ätman Vaisvä¬ nara est un Tout supérieur aux parties qui le composent. Comme l'a justement observé Deussen (3), la notion qui est à la base du Vaisvänara est Agni, le Feu divinisé. Dans la Brhadâranyaka-up., V, 9, il est appelé Agni Vaisvänara, tandis que dans la Chândogya c'est Yâtman qui est appelé Vaisvänara. On est parti de l'idée d'un principe igné commun (1) E. Benveniste, Persian religion, p. 52 et 60. (2) Cf. La Déchéance de la Grande Déesse. (R. H. R., sept.-déc. 1934, p. 160-163.) (3) Sechzig Upanishad's des Veda , 3e éd., p. 144. 502 revue d'histoire et de philosophie religieuses à tous les hommes et l'on est passé à la notion d'ätman. Si l'on néglige ce développement pour ne retenir que la notion originelle du Feu, l'épisode d'Asvapati se réduit au schème suivant : chacun des sept personnages revendique la préémi¬ nence pour un principe divin. Mais Asvapati ne place pas seulement le Feu au premier rang ; il déclare qu'Agni est le Tout et que les six autres puissances n'en sont que des aspects particuliers. La somme de ces puissances forme une série analogue à l'heptade iranienne : heptade iranienne : Ciel Soleil Lune Terre Feu Eau Vent épisode d'Asvapati : Ciel Soleil Terre Feu Eau Vent Espace (1) On aperçoit d'une série à l'autre deux différences : a) les Éléments, qui étaient au nombre de quatre dans l'heptade iranienne, forment avec l'espace un groupe de cinq dans l'épisode d'Asvapati ; b) la Lune, qui avait le troisième rang dans l'heptade iranienne, a disparu dans la série indienne. Tout se passe comme si, le groupe des Éléments s' étant accru d'une unité, l'un des grands astres avait été supprimé pour éviter d'allonger la liste et conserver le cadre de l'heptade. D'ailleurs la Lune (Soma) faisait encore partie de la série dans l'énumération du Mahäsamaya bouddhique. On peut donc admettre que l'heptade iranienne, qui reparaît sans modification de plan dans le Mahäsamaya, a subi dans l'épi¬ sode d'Asvapati un remaniement tardif. Ce remaniement serait en relation, d'une part, avec l'accroissement de la série des Éléments ; d'autre part, avec la prééminence attribuée au Feu. Pour Asvapati, Agni est supérieur aux autres dieux et il est le Grand Tout dont chaque divinité n'est qu'un aspect. Et ceci est à mettre en parallèle avec les témoignages de Strabon sur la religion des Mages. L'analyse d'autres mor¬ ceaux empruntés à l'Upanisad confirme ce que nous apprend l'épisode d'Asvapati. Dans la Brhadär. up., la 4Θ leçon s'ouvre sur un dialogue entre Yâjnavalkya et le roi Janaka. Le premier expose les doctrines de six autres maîtres relativement au brahman. Pour l'un d'eux, le brahman est parole (uäc), pour l'autre il est souffle (präna), pour l'autre œil (caksus), oreille (s'ro- iram), esprit (marias), et pour le dernier cœur (hrdayam). Yâjnavalkya montre l'insuffisance de ces définitions. Parole, (1) Pour faciliter la comparaison avec l'heptade iranienne, j'ai disposé dans un ordre arbitraire les termes de la série d'Asvapati. LES SEPT PUISSANCES DIVINES 503 souffle, etc., désignent non le brahman lui-même, mais ses séjours (äyatana ). Par l'inspiration, le contenu, la mise en scène, ce dialogue s'apparente étroitement à l'épisode d'Asvapati. Dans les deux cas, les enseignements des six maîtres sont réfutés en présence d'un roi, mais tandis que dans la Chänd., la réfuta¬ tion est l'œuvre d'Asvapati, dans la Brhadär ., l'enseignement est donné par Yäjnavalkya et cette substitution d'un brah¬ mane à un roi peut être l'indice d'un remaniement du texte, Chacun des six maîtres considère sous un aspect particulier Yätman ou le brahman et l'étroitesse de ces vues est finale¬ ment dénoncée. On peut donc supposer à la base des deux récits des conceptions analogues. Voyons si l'épisode de Yäjnavalkya se laisse interpréter de la même manière que celui d'Asvapati. Dans l'heptade iranienne les sept termes sont empruntés au macrocosme. Dans l'épisode de Yäjnavalkya, à part le brahman, principe suprême, les six autres termes sont relatifs au microcosme ; il faut donc les transposer du plan humain dans le plan cosmique. Pour cinq d'entre eux les équivalences sont données par Brhadär ., I, 3 : voix souffle œil oreille esprit Feu Vent Soleil Régions Lune Les Régions (disah) désignent ici l'Espace (äkäsa). Nous tenons donc déjà cinq puissances divines. Sur la sixième, des précisions sont apportées par Brhadär. VI, 1. Les six organes de l'homme se disputent la prééminence en présence du brahman. Au fond, la question posée est la même que dans le dialogue de Yäjnavalkya et de Janaka, mais ce sont les organes personnifiés qui prennent ici la parole et le cœur est remplacé par le sperme. Or, la Brhadär., nous apprend ail¬ leurs (VI, 4, 9) que uploads/Litterature/ 1935-jean-przyluski-les-sept-puissances-divines-dans-l-x27-inde-et-l-x27-iran.pdf
Documents similaires



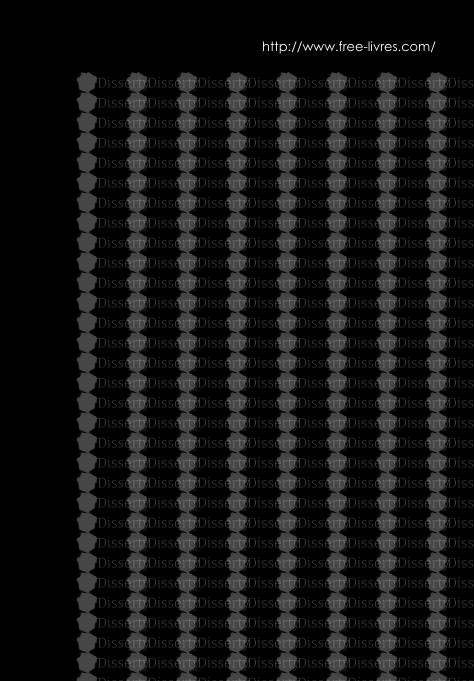






-
71
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 26, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3362MB


