1 Pr. Jean Louis CORREA, UASZ 2015/2016 UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR UF
1 Pr. Jean Louis CORREA, UASZ 2015/2016 UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR UFR des Sciences Economiques et Sociales Département de Droit des Affaires COURS DE METHODOLOGIE JURIDIQUE Par Pr. Jean Louis CORREA, Agrégé des facultés de Droit Université Assane Seck de Ziguinchor Ce cours vise à aider les étudiants de première année de droit à se familiariser avec les exercices les plus fréquents dans les facultés de droit au Sénégal. En effet, selon les traditions facultaires, les techniques utilisées peuvent différées. Dès lors, les étudiants ne doivent pas s’étonner de voir par ailleurs d’autres méthodes de commentaire, de dissertation etc. Cependant, ils devront s’efforcer au respect des techniques, méthodes et canevas sus indiqués. Ce cours comprend plusieurs parties. La première partie sera réservée à la dissertation juridique ; la deuxième partie au cas pratique, la troisième partie au commentaire de décision de justice plus communément appelé commentaire d’arrêt ; La quatrième partie enfin est réservée à la technique du commentaire de texte, en général. L’attention doit être attirée sur le fait que l’objectif de cette introduction à la méthodologie n’a pas pour objectif d’apprendre la méthodologie aux étudiants mais plutôt de leur permettre d’acquérir les rudiments nécessaire à l’accomplissement de tous ces exercices. L’apprentissage de la méthodologie étant une quête inlassable, un souci permanent pour tout juriste. Cette quête et ce souci devront être votre boussole et votre viatique. La RIGUEUR doit être votre credo. Chapitre 1 : La dissertation Chapitre 2 : Le cas pratique Chapitre 3 : Le commentaire d’arrêt Chapitre 4 : Le commentaire de texte 2 Pr. Jean Louis CORREA, UASZ 2015/2016 Chapitre I : La dissertation juridique Ne soyez pas l’étudiant qui… Qui se précipite sur son stylo pour écrire sans avoir réfléchi Pour qui trouver un plan relève du pur hasard Qui croit que le style juridique est nécessairement pompeux et obscur Qui écrit douze pages sans jamais aller à la ligne La dissertation (du latin disserere, exposer des raisonnements, des idées liées les unes aux autres) correspond à la mise en œuvre d’un discours ordonné et cohérent à propos d’un problème envisagé dans sa dimension juridique. Les maîtres mots de cet exercice sont l’exhaustivité et la rigueur. Exhaustivité, parce qu’il faut aborder tous les aspects importants du sujet. Rigueur, parce qu’il faut éviter les hors sujets et veiller à ce que les développements correspondent à ce qui a été annoncé par la problématique exposé dans l’introduction et les intitulés du plan. La dissertation juridique comporte souvent une introduction (1) et un développement (2), la conclusion étant une étape peu familière dans le cadre de cet exercice. 1. L’introduction « L’ordre affranchit la pensée » René DESCARTES « Sans technique, le don n’est rien qu’une sale manie ». Le terme introduction vient du latin intro ducere qui signifie conduire dedans. L’introduction sert à conduire à l’intérieur du sujet. Elle est une partie intermédiaire entre le sujet et les développements qu’il appelle. Il s’agit, par une analyse des termes de l’intitulé de formuler au mieux la question posée et d’en délimiter le champ. Cette première étape suscite un certain nombre questionnement. Qui, quoi et comment ? De quoi on parle ? Pourquoi on en parle ? Comment on en parle ? Système en entonnoir L’introduction comporte sept (7) parties : -Amener le sujet Il s’agit de partir du général au particulier. En d’autres termes cette étape consiste à placé le sujet dans son contexte (juridique, économique social, historique etc.) 3 Pr. Jean Louis CORREA, UASZ 2015/2016 -Poser le sujet Cette tâche consiste à éclairer le contenu du sujet. En général, les sujets sont formulés de façon énigmatique. Poser le sujet, c’est formuler le sujet la sujet de façon plus clair ; il est même conseillé de le reformuler. -Définir des termes du sujet Les termes du sujet doivent être explicités : pourquoi tel terme a été employé et pas un autre, à quel champ sémantique renvoi tel ou tel terme, etc. Tous les mots du sujet doivent être analysés, jusqu’aux articles (analyser l’emploi du singulier ou du pluriel, de l’article défini ou indéfini, etc.) De l’analyse précise des termes du sujet on peut alors déduire la problématique. -Délimitation du sujet (s’il y a lieu) L’introduction peut servir également à évacuer certaines questions marginales ou qui ne présente pas d’intérêt pour l’étude que l’on voudrait faire. Il s’agit de situer progressivement la question à traiter dans l’ensemble de la matière, en centrant jusqu’à la cerner avec précision la question soulevée. Toutefois, la délimitation ne doit être un prétexte, pour écarter des éléments (que l’on ne maitrise pas) qui mérite d’être traités. Elle doit être nécessaire. Cela signifie que lorsque le sujet est assez clair et précis, l’opération de délimitation n’est d’aucune utilité. -Problématique C’est la question centrale que soulève le sujet et qui va imprégner tout le développement qui suivra. Parfois, la question que vous devez traiter est directement posée dans le sujet. Il convient alors de répondre précisément à la question posée. Exemple : la jurisprudence constitue-t-elle une source de droit ? En général, ce genre de sujet invite l’étudiant à prendre personnellement position. D’autres fois, la question que vous devez exposer n’est pas clairement exprimée dans le sujet. Dans cette hypothèse, il ne vous appartient pas d’inventer n’importe quelle problématique. La problématique préexiste certainement, et vous devez la retrouver à travers le sujet. En général, elle a été exposée en cours et elle figure dans les manuels. Eventuellement, si vous avez du mal à dégager la problématique, essayez de reformuler le sujet sous forme interrogative en utilisant des formules variées : « Quelle est l’influence de … ? » ; « A quoi sert … ? » ; « Comment fonctionne … ? » ; « Quelle est la portée de … ? »…….. - L’intérêt du sujet Une fois la problématique soulevée, il faut insister sur l’intérêt du sujet. Il s’agit de répondre à la question : « pourquoi dois-je parler de ce sujet ? ». Si le sujet a été donné, c’est qu’il est important. Il faut donc rechercher pourquoi le sujet a été donné et le dire franchement. Ces intérêts, souvent liés à des développements d’actualité, peuvent être d’ordre pratique et/ou théorique : 4 Pr. Jean Louis CORREA, UASZ 2015/2016 Intérêt théorique : Ce sont les implications théoriques du sujet à savoir : les débats qui se sont soulevés (ce sont les controverses doctrinales), lorsque les principes juridiques traduisent une évolution particulière (de la législation, des mœurs, de la société…). L’intérêt pratique L’intérêt pratique se découvre la plupart du temps en cherchant à imager des cas d’application concrets des règles juridiques en cause. On peut alors montrer que la question envisagée se pose fréquemment, que les solutions à dégager intéressent beaucoup de personnes ou commandent des conséquences (économiques, sociologiques…) importantes. Faire apparaître, quand c’est possible, l’actualité des problèmes renforce considérablement le dynamisme de la dissertation ; mais n’extrapolez surtout pas ! -Justification et annonce du plan Vous voilà en possession de votre problématique qui prend le plus souvent la forme d’une question. Le plan n’est autre que la réponse en deux points à cette question. Mais il ne s’agit pas seulement de dire quelle articulation a été choisie ; il faut justifier ce plan. On doit commencer par exprimer l’idée ou les idées essentielles animant le sujet ; puis on annonce l’ordonnancement de la démonstration. Le plan adopté doit apparaître comme une conséquence logique et naturelle des principes antérieurement dégagés. L’essentiel consiste donc à expliquer pourquoi la présentation retenue s’impose. L’annonce proprement dite se limite à la phrase dans laquelle vous ferez apparaître entre parenthèse le I et le II du plan. Ex : ...............(I), ...................(II). En première année, vous pouvez vous satisfaire de phrases assez simple comme : dans un premier temps, puis dans un second, ou, dans une première partie nous traiterons telle chose et puis telle autre dans une seconde. Mais il faudra assez vite dépasser ce stade car il n’apporte pas de réelle satisfaction sinon celle de mettre en parallèle deux idées principales -Annonce du plan (deux parties) : plan bateau, plan chronologique, plan technique-plan d’idée. 2. Le plan Le plan est commandé par le sujet, ou, plus précisément, par l’idée directrice que vous avez dégagée. Il convient donc d’adopter un plan qui suive une ligne directrice claire, que l’on s’attache à respecter et à démontrer. Concrètement : le plan est la réponse à la problématique posée. En droit, le plan se structure en deux parties, deux sous-parties. Ce qui fait un total de .... 4 sous parties. Si vous avez lu attentivement ce qui précédait, vous devez vous souvenir que, lors 5 Pr. Jean Louis CORREA, UASZ 2015/2016 de la recherche de notre problématique, nous avons regroupé nos idées en 4 catégories. Celles- ci correspondent aux 4 sous parties. Mais pour réaliser le plan, ces 4 catégories doivent être contenues dans deux grandes catégories. De telle sorte que : Catégorie 1 regroupe Une sous-catégorie, Une seconde sous-catégorie, Catégorie uploads/Ingenierie_Lourd/ cours-de-methodologie-pr-jean-louis-correa-2.pdf
Documents similaires
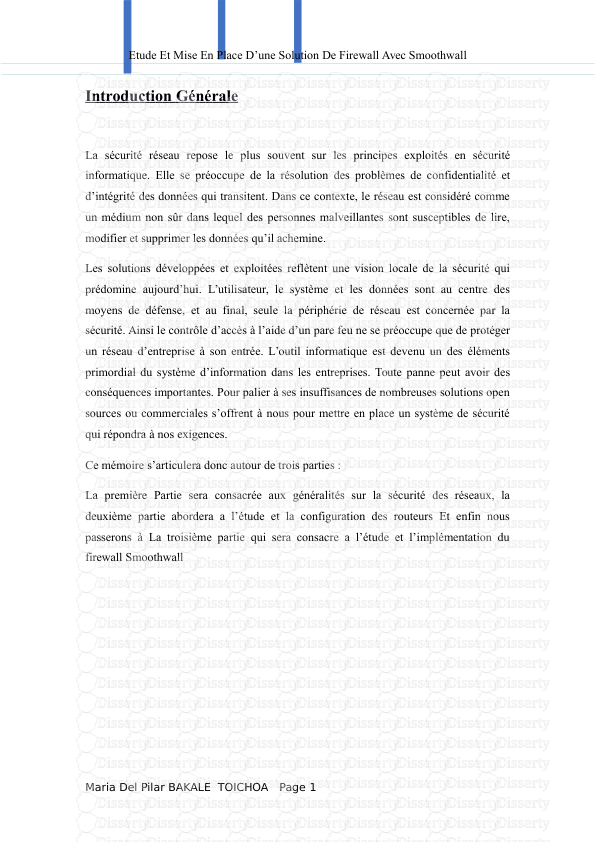









-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 15, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.9063MB


