1 CHAPITRE 1 cours GESTION DES RÉSEAUX HYDRIQUES Pr BENHACHMI MOHAMMED KARIM LS
1 CHAPITRE 1 cours GESTION DES RÉSEAUX HYDRIQUES Pr BENHACHMI MOHAMMED KARIM LST GEE Département Génie des Procédés et Environnement Filière LST option GEE Module AEP/GESTION DES RESEAUX HYDRIQUES Partie Gestion des Réseaux Hydriques Pr BEN HACHMI MOHAMMED KARIM 2 CHAPITRE 1 cours GESTION DES RÉSEAUX HYDRIQUES Pr BENHACHMI MOHAMMED KARIM LST GEE Introduction Les systèmes de distribution d’eau potable appartiennent au même titre que les autres réseaux techniques, à un environnement urbain et périurbain dans lequel ils agissent et interagissent avec les autres réseaux. La gestion technique de tels réseaux a pour principal objectif de livrer aux consommateurs une eau répondant aux normes de qualité, à un prix acceptable et avec une continuité de service sans défaut. De tels objectifs nécessitent une connaissance précise du réseau, de ses infrastructures, de son fonctionnement hydraulique et passe par un entretien suivi et régulier du réseau. Or, les exploitants des réseaux d’AEP (alimentation en eau potable) se trouvent généralement confrontés à la difficulté de connaitre avec précision leur réseau compte tenu de sa diversité (généralement de multiples tranches de travaux réalisées selon des techniques différents et sur plusieurs années) de son étendue et des difficultés d’accès. Le réseau d’alimentation en eau potable constitue un patrimoine qui vieillit et qu’il nécessaire de renouveler quand il a atteint un seuil de vétusté limite. Ce seuil limite dépend de nombreux paramètres que se soit environnementaux, techniques, de gestion, économiques ainsi que la politiques des gestionnaires. Pour qu’une politique de renouvellement soit économiquement viable, il faut qu’elle soit liée le plus directement possible au vieillissement. Les questions récurrentes que le gestionnaire d’un réseau d’alimentation en eau potable se pose, concernant le renouvellement du réseau, sont les suivantes : dois-je renouveler les canalisations ?, lesquelles dois-je renouveler ?, quand dois-je envisager les travaux ? Ce vieillissement engendre des dysfonctionnements venant compliquer la tache du gestionnaire. Ces dysfonctionnements se manifestent principalement au travers de trois symptômes caractéristiques : - Une multiplication des fuites et ruptures ; - Une diminution des capacités de portage hydraulique ; - Une dégradation de la qualité de l’eau (eaux colorées, présence de microorganismes, etc.). Prévoir le renouvellement des conduites et diagnostiquer ces dysfonctionnements constituent donc un réel chalenge, et obligent les gestionnaires des réseaux à disposer d’outils de suivi et de prévision. 3 CHAPITRE 1 cours GESTION DES RÉSEAUX HYDRIQUES Pr BENHACHMI MOHAMMED KARIM LST GEE Afin d’anticiper, prévoir et optimiser, la modélisation du vieillissement du réseau d’AEP semble être un pré-requis. Un modèle de vieillissement consiste à trouver des relations entre le taux de défaillances ou la durée de vie et les variables de détérioration. Les interactions entre les variables de détériorations sont si nombreuses qu’il est pratiquement impossible d’établir des modèles déterministes à l’échelle d’un réseau surtout lorsque les informations disponibles à partir des capteurs sont insuffisantes. La plupart des modèles sont de nature statistique et économique. Il s’agit des modèles très complexes et qui nécessitent une base de données exhaustive et couvrant une période temporelle longue (plus de 10 ans) sur la maintenance du réseau. Ces modèles ne peuvent être utilisés que sur des réseaux disposant d’un niveau d’instrumentation avancé, dont l’état actuel du réseau est bien renseigné. Or, que peut-on attendre de tels modèles sur des réseaux vieillissants et fortement perturbés par des dysfonctionnements divers et variés. 4 CHAPITRE 1 cours GESTION DES RÉSEAUX HYDRIQUES Pr BENHACHMI MOHAMMED KARIM LST GEE Chapitre 1 : Problématique de la gestion des fuites dans le réseau de distribution d’eau potable Avec le temps les canalisations vieillissent, leurs matériaux évoluent dans le temps et se fragilisent. Il arrive un moment, à plus ou moins long terme, où elles devront être remplacées, que se soit les conduites de distributions proprement dites ou les branchements. Des enjeux lies à l’obligation de la distribution de l’eau (quantité d’eau suffisante) et sanitaire (risque lié à a qualité), des enjeux financiers imposent le gestionnaire d’un réseau de disposer d’outils de suivi et de prévision de son réseau. Avant toute analyse, il est nécessaire d’appréhender le métier de la distribution de l’eau potable, et tout particulièrement les éléments concernant l’infrastructure mais surtout, prérogatives de la gestion technique d’un tel réseau. Dans ce chapitre, on décrira le contexte de l’étude et la problématique des fuites. Pour ce faire, on ferra une présentation rapide du réseau d’eau potable, les différentes fonctions qu’il doit accomplir ainsi qu’une vision sur la gestion technique du réseau, puis on abordera la problématique des fuites. Ces éléments bibliographiques posés, envisageront les difficultés d’une telle gestion. En fin le fonctionnement du système de distribution d’eau potable de Casablanca sera présenté. 5 CHAPITRE 1 cours GESTION DES RÉSEAUX HYDRIQUES Pr BENHACHMI MOHAMMED KARIM LST GEE I. Le réseau de l’eau potable Le réseau d’eau potable est une infrastructure importante qui doit permettre de distribuer une eau de bonne qualité en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des usagers et, souvent aux besoins en eau nécessaires pour lutter contre les incendies. Les principaux constituants d’un réseau sont : Un réservoir : Est un ouvrage généralement en béton qui permet de stocker de l'eau. Dans la grande majorité des cas, chaque réseau possède un réservoir principal, dit réservoir de tête. Il est alimenté en eau potable en débit constant et il en assure la distribution. Lorsque le débit distribué est supérieur (resp. inférieur) au débit entrant, le niveau du réservoir baisse (resp. augmente). Le volume d'eau stocké doit être suffisant pour que le réservoir ne se vide pas complètement. Outre la fonction de stockage, le réservoir de tête assure un niveau d'énergie qui permet de distribuer l'eau à une pression suffisant. Les canalisations : Elles ont pour rôle de transporter un certain débit d’eau. Elles peuvent être de différents types et se composent d’éléments droits (tuyaux) et d’éléments de raccordement. Les branchements : Ils constituent le raccordement des usagers au réseau de distribution. Ils doivent être tenus à l’abri du gel depuis la prise sur conduite de distribution jusqu’au poste de comptage compris. Ils sont regroupés en fonction de leur diamètre. On distingue : Les branchements de petit diamètre (15 à 40 mm). Les branchements de gros diamètre (> 60 mm). Les appareils de fontainerie : Les principaux appareils de fontainerie sont : Les vannes qui permettent d’isoler certains tronçons Les ventouses installées aux points hauts, qui permettent de purger l’air qui peut s’emmagasiner dans les conduites. Les décharges disposées aux points bas, pour permettre la vidange des conduites. Les bouches et poteaux d’incendie qui doivent assurer un débit sur une certaine durée Les bouches de lavage et d’arrosage installées dans les bordures de trottoirs. Les autres définitions des paramètres du réseau eau potable. Généralement les réseaux de distribution sont de deux types : - Les réseaux maillés. - Les réseaux ramifiés. 6 CHAPITRE 1 cours GESTION DES RÉSEAUX HYDRIQUES Pr BENHACHMI MOHAMMED KARIM LST GEE I.1. Réseaux maillés Ces réseaux sont constitués de conduites raccordées aux deux extrémités. Ils comportent plusieurs mailles et sont conseillés pour les moyennes et grandes collectivités car ils offrent un meilleur service aux usagers. En effet, en cas de réparations, les canalisations maillées peuvent s’assister mutuellement et le nombre d’abonnés non desservis sera réduit au maximum, puisque l’eau peut atteindre un même point par plusieurs chemins [1]. Figure 4 : Réseau maillé I.2. Réseaux ramifiés Les réseaux ramifiés sont composés de conduites sur lesquelles sont branchées des antennes, et aucune d’elles n’est alimentée en retour par une autre. Contrairement aux réseaux maillés, ces derniers entraînent la perte de service de tous les usagers en cas de réparation. Ce type de réseaux est conseillé en zones rurales car la répartition de la population ne nécessite pas la mise en place d’un réseau maillé qui serait plus onéreux [1]. Figure 5 : Réseau ramifié II. Défaillances des conduites du réseau d’AEP 7 CHAPITRE 1 cours GESTION DES RÉSEAUX HYDRIQUES Pr BENHACHMI MOHAMMED KARIM LST GEE Le réseau d'eau potable a pour fonction de base de délivrer de façon continue une eau de bonne qualité et avec une quantité suffisante. Néanmoins cette fonction qui parait simple, demande à l’exploitant de veiller sur le réseau en raison des dégradations qu’il peut subir au cours du temps. Ces dégradations peuvent surgir à différents endroits (sur les organes du réseau et sur les conduites). Les conduites d’eau potable qui constituent la plus grande partie du réseau, doivent assurer [2]. Le transport de l’eau avec une pression et un débit suffisants. La fourniture d’eau avec une qualité répondant aux normes en vigueur. La continuité de la distribution. Ces fonctions peuvent s’altérer dans le temps en raison de l’apparition des fuites qui engendrent des pertes d’eau. Des efforts doivent alors être consentis pour détecter et localiser ces fuites. Les fuites engendrent des pertes qui peuvent être de deux types: Les pertes en adduction : qui surviennent dans le cas où il y a des transferts d'eau très importants, entre la production et la mise en distribution. L’absence uploads/Ingenierie_Lourd/ chapitre-1-cours-module-gestion-reseaux-d-eau-potable-lst-gee.pdf
Documents similaires







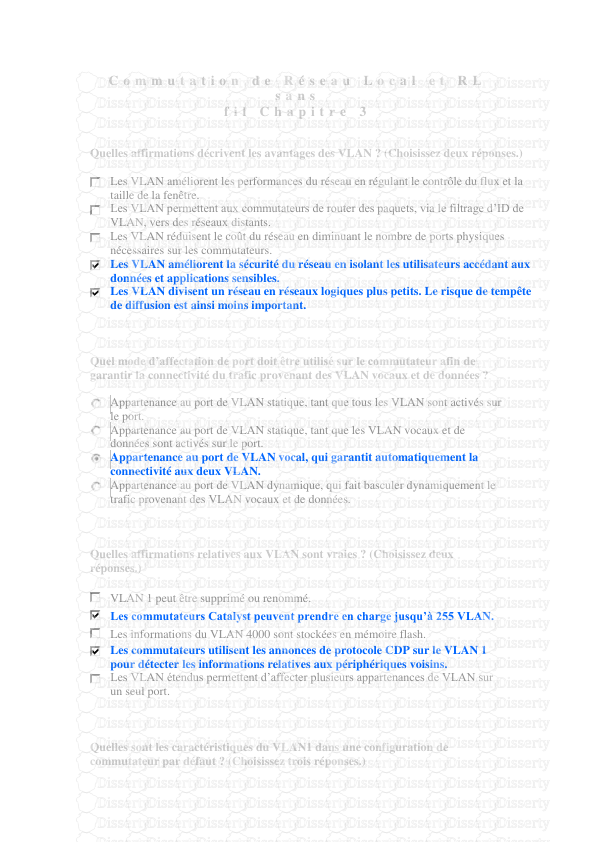


-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 07, 2021
- Catégorie Heavy Engineering/...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3662MB


