Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France par Jean-Marie M
Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France par Jean-Marie Michel Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France 1 LES POLYMERES THERMODURCISSABLES .................................................................................................. 1 1) LES PHENOPLASTES ................................................................................................................................ 1 L'apport de Baekeland ..................................................................................................................................... 3 Les résines phénoliques ................................................................................................................................... 3 L'industrie des dérivés formophénoliques en France ...................................................................................... 4 La fabrication .............................................................................................................................................. 4 Les applications :......................................................................................................................................... 4 La profession : ............................................................................................................................................. 5 Les produits dérivés: ................................................................................................................................... 6 L'importance des résines phénoliques dans le marché des matières plastiques: .......................................... 6 Les sociétés de résines phénoliques. Des origines à la fin de la 2ème guerre mondiale .................................... 6 Résines et Vernis Artificiels (RVA): Progilites .......................................................................................... 6 Huiles, Goudrons et Dérivés (H.G.D.) ........................................................................................................ 7 La Bakelite .................................................................................................................................................. 8 Kuhlmann/CFMC ........................................................................................................................................ 8 La Beckacite ................................................................................................................................................ 9 Situation générale à la fin de la 2ème guerre mondiale ..................................................................................... 9 Evolution des sociétés et de la productions après la 2ème guerre mondiale ................................................... 10 La Beckacite (Groupe Reichhold) ............................................................................................................. 10 Plastugil-RVA ........................................................................................................................................... 11 La Bakelite ................................................................................................................................................ 12 H.G.D.-CdF-Total ..................................................................................................................................... 13 Autres sociétés .......................................................................................................................................... 13 La production nationale ................................................................................................................................. 14 2) AMINOPLASTES ...................................................................................................................................... 14 Condensats urée-formol ................................................................................................................................ 14 Les sociétés productrices ........................................................................................................................... 15 Production/capacités ................................................................................................................................. 19 Condensats mélamine-formol ....................................................................................................................... 20 Les sociétés productrices ........................................................................................................................... 20 3) POLYESTERS ............................................................................................................................................ 23 Polyesters saturés thermodurcissables (alkydes, glyptals) ............................................................................ 23 Les origines. .............................................................................................................................................. 23 Les résines glycérophtaliques en France avant 1945................................................................................ 25 Les résines glycérophtaliques en France après 1945 ................................................................................. 26 L'évolution technique ................................................................................................................................ 27 La Production ............................................................................................................................................ 27 Polyesters insaturés ....................................................................................................................................... 28 Les origines américaines : Résines et renforcement par les tissus de verre .............................................. 28 La situation en France ............................................................................................................................... 30 4) EPOXYVINYLETHERS ........................................................................................................................... 41 LES POLYMERES THERMODURCISSABLES 1) LES PHENOPLASTES Léo Hendrik Baekeland est né en 1863 dans la ville de Gand (Belgique) Son brillant cursus scolaire, se déroule entièrement à Gand. Il étudie la chimie à l'Ecole Technique Municipale, devient docteur de l'Université à 21 ans, puis professeur de Chimie, professeur associé, enfin professeur de Chimie et Physique à l'Ecole Normale du Gouvernement de Gand. Il reçoit un premier prix de chimie qui lui apporte une certaine aisance financière et lui permet de se rendre aux Etats-Unis. Baekeland est passionné de photographie. C'est donc assez naturellement que, arrivant aux Etats-Unis, il entre dans une société de photographie: il devient chimiste dans les sociétés Richard Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France par Jean-Marie Michel Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France 2 Antony et Ansco, sociétés de fabrication de papier photographique au bromure d'argent. Peu de temps après, il s'établit à son propre compte et s'installe fabricant de papier photographique. C'est dans ce nouveau cadre qu'il met au point un papier spécial au chlorure d'argent, insensible au rayonnement jaune de la flamme de la bougie et du gaz d'éclairage. Ce nouveau papier, baptisé Velox, est un succès. En 1889, le procédé est acheté par Eastman Kodak pour la somme d’ un million de dollars. Baekeland s'intéresse ensuite aux applications de l'électricité et participe à la fondation de la Société Hooker Electrochemical. Quittant le domaine de la photographie puis de l'électricité, Baekeland revient à la chimie, riche du pactole que lui a rapporté le papier Velox, du moins à celle des systèmes phénol formaldéhyde que plusieurs chercheurs essayent d'exploiter sans succès. Son ambition est d'en faire des bases de vernis, voire de nouvelles matières plastiques. On sait, depuis Adolphe Bayer (1872) que l'acétaldéhyde est susceptible de réagir avec le phénol. Les travaux de Bayer sont académiques. Le sujet ne suscite pas d'autre intérêt. L'horizon s'élargit lorsque les conditions de fabrications industrielles du formol, par oxydation catalytique du méthanol, sont décrites par Trillat i. Le formol, le premier terme de la série des aldéhydes aliphatiques, devient aisément et économiquement accessible; Trillat dépose un brevet1 et étudie les applications possibles. Mais sa propension personnelle le porte vers l'exploitation des propriétés bactéricides du formol et l'emploi de ce dernier pour la désinfectionii. Les applications en synthèse chimique retiennent peu son attention. Il écrira trente ans plus tard: "J'avais signalé (Dictionnaire de Wurtz Supplément IIA, article Phénol) que le formol pourrait se condenser avec le phénol pour donner des résines solubles ou insolubles. J'ai montré plus tard, à l'exposition de 1900, toute une série de ces résines. Elles furent d'abord utilisées en 1894 à la préparation de vernis et comme succédané du camphre dans la fabrication du celluloïd iii". Faute d'approfondissement le sujet est laissé en jachère. A la fin du 19ème siècle, le procédé de Trillat incite, en effet, les chercheurs à s'intéresser au formol comme agent de synthèse et notamment à entreprendre des travaux sur la réaction du formol et du phénol. Ce furent surtout le fait des chercheurs germaniques, la France étant représentée seulement par Fayolle et De Laire. Le bilan des recherches en ce début du XXe siècle est assez désappointant et peu encourageant. Certes, le phénol et le formaldéhyde réagissent facilement l'un sur l'autre2, mais, les produits obtenus sont mal définis, allant, selon les conditions opératoires (le rapport des réactifs, la température de la réaction, le pH, la présence de solvant, sa nature, etc...), de masses plastiques solubles à des substances dures, insolubles, infusibles. La réaction peut être violente, fortement exothermique, avec dégagement de substances volatiles, laissant des masses solides dures et poreuses. Les produits, mal définis, résultent de réactions incontrôlées. Les travaux des uns et des autres étaient guidés par l'espoir de découvrir une résine pour vernis capable de rivaliser avec la gomme laque (shellac) ou un nouveau celluloïd. Les résultats sont décevants. C'est à ce moment que Baekeland s'intéresse à la question. Son objectif est aussi de découvrir des vernis supérieurs à ceux existants. Son mérite est de s'être attelé à cette chimie considérée comme complexe, de l'avoir comprise et maîtrisée suffisamment pour définir les conditions de création d'un nouveau domaine industriel.3 1Brevet français 199.919 du 31 juillet 1889. Trillat a commencé sa carrière comme chimiste autodidacte chez Gilliard, Monnet et Cartier, (origine de la Société des Usines du Rhône), usine de la Plaine. 2La propriété s'applique aux phénols et aux aldéhydes en général. Les systèmes crésol-formol concurrence un peu les systèmes formol-phénol en raison du prix plus faible des crésols. 3 L.H.Baekeland. Journal of Ind.Eng.Chem.149 mars 1909; Perkin Medal Award Journal of Ind. Eng. Chem. 177 février 1916 Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France par Jean-Marie Michel Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France 3 L'apport de Baekelandiv En milieu acide, formol et phénol (également crésol, xylénol) réagissent pour former un enchaînement macromoléculaire linéaire où les motifs phénols sont couplés en ortho par des groupes méthylènes. La réaction procède par condensation avec élimination de molécules d'eau. Les molécules de phénol s'unissent par des ponts méthylènes (via les groupes méthylolphénol). Par réactions successives, il se forme des chaînes linéaires de masse élevée, par condensation en position ortho uniquement Ces produits sont solubles dans de nombreux solvants organiques. Ils sont thermoplastiques. En présence d'un catalyseur acide minéral dilué et d'un excès de phénol la réaction s'arrête à ce stade. Cependant par chauffage prolongé à 130°C, avec un agent de condensation comme l'hexaméthylène tétramine4, la résine se transforme à partir de liaisons en para, en une matière infusible, insoluble, réticulée. En milieu basique, la réaction est influencée par la quantité et la qualité de l'agent de condensation. Baekeland distingue 3 étapes successives : - Phase A, formation d'un produit liquide, pâteux, soluble et fusible. - Phase B, transformation sous l'action de la chaleur du produit précédent: formation de produit de condensation intermédiaire, insoluble, infusible, mais susceptible de se ramollir. - Phase C: par chauffage de la phase B, il se forme une masse dure, insoluble, infusible, résistant aux acides, manifestant une excellente résistance aux températures élevées (jusqu'à 300°C) L'évolution de A à C est progressive. La condensation s'effectue sur les positions ortho et para. Sans précaution spéciale, le produit C est constitué par une masse dure et poreuse en raison de l'exothermicité de la réaction et des dégagements gazeux. Dans le procédé Baekeland la matière de la phase A encore fusible, mélangée éventuellement avec des charges, est introduite dans un moule et maintenue à 160-200°C, sous pression. Le produit démoulé est disposé dans un "bakéliseur", enceinte où la condensation est achevée sous pression, à température élevée. Les résines phénoliques Les produits de condensation acide sont dénommés Novolaques. Ils sont caractérisés par un rapport molaire formol/phénol inférieur à 1 (compris entre 0,5 et 0,8). Les produits de condensation alcaline sont obtenus avec un rapport molaire formol/phénol supérieur à 1,5. On distingue les Résols (phase A de Baekeland), les Résitols (phase B), les Résites (phase C). Ces différents produits (A, B) sont les étapes du même processus de condensation qui conduit, in fine, à un système tridimensionnel après chauffage à température élevée. Mais leurs présentations différentes (liquide, en solution, pâteuses, solides) permettent de les adapter à un nombre étendu d'applications que Baekeland a étudiées et brevetéesv: - Les produits liquides sont utilisables comme vernis, la réticulation étant obtenue lors du traitement thermique final, et comme agent d'imprégnation de matériaux poreux. Après l'imprégnation, dans un second uploads/Industriel/histoire-polymere-france-pdf.pdf
Documents similaires



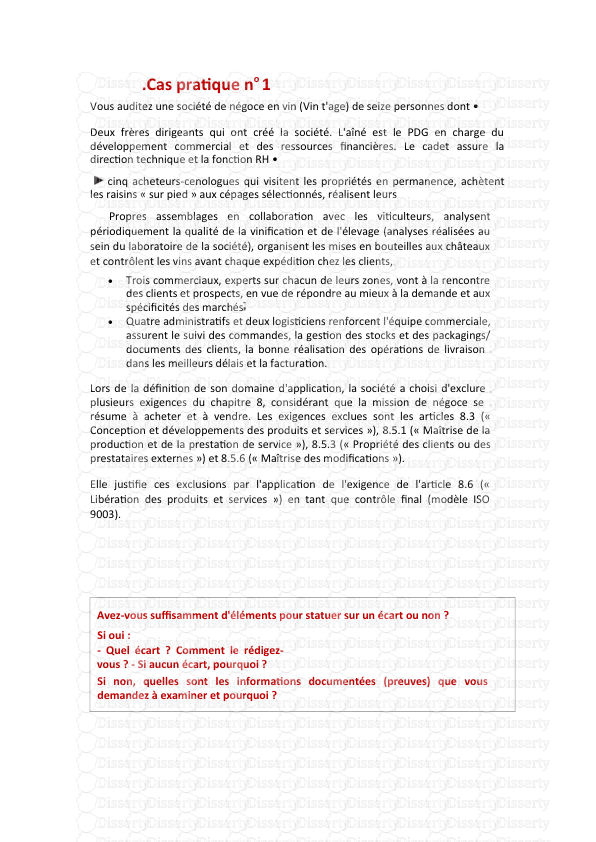






-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 19, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4965MB


