Partie 2 : L’énergie hydraulique 1- Définition : Jusqu'à la Révolution Industri
Partie 2 : L’énergie hydraulique 1- Définition : Jusqu'à la Révolution Industrielle, le bois et la force animale fournissaient l'essentiel de l'énergie utilisée par l'homme. Mais, utilisée depuis longtemps pour entraîner des machines, l'énergie hydraulique fournissait la plus grande partie de l'énergie mécanique. Aujourd'hui, l'énergie hydraulique représente 6 à 7 % de l'énergie consommée mondialement, mais près de 20 % de l'électricité. L’énergie hydraulique est une manifestation indirecte de l’énergie du Soleil et de la force de gravité de la Lune, comme beaucoup de sources d’énergies renouvelables sur Terre (énergie éolienne, énergie des vagues, la biomasse, etc.). Sous l’action du Soleil et du vent, l’eau s’évapore des océans et forme les nuages qui se déplacent au gré des vents. Des abaissements de température au- dessus des continents provoquent la condensation de la vapeur d’eau. La pluie et la neige (les précipitations) alimentent ainsi les couches poreuses de la Terre, les glaciers, les lacs et l'eau des rivières qui s'écoulent petit à petit dans les océans, c'est le cycle de l'eau. La gravité de la Lune et celle du Soleil produisent les marées dont on peut exploiter l'énergie. L'énergie hydraulique est l'énergie fournie par le mouvement de l'eau, sous toutes ses formes : chutes d'eau, cours d'eau, courants marin, marée, vagues. Ce mouvement peut être utilisé directement, par exemple avec un moulin à eau, ou plus couramment être converti, par exemple en énergie électrique dans une centrale hydroélectrique. L'énergie hydraulique est en fait une énergie cinétique liée au déplacement de l'eau comme dans les courants marins, les cours d'eau, les marées, les vagues ou l'utilisation d'une énergie potentielle comme dans le cas des chutes d'eau et des barrages. L’énergie hydraulique désigne l’énergie que les centrales hydrauliques arrivent à produire à partir de la force de l’eau. Basée sur le principe du barrage qui par sa construction va réussir à capter l’ensemble de la force produite par l’eau, l’énergie hydraulique ou hydroélectricité a des avantages certains, mais également quelques inconvénients comme notamment celui du coût de la construction d’une centrale. L'énergie hydraulique permet de fabriquer de l'électricité, dans les centrales hydroélectriques, grâce à la force de l'eau. Cette force dépend soit de la hauteur de la chute d'eau (centrales de haute ou moyenne chute), soit du débit des fleuves et des rivières (centrales au fil de l'eau). L'énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité, est une énergie électrique renouvelable qui est issue de la conversion de l'énergie hydraulique en électricité. L'énergie cinétique du courant d'eau, naturel ou généré par la différence de niveau, est transformée en énergie mécanique par une turbine hydraulique, puis en énergie électrique par une génératrice électrique synchrone. 10 2- Historique : L’énergie hydraulique est connue depuis longtemps. C’était celle des moulins à eau, entre autres, qui fournissaient de l’énergie mécanique pour moudre le grain, fabriquer du papier ou puiser de l’eau pour irriguer les champs, par exemple. -En 1869, l'ingénieur français Aristide Bergès l'utilise sur une chute de deux cents mètres à Lancey, près de Grenoble, pour faire tourner ses défibreurs, râpant le bois afin d'en faire de la pâte à papier. Il parle de « houille blanche » en 1878 à Grenoble, à la foire de Lyon en 1887 et lors de l'Exposition universelle de Paris de 1889. -En 1878, la première centrale électrique, d’une puissance de 7 kW, est construite par William George Armstrong pour alimenter le domaine de Cragside en Angleterre. De 1880 à 1889, une multitude de petites centrales hydrauliques voient le jour pour éclairer de petites villes, des parcs ou des châteaux. -À partir de 1889, grâce au développement des premiers transformateurs électriques, on dépasse le mégawatt de puissance. L'essor de l’industrie et de l’électrochimie encourage le développement de l’hydroélectricité, notamment dans les Alpes du nord où se déroule une course effrénée à la houille blanche et qui deviendra vite la région maîtresse du développement hydroélectrique. -Dès les années 1900, les progrès technologiques de l'hydroélectricité suisse sont à l'origine d'intenses spéculations boursières sur les sociétés hydroélectriques, qui profitent aux implantations industrielles dans les Alpes. -À la fin de la Première Guerre mondiale, le développement du réseau électrique s’intensifie et les centrales hydrauliques, n'étant plus astreintes à produire de l’électricité pour les besoins locaux, grâce aux transformateurs électriques et aux lignes à haute tension, peuvent être de plus en plus puissantes. -Dans les années 1920, une rapide expansion de l'électricité voit le jour en France, avec une multiplication par huit de la production d'électricité hydraulique grâce aux premiers barrages. En 1925, Grenoble organise l'Exposition internationale de la houille blanche. 11 Figure : 3-1 : barrage hydraulique Figure : 3-2 : Centrales hydroélectriques 12 3 - Principe de fonctionnement : L'énergie hydraulique est une énergie peu concentrée : pour produire 1 kWh électrique dans une usine ayant un rendement de 85 %, il faut faire chuter 10 tonnes d'eau d'une hauteur de 40 m. Il en résulte que, pour produire des quantités importantes d'électricité, il faut soit disposer de gros débits (se comptant en milliers de m3 par seconde), soit disposer d'une grande hauteur de chute (se comptant en centaines de mètres, soit les deux. Il faut en outre que l'eau soit disponible en quantités suffisantes, ce qui dépend du bassin versant et de la pluviométrie. L’énergie hydraulique consiste, le plus souvent, à se servir des déplacements d’eau pour faire tourner une turbine. La turbine, couplée à un générateur, va convertir cette rotation en électricité. C’est exactement le même principe que pour les éoliennes, sauf que le vent est ici remplacé par de l’eau. Le principe de fonctionnement d’une centrale hydraulique est directement issu de l’histoire et de l’expérience acquise sur la transformation d’une énergie cinétique comme celle de l’eau en énergie mécanique ou électrique. À l’image de nombreuses autres centrales, le fonctionnement d’une centrale hydraulique est donc fondé sur 4 étapes clés, à savoir : 1. Le rôle du barrage Le barrage a évidemment un rôle de retenue de l’eau. Le principe est de construire un barrage assez grand et solide pour être en mesure de stocker une grande quantité d’eau en retenant l’écoulement naturel de celle-ci. Grâce à cette technique, il se forme ensuite une sorte de lac devant le barrage. 2. Le pilotage de la conduite de l’eau Une fois que le barrage a permis le stockage de l’eau, celle-ci est ensuite dirigée, selon un rythme précis, vers de grands tuyaux mécaniques que l’on appelle des conduites forcées. Le principe est de conduire, à l’aide de ces tuyaux, l’eau vers la centrale hydraulique qui sera située en contrebas. Aujourd’hui, l’ensemble de ce processus est piloté de manière automatique. Autrefois, il fallait toutefois une intervention manuelle pour ouvrir et fermer les vannes, mouvements nécessaires à l’écoulement de l’eau. 3. La production d’électricité La conduite est directement conçue pour pouvoir faire entrer l’eau directement dans la centrale à un endroit précis où celle-ci pourra être en mesure de faire tourner une turbine. Cette turbine entraînée par la force de l’eau fera ensuite tourner un alternateur qui produira de fait un courant électrique alternatif. 4. Le réglage de la tension et l’écoulement de l’eau La tension du courant électrique alternatif produit sera gérée par un transformateur afin de rendre ce courant électrique transportable dans des lignes à très haute tension. 13 L’eau qui est passée dans la turbine a donc perdu de sa puissance et peut être rejetée dans la rivière via un canal de fuite spécialement destiné à cette évacuation. 4- Les types de centrales hydrauliques : Il existe deux grands types de centrales hydrauliques : les barrages et les installations au fil de l’eau. Quelles sont leurs différences ? 4-1-Les barrages Un barrage est un mur que l’on construit dans la vallée d’une rivière, afin de produire de l’énergie hydraulique. Derrière ce mur, l’eau s’accumule, ce qui forme un lac. Lorsque l’on souhaite produire de l’énergie, on ouvre une vanne et l’eau se met à passer à l’intérieur du barrage pour rejoindre la suite du cours d’eau, en contrebas. Ce passage fait tourner une turbine, ce qui produit de l’électricité. Ainsi, il est possible de contrôler et de maîtriser la quantité d’énergie produite. En montagne, il est notamment possible de construire des barrages qui disposent de chutes hautes. Ainsi, le barrage peut produire davantage d’électricité. Les installations de production d’énergie hydraulique avec barrage présentent notamment le grand avantage de pouvoir stocker les ressources nécessaires à la production d’énergie et de les activer en cas de besoin. En effet, on peut stocker l’eau dans le lac de barrage et démarrer la production d’énergie lorsque l’on souhaite injecter de l’électricité sur le réseau. Ce dispositif est donc particulièrement flexible. 14 4-2-L’HYDRAULIQUE ( MODULABLE) correspond aux barrages qui, au travers de leurs retenues d’eau, constituent de véritables réserves de production d’électricité capables de démarrer très rapidement. Lorsque l'on veut exploiter leur potentiel hydraulique, on est amené à construire des barrages qui vont eux- mêmes stocker l'eau lorsqu'elle arrive en abondance, et permettre de la restituer et de la turbiner lorsqu'on en a besoin. Ces barrages ont des hauteurs variables uploads/Industriel/ partie-2.pdf
Documents similaires







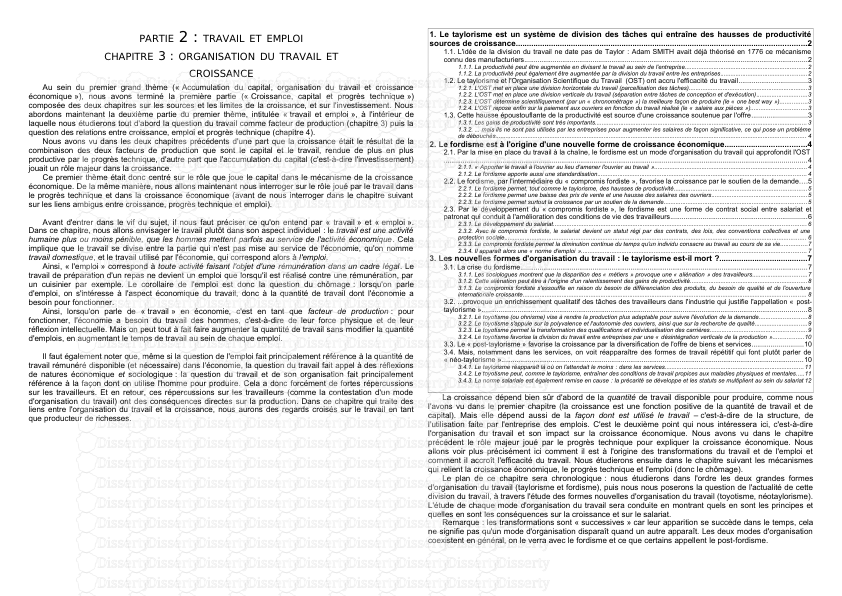


-
90
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 05, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4361MB


