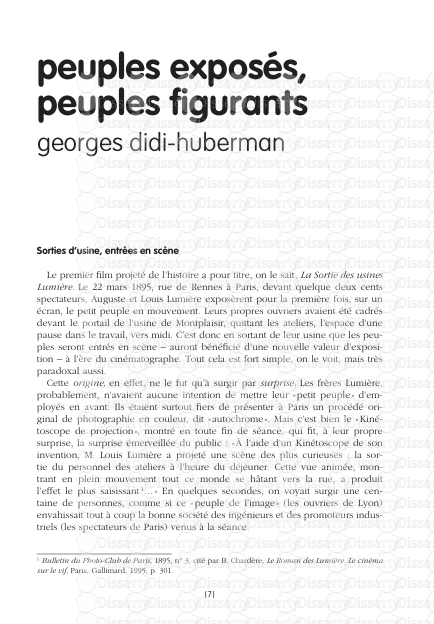[ 7 ] peuples exposés, peuples figurants georges didi-huberman Sorties d’usine,
[ 7 ] peuples exposés, peuples figurants georges didi-huberman Sorties d’usine, entrées en scène Le premier film projeté de l’histoire a pour titre, on le sait, La Sortie des usines Lumière. Le 22 mars 1895, rue de Rennes à Paris, devant quelque deux cents spectateurs, Auguste et Louis Lumière exposèrent pour la première fois, sur un écran, le petit peuple en mouvement. Leurs propres ouvriers avaient été cadrés devant le portail de l’usine de Montplaisir, quittant les ateliers, l’espace d’une pause dans le travail, vers midi. C’est donc en sortant de leur usine que les peu ples seront entrés en scène – auront bénéficié d’une nouvelle valeur d’exposi tion – à l’ère du cinématographe. Tout cela est fort simple, on le voit, mais très paradoxal aussi. Cette origine, en effet, ne le fut qu’à surgir par surprise. Les frères Lumière, probablement, n’avaient aucune intention de mettre leur « petit peuple » d’em ployés en avant. Ils étaient surtout fiers de présenter à Paris un procédé ori ginal de photographie en couleur, dit « autochrome ». Mais c’est bien le « Kiné toscope de projection », montré en toute fin de séance, qui fit, à leur propre surprise, la surprise émerveillée du public : « À l’aide d’un Kinétoscope de son invention, M. Louis Lumière a projeté une scène des plus curieuses : la sor tie du personnel des ateliers à l’heure du déjeuner. Cette vue animée, mon trant en plein mouvement tout ce monde se hâtant vers la rue, a produit l’effet le plus saisissant 1… » En quelques secondes, on voyait surgir une cen taine de personnes, comme si ce « peuple de l’image » (les ouvriers de Lyon) envahissait tout à coup la bonne société des ingénieurs et des promoteurs indus triels (les spectateurs de Paris) venus à la séance. ___________________________ 1 Bulletin du Photo-Club de Paris, 1895, n° 3, cité par B. Chardère, Le Roman des Lumière. Le cinéma sur le vif, Paris, Gallimard, 1995, p. 301. [ 8 ] D’autre part, cette origine ne le fut qu’à surgir dans la différence créée entre les sujets représentés et le mode de leur exposition : ce sont, en effet, des travailleurs montrés dans l’acte même de quitter leur travail. Pas de violence revendicative dans cette sortie, bien sûr : les ouvriers profitent simplement de la pause de midi pour prendre l’air, tandis que leur patron, lui, profite de l’ensoleillement néces saire à la réalisation technique de son film. Mais la différence est bien là, et à plusieurs niveaux : de travailleurs – fabricants de matériel photographique –, les ouvriers deviennent tout à coup acteurs de ce premier film. L’un d’eux, qui passe à vélo, se nomme Francis Doublier : quelque temps plus tard, il passera derrière la caméra avec un nouveau statut social, celui d’opérateur cinématographique 2. Un troisième paradoxe apparaît lorsqu’on découvre que cette origine ne le fut qu’à se déployer tout entière dans l’élément de la répétition. Le film celluloïd de mars 1895 fut, en effet, précédé de sa « répétition générale » sur support papier – donc non projetable – en été 1894 ; il fut suivi d’autres « répétitions » ou versions de la même scène jusqu’à la fin du siècle 3. Ajoutons que, la bande ne mesu rant que dix-sept mètres – pour un total d’environ huit cents photogrammes ou « vues », comme on disait alors –, le film ne durait qu’une minute, « aussi une répé tition de cette projection a-t-elle été demandée par tout l’auditoire émerveillé4. » Cette origine, enfin, n’a curieusement rien d’un « point » de départ : elle appa raît plutôt comme un territoire encore imprécis, un champ de possibilités ouver tes et relatives, non à la valeur intrinsèque du nouveau médium technique, mais aux multiples valeurs d’usage dont il devait, peu à peu, se trouver investi. Il suffit d’abord de feuilleter le catalogue des « vues Lumière » elles-mêmes pour comprendre la signification considérable que revêt le cinématographe pour une histoire de l’exposition des peuples : c’est, en effet, le corps social tout entier, sous toutes les latitudes, qui devient à la fin du XIXe siècle l’objet principal de ce nouvel atlas du monde en mouvement : courses de taureaux et concours de bébés ; manifestations politiques et processions religieuses ; affairements citadins, marchés aux fruits et aux légumes ; travail des dockers, des pécheurs, des pay sans ; récréations et jeux d’enfants ; lancements de navires ; équipes de sport et troupes de cirque ; lavandières et danseurs Ashantis, opulents bourgeois à Lon dres et misérables coolies à Saïgon, etc 5. ___________________________ 2 Ibid., p. 293. 3 Ibid., p. 293-301. G. Sadoul, Histoire générale du cinéma, I. L’invention du cinéma, 1832-1897, Paris, Denoël, 1948 (éd. revue et augmentée, 1973), p. 284-286. N. Burch, La Lucarne de l’infini. Naissance du langage cinématographique, Paris, Nathan, 1990, p. 22-28. 4 Bulletin du Photo-Club de Paris, op. cit., p. 301. 5 Cf. J. Rittaud-Hutinet, Auguste et Louis Lumière : les mille premiers films, Paris, Philippe Sers Éditeur, 1990. P. Dujardin, « Domitor ou l’invention du quidam », L’Aventure du cinématographe. Actes du congrès mondial Lumière, Lyon, Aléas, 1999, p. 277 : « Le temps du cinématographe est bien ce temps où vient à être figuré le peuple, que celui-ci soit appréhendé sous la catégorie du tout venant urbain et laborieux, ou qu’il soit appréhendé sous la catégorie politique du quidam, c’est-à-dire de ce n’importe qui élevé à la dignité de sujet de droit. » [ 9 ] Toute la question demeure de savoir, finalement, de quelle façon et en vue de quoi ces « vues » s’exposaient. On sait que la figuration des peuples représenta un enjeu crucial pour tout le cinéma « primitif » et « moderne » au-delà – ou à partir – de La Sortie des usines Lumière 6. Cela va de Griffith à Eisenstein, d’Abel Gance à King Vidor. Sans oublier Fritz Lang, qui s’inquiéta des foules manipulées dans Métropolis avant que Leni Riefenstahl ne les glorifie, quelques années et un vé ritable dictateur plus tard, dans Le Triomphe de la volonté 7. On comprend bien, dans ces conditions, l’urgence politique – et la difficulté conceptuelle – d’une analyse de ces phénomènes « médiatiques » à l’âge des totalitarismes vainqueurs, chez des penseurs tels que Kracauer, Brecht, Benjamin ou Adorno 8. Il ne suffit donc pas que les peuples soient exposés en général : il faut encore se demander dans chaque cas si la forme d’une telle exposition – cadre, montage, rythme, nar ration, etc. – les enferme (c’est-à-dire les aliène et, en fin de compte, les expose à disparaître) ou bien les désenclave (les libère en les exposant à comparaître, les gratifiant ainsi d’une puissance propre d’apparition). Le peuple imaginaire « Le cinéma », écrivait Edgar Morin, « nous donne à voir le processus de péné tration de l’homme dans le monde et le processus inséparable de pénétration du monde dans l’homme » en un point précis, en un plan de charnière dialectique qui fait office d’opérateur de conversion. Or, ce plan n’est autre que l’image même, l’image en tant qu’elle « n’est pas seulement la plaque tournante entre le réel et l’imaginaire, [mais encore] l’acte constitutif radical et simultané du réel et de l’imaginaire 9. » Si l’homme du cinéma est bien, alors, cet homme imaginaire que suggère Edgar Morin, ce n’est surtout pas pour qu’on aille y diagnostiquer seu lement l’homme de la fuite et de l’illusion, l’homme de l’irréel et de la mécon naissance, l’homme de l’apolitisme et de l’indifférence au monde. Quand le groupe des ouvriers Lumière sortirent de leur atelier et s’agitèrent en plein jour, plus grands que nature sur l’écran de projection, devant le groupe sidéré des spectateurs bourgeois de la rue de Rennes, c’était peut-être d’une rencontre politique qu’il s’agissait déjà, rencontre suscitée par l’image et non coupée du réel, puisque mettant en relation – et pour la longue durée du développement social du cinéma – les ouvriers et les cadres ou les clients d’une même industrie naissante. ___________________________ 6 Cf. J.-L. Leutrat, « Modernité. Modernité ? », Lumière, le cinéma, Lyon, Institut Lumière, 1992, p. 64-70. 7 Cf. P. Sorlin, « Foule actrice ou foule-objet ? Les leçons du premier cinéma », L’Image. Études, documents, débats, n° 1, 1995, p. 63-74. 8 Cf. M. Girard, « Kracauer, Adorno, Benjamin : le cinéma, écueil ou étincelle révolutionnaire de la masse ? », Lignes, N. S., n° 11, 2003, p. 208-225. 9 E. Morin, Le Cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie sociologique, Paris, Minuit, 1956 (éd. 1977), p. IX et 208. [ 10 ] Jean Louis Schefer, dans ce qui demeure peut-être son plus beau livre, a esquissé une poétique, presque une métapsychologie, de cet « homme imaginaire » en lui donnant pour nom l’homme ordinaire, l’« homme sans qualités » du cinéma. Là même où notre solitude devant l’image devient – par le biais de la peur, selon Schefer – consistance d’un corps social dont notre solitude uploads/Industriel/ didi-huberman-figurant.pdf
Documents similaires










-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 24, 2022
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2138MB