99 99 ,TRAVAUX ET DOCUMENTS DE L’ORSTOM No 148 AINSI PARLAIENT NOS ANCÊTRES....
99 99 ,TRAVAUX ET DOCUMENTS DE L’ORSTOM No 148 AINSI PARLAIENT NOS ANCÊTRES.... ESSAI D’ETHNOHISTOIRE WAYAPI Pierre GR ENA ND ORSTOM -PARIS - 1982 Cet ouvrage a fait l’objet d’une thèse de 3ème cycle, soutenue en 1980 à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales Directeur de recherche : Madame Simone DREYFUS « La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de I’article 41, d’une « part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non « destinées à une utilisation collective» et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations « dans un but d’exemple et d’illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou « partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est « illicite (alinéa ler de l’article 40). « Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc « une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal». ISBN : 2-7099-0656-2 @ ORSTOM 1982 AVANT-PROPOS Le présent travail est consacré à l'étude ethnohistorique des Waygpi, amer-indiens vivant en Guyane française et en Amapa (Brésil). Ils sont actuellement répartis en onze villages installés sur le fleu- ve Oyapock et les bassins du Jari et de 1'Amapari. L'ethnie est divisée en deux sous-tribus aux dialectes dis- tincts, les Wayapi et les Wayapi-puku. Le premier groupe totalise 379 personnes (dont 366 en Guyane) et le second 190. L'existence de pe- tits groupes non contactés semble en outre de plus en plus certaine. Les Wayapi appartiennent. à la famille linguistique Tupi-' Guarani dont ils constituent, avec les Emerillon, l'avancée la plus septentrionale: La présente thèse se veuf résolument description et analy- se de données pour une large part nouvelles et se refuse à élaborer toute théorie sur l'appréciation de 1'Histoire par les Amérindiens des basses terres, tant nous en sommes encore à l'aube dans ce domaine. Notre prétention, au delà de la subjectivité inévitable qui empêche l'ethnologie de devenir une authentique science naturelle, n'est que de présenter une analyse suffisamment fiable pour être reprise ultérieurement dans des travaux de synthèse. A mon vieil ami Misa, en souvenir des fêtes à eachiri et de nos pêches à S9aXrraspa. PHUNEMES DU WAYAFT CONSONNES P comme le Frangais papa m comme le Français ma t comme le Français ta s comme le Français sa 1 comme le Français la n comme le Français ni Y comme le Français yeux k comme le Français kilo W comme l’Anglais world ng comme l’Anglais camping 7 occlusion glottale:marque une césure pertinente entre deux voyelles: kaa / ka?a Cp&eJCforêtJ VOYELLES i comme le Français lit ï i nasalisé E comme la Français lait E comme le Français lin a comme le Frangais 1s a comme le Français lent i entre le i et le u du z & nasalisé .- Français u comme le Français loup rl /. u nasalisé ’ . 3 comme le Français lotte J comme le Franqais long AVANT-PROPOS t :. PHONEMES DU WAYAPI INTRODUCTION PRELIMINAIRES I- CADRE GEOGRAPHIQUE ET PEUPLBMBNT ACTUEL II - PROBLEMES MSTHODOLOGIQUES III - RECHRRCHES HISTORIQUES SUR LES AMBRINDIENS DE GUYANE LES WAYbI PAR EUX-MEMES 1 - UN PEUPLE ET SA TERRE II - ORGANISATION SOCIO-POLITIQUE DES WAYAPI : Evolution historique III - EVOLUTION DE LA C.IVILISATION WAYÂkI : Ses adaptations IV - LA GUERRE V - L'EQUILIBRE INSTABLE DE LA MAGIE 1 !. '-., I. V L'HISTOIRE DES WAYAPI : Bilan événementiel 1 - PEUPLEMENT DU BASSIN DE L'OYAPOCK ET DES REGIONS ADJACENTES AVANT 1700 II - LES TEMPS ANCIENS III - LA CONQUETE WAYbI 1 9 20 42 50 96 145 205 235 247 259 280 VIII IV - LE DECLIN V - L'ISOLEMENT ET LA SURVIE : Naissance des Waybi contemporains (1840-1940) VI - SITUATION ACTUELLE (1940-1975) CONCLUSION 298 316 347 355 BIBLIOGRAPiIE 392 INTRODUCTION L'exotisme m'intéresse dès lors qu'il me permet de ren- contrer et de contempler des hommes libres. Il ne s'agit pas seule- ment de l'aspect esthétique. des choses qui fait d'eux des symboles vivants de liberté, mais bien de la geste d'une société, telle qu'el- le m'a été insufflée au cours de longues années de vie partagée., L'intérêt majeur que je porte aux Amérindiens et plus particulièrement à ceux de Guyane auxquels ce travail sera consacré, est dû - cela peut paraître une boutade - à leur immense capacité de survie culturelle. Si l'on observe tant soit peu de près l'histoi- re d'une population amérindienne, on est effaré par le poids écra- sant des processus destructeurs, tant politiques que matériels,aux- quels elle a été - et est encore souvent - soumise. On peut,de- vant de telles situations, se demander si nos sociétés seraient porteuses de telles aptitudes à la résistance. Il est donc essentiel, a mon sens, de penser 1'Histoire des Amérindiens comme l'listoire d'une survie et non comme celle d'une décadence car c'est la démarche qui correspond,semble-t-il, le mieux à leur pensée. A partir de cet a.priori, le seul que nous nous permet- tons de poser, nous essaierons de reconstituer le changement des -2- sociétés sans tenir compte de la linéarité assignée au XIXème siècle à l'évolution des groupes humains. Je ne pense pas en effet que les concepts de régression et de progression soient utilisables dans ma perspective,en dépit de leur aptitude à décrire des processus historiques. Dès lors que l'impératif principal est la survie des hommes, les chemins qu'ils choisissent - atomisation ou regroupement, isolement ou alliance stratégique, change- ment de mode de subsistance - ne peuvent être envisagés que du point de vue d'un gain pour la société qui était condamnée à mourir. Par con- tre, dès lors que des hommes, ne recherchant plus de solutions, s'en remettent à d'autres pour leur survie, ils renoncent du même coup à faire perdurer leur société. Bien entendu, à travers ces changements, il s'agira avant tout de mettre l'accent sur les dynamiques ou les stratégies partout où le faisceau des documents permettra autre chose que des conjectures. Il est en conséquence bien clair pour moi, comme pour S. DREPFUS (1976) que l'histoire amérindienne telle qu'elle vient d'être définie suppose une réflexion politique de la société sur elle- même et sur les ethnies qu'elle côtoie Au delà de mes propres polarités, les recherches ethno- historiques en Guyane française me semblent depuis longtemps opportunes et ce, pour plusieurs raisons : -3- - la position géographique est particulière : le pays est une extrêmité (extrêmité des Guyanes ; frontière nord-est du bassin amazonien) qui favorise la convergence de plusieurs civili- sations. - on y trouve une situation écologique de transition avec plusieurs biotopes (forêt de terre ferme, marécages côtiers, sava- nes) ayant conditionné des écosystèmes humains différents. - Il y vit six peuples autochtones totalisant plus de trois mille personnes, répartis entre trois grandes familles lin- guistiques : Karib, Tupi, Arawak. - L'écartèlement des populations indigènes entre trois puissances (France, Hollande puis Surinam, Portugal puis Brésil), a créé une situation politique conflictuelle dont les conséquences sont encore vivantes. La variété des cultures est ainsi prévisible d'entrée de jeu et laisse supposer un puzzle historique pour le moins enrichissant pour l'historien des basses terres d'Amérique tropicale. Le travail que je présente doit donc être considéré comme le premier volet d'une recherche sur l'ensemble des ethnies peuplant ' ou ayant peuplé la Guyane et les régions adjacentes. Il se limite à l'ethnohistoire des Way?ipi, ethnie pour la- quelle je considère posséder une somme de sources écrites et de tradi- .tions orales suffisantes pour réaliser une confrontation fructueuse. L'équilibre entre les deux est à ce point primordial qu'il me semble prématuré de vouloir écrire l'histoire des autres populations de Guyane. -4- Mon choix des WayZpi s'est a posteriori révélé des plus intéressants en ce sens qu'il s'agit de la societé amérindienne de Guya- ne qui a le plus bougé territorialement aux temps modernes et qui, par voie de conséquence, a fait un maximum d'expériences au niveau du contact intertribal. Nous pouvons donc postuler qu'elle nous apportera plus de données que d'autres sociétés pour la reconstitution de l'histoire cultu- relle et événementielle de la région. A partir de là, il est possible de s'assigner un certain nombre d'axes de recherche devant conduire à une bonne connaissance du passé : - définition des ethnies (ethnies vraies, groupes de filiations, etc...), - étude des modifications de l'écosystème au re- gard de la démographie et des évènements. - identification linguistique des ethnies de la région étudiée. - mise en évidence des incidences démographiques sur l'organisation sociale. - description des mécanismes de survie à partir de tactiques opérantes : regroupement, alliance, éclatement et guerre. - appréciation de l'étanchéité des diverses ethnies entre elles : c'est-à-dire mesure de la diffusion culturelle et lin- guistique avec tentative de définition des alluvionnements successifs. - examen du rôle de la communauté en tant qu'unité moderne d'impulsion culturelle et politique. Ces axes ne constituent pas le plan du présent travail, mais seront des points de repère que le lecteur retrnwera? c11aque -5- chapitre. uploads/Industriel/ ainsi-parlaient-nos-ancetres.pdf
Documents similaires




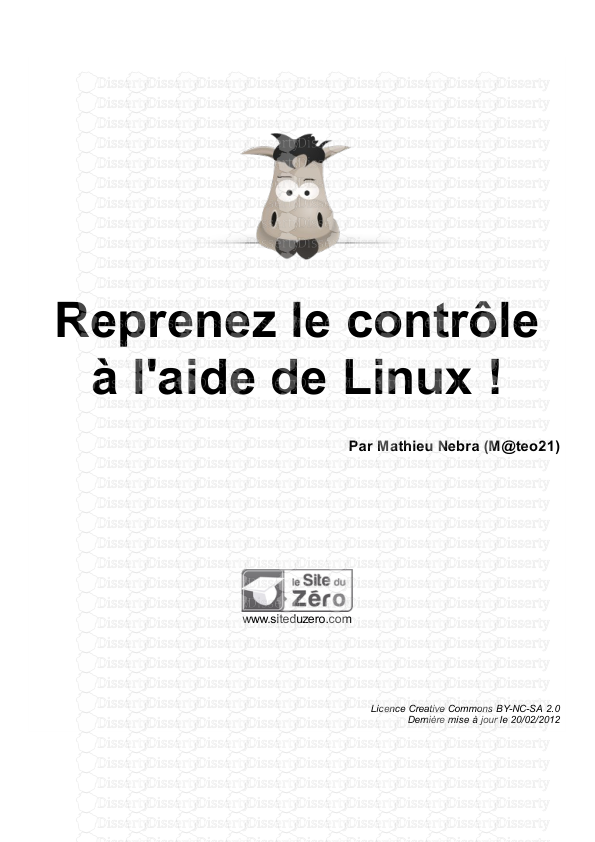




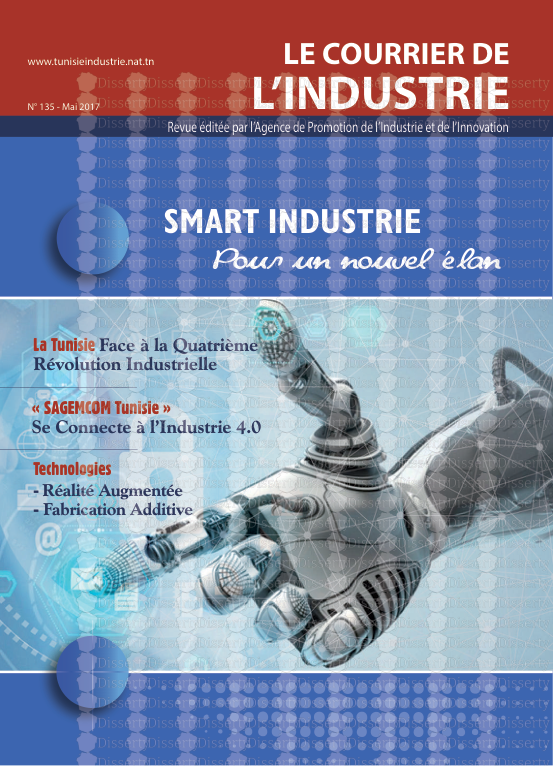
-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 05, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 18.2499MB


