Tiers-Monde Industrialisation et développement : la crise des paradigmes Claude
Tiers-Monde Industrialisation et développement : la crise des paradigmes Claude Courlet, Pierre Judet Citer ce document / Cite this document : Courlet Claude, Judet Pierre. Industrialisation et développement : la crise des paradigmes. In: Tiers-Monde, tome 27, n°107, 1986. La nouvelle industrialisation du Tiers Monde. pp. 519-536; doi : https://doi.org/10.3406/tiers.1986.4394 https://www.persee.fr/doc/tiers_0040-7356_1986_num_27_107_4394 Fichier pdf généré le 01/04/2019 INDUSTRIALISATION ET DÉVELOPPEMENT : LA CRISE DES PARADIGMES par Claude Courlet* et Pierre Judet** INTRODUCTION : LE TEMPS DU DOUTE Depuis une quarantaine d'années, l'industrialisation et le développement des pays du Tiers Monde étaient devenus des centres d'intérêt de l'analyse économique. Au fil des années, les analyses proposées s'étaient organisées autour de deux courants de pensée principaux. Pour les uns, le phénomène du sous-développement était l'expression d'un simple retard. Afin de combler ce retard, il s'agissait de mettre en œuvre des politiques de rattrapage, grâce à une insertion progressive dans les réseaux porteurs du capitalisme mondial. La théorie des étapes de la croissance relevait de cette école ainsi que les théories du développement dualiste. Pour les seconds, le sous-développement était le produit historique de l'industrialisation et du développement des pays capitalistes avancés. Ce courant, d'inspiration d'abord plus humaniste avec Myrdal, Hir- schman, Perroux, etc., s'était ensuite radicalise avec les théories néomarxiennes du développement, avec les théories « centre-périphérie », en particulier avec la théorie de la dépendance. Mais, au cours de ces dernières années, on constate que les clivages s'estompent, que les certitudes s'affaiblissent et que des retournements brusques mettent à mal la belle simplicité des classifications. Un des vétérans parmi les spécialistes de l'industrialisation et du développement, A. O. Hirschmann, note le caractère artificiel de l'affrontement entre les deux positions. Il remarque, en effet, l'étrange conver- * Maître-assistant à l'iREP-Développement de l'Université des Sciences sociales de Grenoble. ** Professeur associé, directeur de l'iREP-Développement. Revue Tiers Monde, t. XXVII, n° 107, Juillet-Septembre 1986 52О CL. COURLET ET P. JUDET gence qui s'établit entre tenants du néo-classicisme et fidèles des différentes écoles néo-marxiennes, à travers les critiques formulées par les uns comme par les autres à propos de l'industrialisation en Amérique latine. Hirschmann se réfère également1 à la phrase célèbre de Marx dans sa préface au Capital, selon laquelle : « Le pays le plus développé industriellement ne fait que montrer à ceux qui le suivent sur l'échelle industrielle l'image de leur propre avenir »2. Ce qui permettrait de classer Marx parmi les théoriciens des étapes de la croissance. Dans une contribution récente, A. Lipietz proclame avec éclat que le temps est venu des retournements contradictoires et de la confusion : « Voici l'heure où les schémas, en volant en éclats, autorisent tous les reniements... Voilà que ceux qui "comptaient sur leurs propres forces" ouvrent leurs portes aux firmes transnationales... Voici le temps où tout se brouille, où l'ennemi devient une abstraction, où les malédictions se réduisent et les miracles s'effondrent »3. Depuis 1978, la Chine des successeurs de Mao ne se contente pas de démanteler les communes populaires pour revenir, dans l'agriculture, à la petite exploitation familiale; elle met en cause de plein fouet le modèle d'industrialisation et de développement hérité de l'Union soviétique : « L'expérience de nombreux pays développés a prouvé que le développement de l'industrie lourde suppose le développement préalable de l'agriculture et de l'industrie légère... Certains prétendent que telle est précisément la voie capitaliste d'industrialisation. Mais cette opinion ne correspond pas nécessairement à la réalité... En fait, c'est après que l'industrie légère ait atteint un certain niveau de développement que peut prendre place le développement de l'industrie des machines, laquelle constitue la composante la plus importante de l'industrie lourde »4. Ce disant, l'économiste chinois se réfère à Marx ainsi qu'à l'histoire de l'industrialisation anglaise, où l'essor de l'industrie textile a précédé de plusieurs décennies le développement de l'industrie des machines. Tout cela indique que, plus ou moins bruyamment, on prend conscience du caractère « douillet mais simplificateur » (Hirschmann, op. cit.), des orthodoxies et de leurs cohérences. Cohérences et convergences qu'il est utile de situer d'abord, de confronter ensuite avec les réalités 1. Albert O. Hirschmann, L'économie comme science morale et politique, Hautes Etudes, Gallimard, Le Seuil, 1984. 2. Paris, Gallimard, « Bibliothèque de La Pléiade », t. I, p. 549. 3. A. Lipietz, Mirages et Miracles. Problèmes de l'industrialisation dans te Tiers Monde, Ed. La Découverte, 1985, p. 5 et 6. 4. Ma Hong, New Strategy for China's Economy, New World Press, Peijing, 1983, p. 82-83, traduit de l'anglais. LA CRISE DES PARADIGMES 5 21 tant historiques que contemporaines avant de s'interroger sur les voies ouvertes ou à ouvrir dans le domaine de l'industrialisation et du développement. I. — Analyse traditionnelle et convergences La reconstruction des pays dévastés par la seconde guerre mondiale5, l'industrialisation et le développement du Tiers Monde, l'établissement d'un nouvel ordre économique international ont suscité la multiplication de recherches et d'analyses qui ont progressivement constitué un ensemble aujourd'hui appelé : théories du sous-développement. Selon ces analyses, l'augmentation de la productivité, et en conséquence de la prospérité, exige l'introduction de technologies modernes ; l'investissement joue un rôle primordial dans la construction des infrastructures et de l'industrie; l'urbanisation accompagne l'entreprise de modernisation et d'industrialisation. Ces analyses se réfèrent étroitement à l'histoire économique des pays occidentaux et, en particulier, à l'histoire de la révolution industrielle. Au-delà de ce schéma général, un certain nombre de traits communs, importants pour la compréhension de ces analyses, se détachent. ha notion de rupture L'industrialisation et le développement sont en effet souvent présentés comme une rupture douloureuse ou comme un scandale6. Si, au cours des périodes successives de l'histoire, certaines sociétés ont émergé, alors que d'autres ont continué à stagner, c'est qu'ici une étincelle a jailli soudain, tandis que là rien ne s'est passé. Par ailleurs, le retard et les handicaps accumulés par les pays sous- développés sont tels qu'une évidence s'impose : ces pays ne s'engageront dans la voie de l'industrialisation qu'au prix d'un effort, à la fois conscient, massif et dirigé. Pour qualifier un tel effort, les métaphores se sont multipliées, ce qui a donné par exemple : — le « coup de rein » ou bigpusch de Rosenstein-Rodan ; — le « décollage » ou take-off de Rostow; — le « grand rush » ou Spurt de Gerschenkron ; 5. The industrialisation of Backward Areas qui est l'œuvre de K. Mandelbaum, Basil Black- well Oxford, 1945, a été écrit pendant la guerre dans la perspective de la reconstruction des pays du sud et de l'est de l'Europe. 6. Jacques Austruy, L.e scandale du développement, Ed. Marcel Rivière et Cie, 1965. 522 CL. COURLET ET P. JUDET — le seuil critique de Leibenstein; — les effets de liaison en amont et en aval : backward zná forward linkages de Hirschmann; — les effets de dimension et d'entraînement liés aux notions d'industrie motrice et de pôle de croissance de F. Perroux. Ces expressions vigoureuses ont été choisies pour traduire le changement de dimensions et de perspectives qui accompagne nécessairement l'industrialisation et le développement. C'est un changement de nature, c'est un bouleversement des structures, c'est un véritable arrachement, qui ne peut s'accommoder d'une simple succession de petites modifications. On comprend, dans ces conditions, que l'industrialisation ait été parfois menée à la manière dont on relève un défi ou dont on conduit une bataille : dans la foulée des indépendances politiques, l'industrialisation est devenue une affaire d'Etat, avec un caractère d'urgence militante et presque militaire. Dans cette perspective, les analyses privilégient une image statique des sociétés « agraires », « paysannes » ou « traditionnelles », qui sont, la plupart du temps, présentées comme un repoussoir contradictoire avec le dynamisme de la société industrielle moderne. Il en découle : — qu'on peut faire l'économie de l'étude des origines historiques de la révolution industrielle; — qu'il est inutile de perdre son temps à s'interroger sur les secteurs traditionnels ou informels dans les pays en voie de développement, dans la mesure où ces secteurs sont enfoncés dans la stagnation et dans la routine; — que la paysannerie, qui constitue la plus grande partie de la société préindustrielle, est présentée comme essentiellement passive et qu'elle est, de ce fait, considérée comme un obstacle à contourner ou à détruire (cf. le modèle d'industrialisation soviétique), sauf à l'absorber (cf. les modèles de développement dualistes). U industrialisation comme trajectoire Une fois l'industrialisation lancée, on est en présence d'une évolution réductible à un mouvement susceptible d'être décrit en termes de trajectoire. Pour définir (et calculer) cette trajectoire, il est nécessaire de connaître la loi qui la régit et qui organise le passage d'un état (ou structure) instantané à l'autre (n'importe lequel). La trajectoire se déploie d'état en état, de structure en structure. LA CRISE DES PARADIGMES 523 Les séquences d'industrialisation dérivée Dans l'optique libérale, l'idée de trajectoire correspond, par exemple, à la théorie des étapes de la croissance. Elle correspond également à la remontée préconisée par le modèle de substitution à l'importation, ou encore au modèle d'industrialisation reposant sur l'organisation à l'échelle mondiale des exportations de produits manufacturés. -Lč modèle d'industrialisation par uploads/Industriel/ courlet-claude-judet-pierre-industrialisation-et-developpement-la-crise-des-paradigmes.pdf
Documents similaires



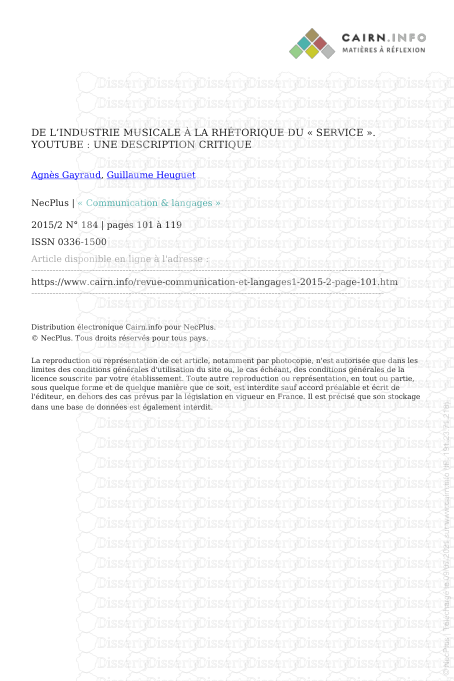






-
140
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 14, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 1.3130MB


