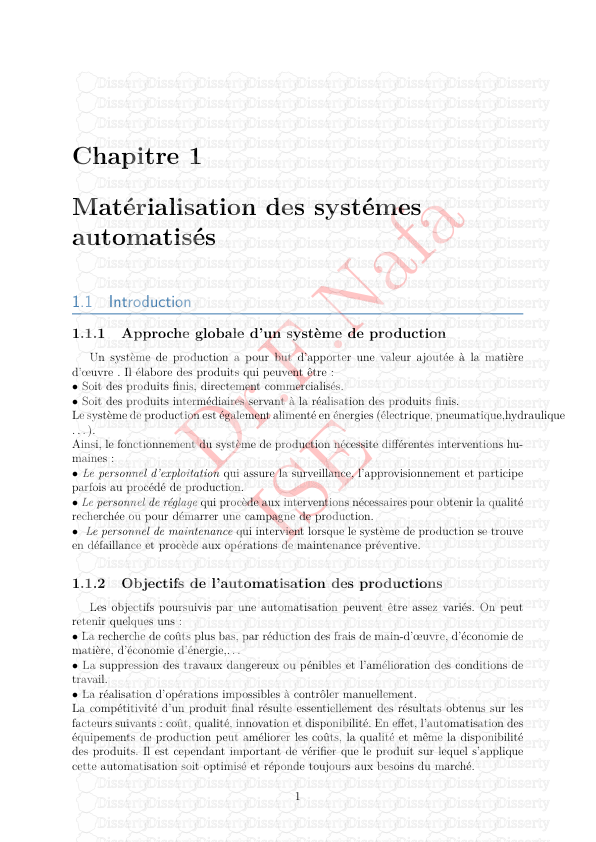Dr.F.Nafa ISE Chapitre 1 Matérialisation des systémes automatisés 1.1 Introduct
Dr.F.Nafa ISE Chapitre 1 Matérialisation des systémes automatisés 1.1 Introduction 1.1.1 Approche globale d’un système de production Un système de production a pour but d’apporter une valeur ajoutée à la matière d’œuvre . Il élabore des produits qui peuvent être : • Soit des produits finis, directement commercialisés. • Soit des produits intermédiaires servant à la réalisation des produits finis. Le système de production est également alimenté en énergies (électrique, pneumatique,hydraulique . . . ). Ainsi, le fonctionnement du système de production nécessite différentes interventions hu- maines : • Le personnel d’exploitation qui assure la surveillance, l’approvisionnement et participe parfois au procédé de production. • Le personnel de réglage qui procède aux interventions nécessaires pour obtenir la qualité recherchée ou pour démarrer une campagne de production. • Le personnel de maintenance qui intervient lorsque le système de production se trouve en défaillance et procède aux opérations de maintenance préventive. 1.1.2 Objectifs de l’automatisation des productions Les objectifs poursuivis par une automatisation peuvent être assez variés. On peut retenir quelques uns : • La recherche de coûts plus bas, par réduction des frais de main-d’œuvre, d’économie de matière, d’économie d’énergie,. . . • La suppression des travaux dangereux ou pénibles et l’amélioration des conditions de travail. • La réalisation d’opérations impossibles à contrôler manuellement. La compétitivité d’un produit final résulte essentiellement des résultats obtenus sur les facteurs suivants : coût, qualité, innovation et disponibilité. En effet, l’automatisation des équipements de production peut améliorer les coûts, la qualité et même la disponibilité des produits. Il est cependant important de vérifier que le produit sur lequel s’applique cette automatisation soit optimisé et réponde toujours aux besoins du marché. 1 Dr.F.Nafa ISE MATÉRIALISATION DES SYSTÉMES AUTOMATISÉS 2 L’expérience montre qu’une automatisation conduit souvent à remettre en cause le pro- cessus de fabrication et donc le produit. Figure 1.1 – Les objectfis de l’automatisation 1.2 Le cahier des charges Définition 1.1 Le cahier des charges est un document où sont spécifiées toutes les fonctions, toutes les valeurs des grandeurs physiques et tous les modes d’utilisation du matériel pour permettre la production du produit final. 1.2.1 Niveaux de description du matériel 1.2.1.1 Spécifications fonctionnelles Correspond aux spécifications fonctionnelles qui décrivent l’automatisme indépendam- ment de la technique utilisée (pneumatique,hydraulique , électrique). Ces spécifications peuvent permettre au concepteur d’en comprendre le rôle, de définir les actions à réaliser et leur enchaînement séquentiel. 1.2.1.2 Spécifications techniques ou opérationnelles Les spécifications techniques énumèrent les caractéristiques physiques des capteurs et des actionneurs, les conditions d’environnement et les conditions pour assurer la sécurité de fonctionnement de l’automatisme. Les spécifications opérationnelles assurent l’optimi- sation de l’exploitation du process (modes de marche et d’arrêt, maintenabilité, absence de pannes dangereuses). 1.2.1.3 Documentation à propos de l’utilisation il concerne (câblage, programmation), de l’entretien et du dépannage du matériel. cette documentation doit être à jour. 1.2.1.4 Niveaux supérieurs Ils concernent les clauses juridiques, le service après-vente, les garanties, les conditions financières... Dr.F.Nafa ISE MATÉRIALISATION DES SYSTÉMES AUTOMATISÉS 3 1.2.2 Architecture des systèmes de production On distingue cinq mode d’architecture de production comme suit : Machines autonomes Chaque machine réalise une étape dans l’élaboration du produit. La manutention entre machine, les chargements et déchargements sont nombreux, coûteux et longs. Ils sont le plus souvent manuels Machines associées en ligne Le produit passe automatiquement d’une machine à la suivante. Dans ce cas simple, c’est le transfert du produit lui-même qui assure la liaison entre les machines. Cellule de production à Commande centralisée La nécessité de coordonner l’action des machines a d’abord conduit à centraliser leurs commandes, ce qui par ailleurs a compliqué les interventions locales de réglage et de dépannage. Cellule à commande décentralisée et coordonnée Un retour aux commandes décentralisées s’est imposé, mais avec une coordination entre machines ici assurée par liaisons inter niveaux. Cellule flexible à commande répartie et hiérarchisée Le besoin de flexibilité conduit à prévoir des transferts libres de produits de machine à machine : une machine donnée peut traiter ou non le produit présenté. Les liaisons iso-niveau complètent les liaisons inter- niveaux qui assurent la communication avec la supervision. Figure 1.2 – L’architecture des systémes de production Dr.F.Nafa ISE MATÉRIALISATION DES SYSTÉMES AUTOMATISÉS 4 1.3 La notion d’un système automatisé 1.3.1 Structure d’un système automatisé S.A Chaque système automatisé comporte deux parties principales : Une partie opérative (P.O) : procédant au traitement des matières d’œuvre afin d’éla- borer la valeur ajoutée ; c’est la partie opérationnelle du système qui effectue les opéra- tions. Elle est constituée d’actionneurs tels que vérins, moteurs. . . utilisant de l’énergie électrique, pneumatique,hydraulique ... Figure 1.3 – Le principe de base d’un systéme automatisé Une partie commande (P.C.) : coordonnant la succession des actions sur la Partie Opérative avec la finalité d’obtenir cette valeur ajoutée. Une partie interface (P.I) : est la partie se trouvant entre les deux faces PO et PC Traduisant les ordres et les informations. La structure simplifiée d’un ensemble automatisé peut se décomposer en trois parties Figure 1.4 – La structure d’un systéme automatisé essentielles : Les entrées, parfois analogiques ou digitales, destinées à fournir des informations sur l’état du processus : fin de course, détecteur de niveau, pressostat, thermostat, etc. L’automate qui traite les différentes informations d’entrée afin d’élaborer les ordres. Les sorties transmettant les ordres élaborés par l’automate , aux différents actionneurs ou pré- actionneurs : voyants, distributeurs de vérins, contacteurs de moteur,. . . . . . Selon sa complexité, la réalisation de la partie commande (PC) fait appel à diverses tech- niques dont les plus couramment utilisées sont : Logique câblée : qui inclut les relais électromécaniques, les relais statiques électroniques et les relais pneumatiques. Logique programmée : L’automate programmable et les cartes électroniques à base d’un microcontrôleur. A partir d’une certaine, complexité, les relais électromécaniques et les relais statiques deviennent lourds à mettre en œuvre et le cout de l’automatisation est difficile à estimer. Dr.F.Nafa ISE MATÉRIALISATION DES SYSTÉMES AUTOMATISÉS 5 L’automate programmable évite de faire appel à l’ordinateur qui, lui a souvent des perfor- mances trop élevées pour le problème à résoudre et demande un personnel spécialisé. Par- ticulièrement bien adaptés aux problèmes de commande séquentielle et d’acquisition des données, les API autorisent la réalisation aisée d’automatismes comprenant de quelques dizaines jusqu’à plusieurs milliers d’entrées/sorties. 1.3.2 Les Eléments de la P.O. et de la P.C Diagramme fonctionnel Exemples Commentaires Fraise, Foret, Mors d’étau, pince de ro- bot. . . . Les effecteurs sont multiples et variés et sont souvent conçus spécialement pour s’adapter à l’opération qu’ils ont à réali- ser sur la Matière d’œuvre. Ils reçoivent leur énergie des actionneurs Moteurs, vérins, ... Convertissent l’énergie qu’ils reçoivent des pré-actionneurs en une autre éner- gie utilisée par les effecteurs. Ils peuvent être Pneumatiques, Hydrauliques ou Elec- triques Distributeurs, contacteurs, relais ... Distribuent l’énergie aux actionneurs à partir des ordres émis par la PC. Il consti- tue l’interface entre l’actionneur et la par- tie de traitement. Fin de course, température, pression,... Renseignent la PC sur l’état de la PO, Ils peuvent détecter des positions, des pres- sions, des températures, des débits. . . Ils peuvent être électriques ou pneumatiques. Signaux du type TOR, Analogique ou Nu- mérique. API Dans les systèmes modernes, l’API assure de plus en plus cette fonction. Certains systèmes purement pneumatiques peuvent être contrôlés par des séquenceurs ou des fonctions logiques. HMI, afficheur, .... L’unité de dialogue permet à l’opérateur d’envoyer des consignes à l’unité de trai- tement et de recevoir de celle-ci des infor- mations sur le déroulement du processus. 1.4 Les technologies utilisées en automatisation Dans un systéme automatisé, on utilise plusieurs technologies pour mesurer, détecter et actionner. Ces technologies, au nombre de quatre, sont les suivantes : Technologie pneumatique ; Technologie hydraulique ; Technologie électromécanique ; Technologie électronique. Dr.F.Nafa ISE MATÉRIALISATION DES SYSTÉMES AUTOMATISÉS 6 Chacune des technologies met en œuvre une grandeur physique que l’on peut commuter et mesurer. Dans le cas des technologies pneumatique et hydraulique, la grandeur physique sera une pression d’air ou d’huile. La technologie électromécanique utilise le courant électrique. Enfin, la technologie électronique travaille avec une différence de potentiel avec la masse. Ces grandeurs physiques sont utilisées de façon binaire ou analogique. Dans le cas binaire, Il est assumé que le niveau logique est 0 en l’absence de grandeur physique et 1 en présence de cette grandeur. La technique d’automatisation à base de la norme DIN 19223 définit un automate comme un système artificiel qui, en combinant des entrées aux divers états du système, prend des décisions en vue d’obtenir les résultats précisément attendus. Les processus automatiques actuels nécessitent trois composants : • Des capteurs pour la détection des états du système, • Des actionneurs qui exécutent les instructions de commande, • Des commandes qui gèrent le déroulement du programme et la prise de décision Figure 1.5 – La structure de base de l’automatisme 1.5 La Technologie pneumatique Les technologies hydraulique et pneumatique ont des champs d’application qui dif- fèrent par les propriétés du fluide sous pression qu’elles utilisent : un liquide pratiquement incompressible pour l’hydraulique, un gaz très compressible uploads/Industriel/ api-chapitre1.pdf
Documents similaires









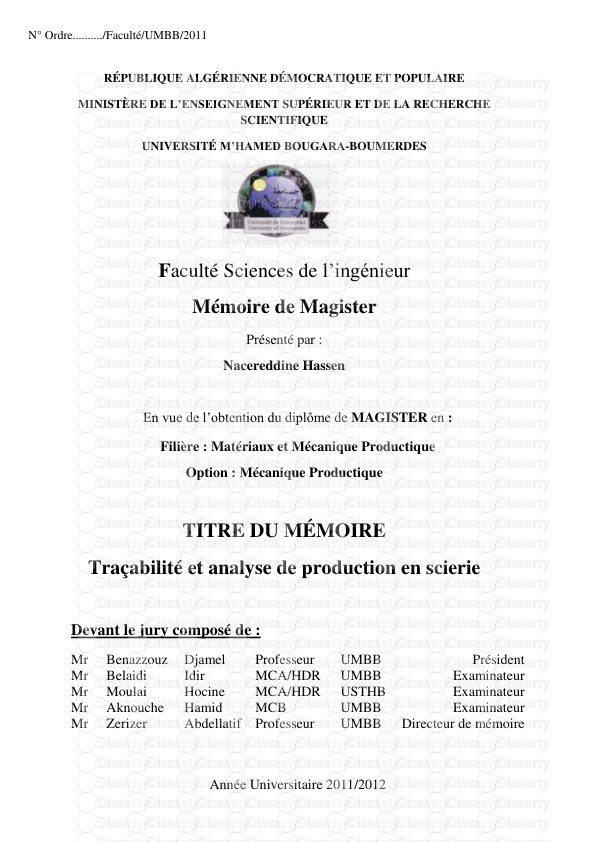
-
48
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 06, 2021
- Catégorie Industry / Industr...
- Langue French
- Taille du fichier 1.9941MB