Un antibiogramme avec des produits de substitution mercredi 21 décembre 2011, p
Un antibiogramme avec des produits de substitution mercredi 21 décembre 2011, par Bruno Boucher Liaison avec le programme Niveau concerné : 1ère S Partie du programme : Thème 3 : corps humain et santé - 3B – Variation génétique et santé Sous-partie 3-B-c : Variation génétique bactérienne et résistance aux antibiotiques Des mutations spontanées provoquent une variation génétique dans les populations de bactéries. Parmi ces variations, certaines font apparaître des résistances aux antibiotiques Pratiquer une démarche scientifique. Manipuler et expérimenter. Concevoir et mettre en place un protocole permettant de montrer la sensibilité de microorganismes à différents antibiotiques. Recenser, extraire et organiser des informations pour : identifier la sensibilité ou la résistance de microorganismes à différents antibiotiques, calculer le taux d’apparition de résistances dans une population. Problème à résoudre Comment identifier une souche résistante ? Comment expliquer son apparition ? Pourquoi des produits de substitution ? Deux raisons à cela : la manipulation de souches de microorganismes ne doit se faire que dans des conditions bien contrôlées. Or tous les laboratoires de lycée ne sont pas formés et/ou équipés pour exercer ce contrôle, en particulier pour la destruction des souches après manipulation, l’exposition à des antibiotiques contribue au développement de souches résistantes (c’est ce que le programme demande de montrer). Il y en a bien assez comme cela sans que toutes les 1ères S de tous les lycées de France exposent des bactéries à des antibiotiques. On pourra d’ailleurs après coup discuter avec la classe des raisons qui ont amené l’enseignant à choisir des produits de substitution plutôt que de vraies souches de bactéries et de vrais antibiotiques. Deux avantages supplémentaires par rapport à la réalisation d’un antibiogramme, en plus de la sécurité : le coût, le temps : le résultat est visible au bout de seulement quelques minutes. Protocole de substitution Ce protocole est adapté à partir de celui proposé sur le site e-Bug dans la partie collège (sur lequel se trouve aussi une activité ludique sur la transmission des IST) Principe Un indicateur coloré sensible au pH remplace les bactéries. De l’acide chlorhydrique remplace l’antibiotique. Matériel : Boîtes de Pétri (le nombre dépend de la construction de la séance) Acide chlorhydrique Marqueur Gélose (agar) Tubes à essai Pinces fines Portoirs Pastilles de papier filtre (préparées par exemple avec un perforateur de bureau sur du papier filtre plié pour avoir plus d’épaisseur) Rouge phénol à 2-4% Préparation des boîtes de gélose (agar) 1. Préparer la gélose (agar) selon les instructions du fabricant. 2. Lorsqu’il est légèrement refroidi, mais pas encore solidifié, verser dans une boîte (pour pouvoir montrer aux élèves la couleur indiquant l’absence de croissance bactérienne). 3. Ajouter ensuite suffisamment ( 10 gouttes) de rouge phénol à 2-4% pour que l’agar prenne une couleur rouge orangée (représentant la croissance bactérienne) et bien mélanger. 4. Verser dans chaque boîte de Pétri et laisser refroidir. A la place du rouge phénol, on peut utiliser de la phénolphtaléine : 2,5g pour 100mL d’éthanol 95° additionné de rouge Congo. Manipulation élèves : Les élèves disposent de tubes à essais portant le nom de différents antibiotiques et contenant en réalité de l’acide chlorhydrique (5%) ou de l’eau. Avec la pince fine, une pastille de papier filtre est trempée dans un des tubes à essai puis déposé sur la gélose en suivant le schéma ci-dessous : Le protocole initial du site e-bug propose de trouer la gélose à l’emporte pièce et de déposer l’antibiotique/HCl avec une pipette compte-gouttes (un peu comme dans le protocole d’Ouchterlony). Nous proposons de déposer une pastille de papier filtre imbibée d’HCl pour que le geste se rapproche davantage de la réalisation d’un véritable antibiogramme. Mise en situation et place dans la démarche 1ère proposition : mettre l’élève en situation de choix de traitement de patients. Chaque boîte correspond à un patient et il faut par l’antibiogramme déterminer quel traitement sera efficace, c’est à dire à quel(s) antibiotique(s) la bactérie résiste ou non. Chaque binôme pourra avoir un patient différent. Il suffit de changer ce qui est noté sur les tubes avec HCl ou avec l’eau selon le cas. On est ici au début de la démarche, dans l’observation d’un phénomène (l’apparition de résistances aux antibiotiques) qu’il s’agira d’expliquer. 2ème proposition (adaptée à partir du livre de 1ère S Belin) : mettre l’élève en situation de vérification de l’hypothèse qu’il s’est produit une ou des mutations qui sont à l’origine des résistances aux antibiotiques. Les résistances doivent donc apparaître aléatoirement au fil des générations successives. L’expérience est la suivante : on prend une souche de bactérie non résistante. Une partie est congelée pour conservation. Le reste est divisé en plusieurs lots (un par binôme) qu’on laisse se multiplier. Le jour du TP on teste la résistance aux antibiotiques des différents lots pour voir si des résistances sont apparues. On fait aussi le test sur la souche initiale, décongelée. Le binôme chargé de la souche initiale aura de l’HCl dans tous ses tubes : la souche est sensible à tous les antibiotiques. Pour les autres binômes, un ou plusieurs tubes contiendront de l’eau pour montrer l’apparition d’une résistance. La concentration en HCl pourra être différente (par exemple un tube à 5% et un autre à 0,5%), ce qui laissera une tache plus ou moins large, montrant une sensibilité plus ou moins grande. Pour illustrer le caractère aléatoire de la mutation et donc de l’apparition de la résistance, certains binômes pourront avoir des souches restées sensibles à tous les antibiotiques. La résistance apparue ne sera pas la même pour tous les binômes. On est ici dans le test d’une hypothèse. La résistance aux antibiotiques a déjà été défini et on cherche à valider l’explication donnée (apparition par mutation). Exemples de boîtes obtenues Prolongements on peut utiliser différentes concentrations en HCl qui laisseront une décoloration plus ou moins étendue sur la gélose, témoignant d’une sensibilité plus ou moins grande des bactéries à l’antibiotique. Une capture d’image permettra la mesure du diamètre de chaque zone dans le logiciel Mesurim, par une mesure de surface. Utilisation de Rastop et Anagène : fichier montrant la céfotaxime sur la betalactamase fichier .edi donnant la séquence du gène de la betalactamase d’une souche d’E. Coli sensible et d’une souche résistante à la céfotaxime. Sources : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pour les séquences génétiques http://www.pdb.org/pdb/home/home.do pour les structures spatiales Voir aussi : Mettre en œuvre un protocole pour déterminer le taux de mutation chez E. Coli F. Redon, B. Boucher Annexes associées à cet article : fichiers (Zip – 23.1 ko) L'antibiogramme par diffusion en milieu gélosé Principe général : L'antibiotique est présent en quantité connue dans un disque de papier filtre. Lorsque le disque est déposé à la surface du milieu de culture, l'antibiotique diffuse en créant un gradient de concentration. Diffusion de l'antibiotique dans le milieu de culture. La création du gradiant de concentration est visualisé par le dégradé d couleur. Diffusion en milieu gélosé (vue de côté) Diffusion en milieu gélosé (vue de dessus) Voir cette animation en plein écran ou la télécharger : vue de côté.swf Voir cette animation en plein écran ou la télécharger : vue de dessu.swf La bactérie ensemencée sur ce milieu va entrer en contact avec des concentrations variables d'antibiotique. Pour une concentration en antibiotique supérieure à la CMI sa croissance sera donc arrêtée. L'inhibition se traduira donc par une zone circulaire où il n'y a pas de croissance visible (absence de colonies). Le diamètre de cette zone est proportionnel à la sensibilité de la souche vis à vis de cet antibiotique. Réalisation La technique doit être standardisée milieu: Muller-Hinton de 4 mm d'épaisseur disque d'antibiotique : papier filtre contenant une concentration précise d'antibiotique. inoculum : souche pure de 18 heures. Concentration de l'ordre de 500 000UFC par mL temps de préincubation : il faut laisser le temps à l'antibiotique de diffuser avant de permettre aux germes de se multiplier. Voir cette animation en plein écran ou la télécharger "vue de dessu dev.swf " Lecture et interprétation La lecture est effectué à l'aide d'abaques. Chaque antibiotique dispose d'un abaque qui présente le rapport entre le diamètre de la zone d'inhibition de culture autour du disque et la concentration de l'antibiotique. L'abaque permet : - d'évaluer la CMI ; - de conclure sur l'efficacité potentielle de l'antibiotique lors d'un traitement. Pour cela il faut comparer la CMI aux concentrations critiques fournies par l'abaque. Concentration critique : concentration critique inférieure c : taux sanguin moyen obtenu aux posologies habituelles. concentration critique supérieure C : taux sanguin maximal obtenu aux posologies habituelles. Ces concentrations permettent de définir les catégories : sensible, intermédiaire et résistant : sensible: la CMI de l’antibiotique pour le germe étudié est plus faible que la concentration critique inférieure (CMI<CCI). Cet antibiotique peut être utilisé pour éliminer in vivo ce germe. germe de sensibilité intermédiaire : la CMI est comprise entre les deux concentrations critiques (CCI<CMI<CCS) germe résistant : la CMI est uploads/Geographie/ un-antibiogramme-avec-des-produits-de-substitution.pdf
Documents similaires




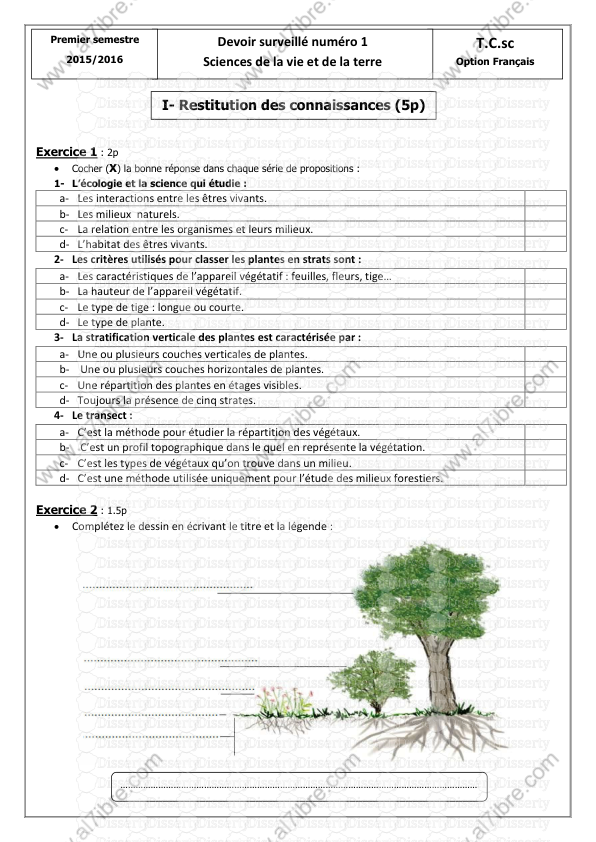





-
38
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 22, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.4623MB


