République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de L’Enseignement Sup
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université d’Oran. ES-Senia Faculté des Lettres, des Arts et des Langues Etrangères Département des Langues Latines et Romanes Thèse de Magister Intitulée Présentée par : M. SAYAD Abdelkader Membres du jury : Président du jury : Mme Sari Fawzia Encadreur : Mme Lalaoui Fatima Zohra Examinateur : Mme Ouhibi Ghassoul Bahia Année universitaire : 2004-2005 1 «A madame Saâidoun Kheira 2 Remerciements : A Madame Lalaoui Fatima Zohra, directrice de thèse, sans qui ce travail n¶aurait jamais vu le jour. Nos remerciements s¶adressent également à Madame SARI et Madame OUHIBI, qui n¶ont ménagé aucun effort pour nous assister tout au long de notre cursus. Nous remercions également Monsieur Charles BONN et toute O¶équipe de l¶université Lumière Lyon II. 3 Liste des abréviations : -A : acteur. -Arg : argument. -Aspec : Aspectualisation. -Dcé : discours cité. -Dct : discours citant. -D.D : discours direct. -D.I : discours indirect. -D.I.L : dicours indirect libre. -E. I : l’étage invisible. -Loc : localisation. -M : moment. -Part : partie. -P. D ass : opération (ou Macro proposition) d’assimilation. -P. D : Macro proposition descriptive. -p. d : micro proposition descriptive. -P. Expli : Macro proposition explicative. -PN : programme narratif. -propr : propriété. -refor : reformulation. -séq : séquence. -Sit : situation. 4 Introduction générale 5 0.1 Choix du texte : Il va sans dire que la littérature tunisienne est essentiellement écrite en langue Arabe. Cet état de fait n'exclut pas, pour autant, l'existence d'une littérature tunisienne d'expression Française qui demeure assez modeste, et ce malgré le grand apport de deux auteurs d'origine Israélite, en l'occurrence Claude Benabi et Albert Memmi, qui ont commencé à publier en Tunisie avant son indépendance, et continuent à écrire en France jusqu'à nos jours. Sans oublier toute une pléiade de jeunes écrivains talentueux qui ont donné, en quelque sorte, un nouvel élan à cette littérature, mais qui restent, à quelques rares exceptions près, méconnus du grand public. Il est vrai que cette situation est due en partie à des considérations quantitatives : beaucoup de ces écrivains n'ont publié qu'un ou deux récits tout au long de leurs carrières. Mais le facteur le plus déterminant dans cette situation est, sans conteste, celui relatif aux études critiques. En effet, beaucoup de ces textes n'ont pas bénéficié d'un éclairage critique jusqu'à ce jour1. Chose qui explique «l'indigence» de la littérature tunisienne d'expression française comparée à la littérature algérienne ou marocaine écrite dans la même langue. L'exemple de Emna Bel hadj Yahia est très éloquent puisqu'il illustre bien cette situation d’abandon d’une partie de la littérature maghrébine. Auteur de « Chroniques Frontalières » 1991; et de «L'étage Invisible» 1996, et compte non tenu de quelques articles de presse, les récits de cette écrivaine n'ont pas été étudié. L'étude des deux romans précédemment cités s'avère être d'une grande importance puisqu'ils marquent «le renouveau» de la littérature tunisienne d'expression française au niveau de l'écriture, et mettent en exergue les aspects sous-jacents d'une littérature en quête de reconnaissance. 1 . Un constat largement confirmé par le CD-ROM LIMAG (voir bibliographie). 6 0.2 Présentation du corpus Le roman de Emna Bel hadj Yahia «L'étage Invisible» est publié en 1996 aux éditions cérès. En considérant les éléments du paratexte, qui «forment un discours sur le texte et un discours sur le monde» (Mitterrand; 1979 : p 89), on est tout d'abord marqué par le titre de ce roman. Profondément énigmatique, le titre «L'étage Invisible» acquiert par là même une «Fonction Incitative» (Idem : p91) qui stimule la curiosité des lecteurs et les pousse à découvrir le sens caché de ce titre. En outre, la quatrième de couverture fonctionne à elle seule comme une vraie «machine présuppositionnelle» (Eco; 1985 :p27). En effet, elle laisse entrevoir un problème de genre dans la mesure où l'on retrouve le même rapprochement fait entre «narration» et «poésie». En effet, ce roman est présenté comme étant « une poésie du mot et de la narration », et ce pour attirer l’attention du lecteur sur la nécessité de s’arrêter beaucoup plus sur la forme du roman que sur l’histoire qu’il véhicule. Jean Fontaine, qui évoque ce roman dans son histoire de la littérature tunisienne (Tome II), fait le même rapprochement et considère ce roman comme « un long poème où sont évoqués les mots de la mer, l’architecture et la société en mutation » (Fontaine, 1999). La fonction que l'on donne généralement au petit texte de la quatrième page de couverture est de présenter le roman (de quoi s'agit-il dans ce texte ?). On peut, parfois, y mettre un petit extrait du roman, qui traduit au mieux l’histoire globale dont il s'agit. Mais il est utile de souligner que la quatrième de couverture que nous avons vue n'assume ni l'une ni l'autre des deux fonctions. C'est dire qu'elle annonce, d'ores et déjà, la polysémie du roman. 0.3 Synthèse de l'histoire Ce roman présente un personnage appelé Yacine qui vit dans une parfaite harmonie, résultant d'une appréhension positive de son passé et de l'histoire de son pays, la Tunisie. Pour ce faire, il essaie en quelque sorte de donner un sens nouveau au passé 7 pour prouver que l'ancienneté des choses n'est pas leur déclin et qu’elle constitue Bel et Bien un socle solide pour le présent, et permet d'envisager un avenir plus prometteur. C'est pourquoi, on trouvera Yacine constamment lié à ses souvenirs tout au long de cette histoire. En effet, chaque geste qu'il fait lui fait penser à toute une profusion de souvenirs lointains qui sont comme des calmants qui apaisent sa souffrance. Médecin de métier, Yacine accorde beaucoup de considération à son grand père «Cheikh Mustapha». Ce dernier est représenté comme un Imam d'une grande sagesse et surtout d'un grand amour pour ses petits fils: Yacine et sa s°ur Aïda. La relation entre Yacine et son grand père demeura solide et ne se trouva, à aucun moment, remise en question. En revanche, ce ne fut pas pour autant le cas s'agissant de sa s°ur Aïda. A 19 ans, cette dernière part en France pour poursuivre ses études. Cette étape marque un tournant décisif dans sa vie et constitue une tentative de «déracinement» de tout ce qui pourrait représenter son espace d'origine, là où elle a vu le jour. Elle prend place « dans le lit d'un fleuve où circulent des vérités séduisantes, construites par des hommes et des femmes qui semblent comprendre le monde et vouloir l'améliorer » (E.I : p 28). Il était dorénavant clair pour elle que les idées communément admises dans son espace d'origine étaient à l'origine du malheur d'une bonne partie de la population. Loin d'atteindre « les contrée du progrès», Aïda fut vite déçue par un amour impossible et revient à Tunis 4 ans après avec un mari, qu'elle quitta peu de temps après. Désormais, elle vit dans une solitude étouffante, et essaie d'oublier ses malheurs en plongeant nuit et jour dans son travail, qui fut aussi pour elle l'occasion de réfléchir sur sa propre condition de femme divorcée. Sa rencontre enfin avec Slim la marque profondément et change sa vision négative du monde dans lequel elle vivait. Décidant de casser sa solitude, elle fit un petit voyage avec Yacine, sa femme et Slim aux «Hammamet», une ville historique qui eut un impact des plus profond sur elle, et fit d’elle un nouvel être plein d’enthousiasme et de vie. 8 C'est, en somme, l'essentiel de l'histoire, objet de notre analyse. Cependant, il convient de faire une remarque qui s'imposent : la structure d'ensemble de notre corpus d'analyse ne se présente pas de façon linéaire. Des Flash-back ; d’incessants va-et-vient entre le passé et le présent .... Caractérisent le récit et le rendent « déroutant». Du point de vue structurel, le roman se compose, en outre, de 25 chapitres. La structure d'ensemble de ce roman se présente de façon décousue dans la mesure où il n'y a pas de rapports logiques, «de succession», entre les différents chapitres. Ces derniers se caractérisent aussi par des espaces «blancs», qui subdivisent les chapitres en y introduisant des digressions, des retours au passé. C'est comme si on voulait donner un fondement à des actes ou situations qui se situent au présent par le biais du passé. C’est à ces détails que notre travail tâchera de développer l’intérêt. 9 0.4 Problématique et méthodologie de travail Notre travail, qui porte sur l’°uvre de Emna Belhadj Yahia l’étage invisible publié en 1996, se propose de mettre en exergue les différentes « idéologies » qui traversent ce roman. En effet, ces idéologies qui sont généralement en relation conflictuelle, laissent un certain nombre de « traces » dans le texte. Localiser ces traces n’est pas chose aisée puisque la définition de la notion même d’idéologie n’a pas fait l’objet d’un consensus parmi les chercheurs dans les domaines des sciences sociales et humaines. Généralement, on entend par le mot idéologie « un système de représentations (une forme de contenu) de nature interprétative uploads/Geographie/ sayadbelhadjyahia-pdf.pdf
Documents similaires






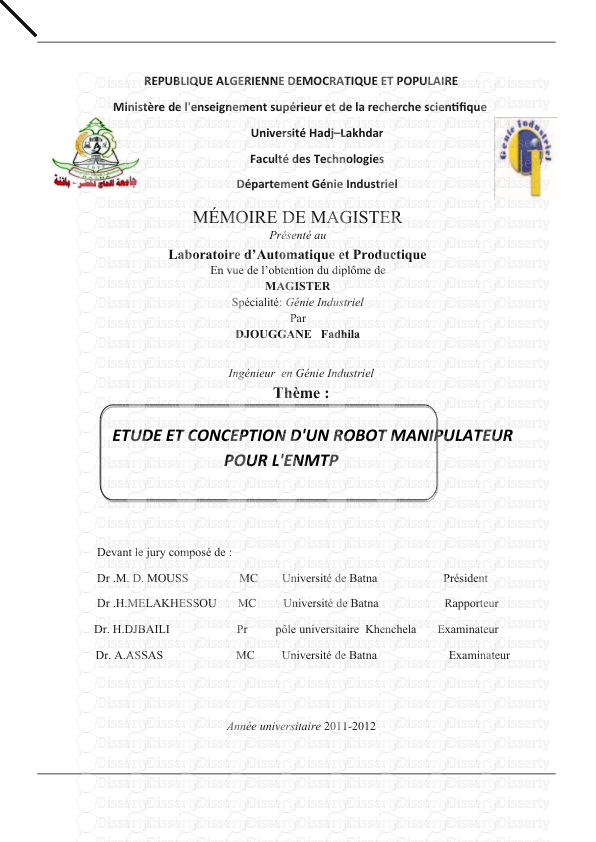



-
73
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 06, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5098MB


