SOMMAIRE Introduction Chapitre 1 – L’ozone troposphérique 1. Mécanismes de prod
SOMMAIRE Introduction Chapitre 1 – L’ozone troposphérique 1. Mécanismes de production et de destruction de l’ozone troposphérique 1.1. Troposphère naturelle 1.2. Troposphère polluée 2. Distribution d’ozone à l’échelle globale 3. Surveillance et prévision de la pollution en ozone Chapitre 2 – L’ozone stratosphérique 1. Rappels 2. Destruction d’ozone polaire 3. Évolution et résultats récents 4. Propositions pour accélérer le retour de l’ozone à son niveau de référence Conclusions Références bibliographiques Introduction L’ozone est un gaz qui est naturellement présent dans l’atmosphère. La molécule d’ozone est formée de 3 atomes d’oxygène et elle est représentée par la dénomination chimique O3. La plus grande quantité d’ozone (90 %) se situe dans la stratosphère, c’est-à-dire entre 10-16 et 50 km d’altitude où il représente au plus 10 millionièmes de la concentration atmosphérique. Son abondance est toutefois suffisante pour assurer la protection de la vie à la surface de la Terre en filtrant le rayonnement ultraviolet nocif pour les êtres vivants et les végétaux. Le reste de l’ozone (10 %) se situe dans la troposphère, c’est-à-dire entre la surface du sol et environ 10 à 16 km. Sa présence contribue à la pollution de l’air et elle est très néfaste pour la santé et pour la végétation. La figure 1 montre de 15 à 50 km dans la stratosphère le « bon » ozone et près de la surface le « mauvais » ozone. Figure 1 – Distribution verticale d’ozone. Dans la stratosphère la concentration maximum d’ozone est d’environ 10 ppm soit 10 molécules d’ozone par million de molécules d’air et dans la troposphère en dehors des agglomérations environ 50 ppb, soit 50 molécules d’ozone par milliard de molécules d’air (source : WMO, 2010). Le développement de la vie sur notre planète a été conditionné par la présence autour de la terre de la molécule d’ozone (O3). En effet, le rayonnement solaire dans l’ultraviolet B (entre 280 et 315 nm) est partiellement absorbé par la couche d’ozone (voir figure 2) et ainsi ce rayonnement très énergétique destructeur de l’ADN n’atteint pas la surface de la Terre. En revanche, le rayonnement ultraviolet A (entre 315 et 400 nm) n’est que faiblement absorbé par l’ozone stratosphérique et parvient dans la troposphère libre où il joue un rôle important dans l’équilibre photochimique des constituants et notamment de l’ozone troposphérique. Ce dernier est un oxydant puissant et un polluant « secondaire » résultant des réactions chimiques entre différents composés atmosphériques en présence de rayonnement ultraviolet (source : WMO, 2010). Figure 2 – Le rayonnement solaire dans l’ultraviolet-B (entre 280 et 315 nm) est partiellement absorbé par la couche d’ozone, tandis que le rayonnement ultraviolet-A (entre 315 et 400 nm) peut atteindre la surface de la terre (source : WMO, 2010). L’Académie des sciences a publié au cours des années précédentes deux rapports sur l’ozone rédigés sous la direction de Gérard Mégie : en 1993 Ozone et propriétés oxydantes de la troposphère et en 1998 L’ozone stratosphérique. Les conclusions de ces ouvrages exhaustifs restent valables aujourd’hui. Nous nous limiterons ici à rappeler les bases indispensables pour comprendre l’évolution de la teneur en ozone dans l’atmosphère au cours des récentes années et à décrire l’état actuel du sujet et les prévisions envisagées pour l’ozone troposphérique et l’ozone stratosphérique. Les réactions photochimiques qui conduisent à la formation et à la destruction d’ozone diffèrent dans la troposphère et dans la stratosphère, en raison du flux UV disponible, des caractéristiques de l’atmosphère dans ces deux domaines d’altitude et de la présence de constituants avec lesquels ils réagissent. Leur équilibre dans l’atmosphère sera donc discuté de façon distincte dans les chapitres 1 et 2. Il est important de rappeler que le problème de l’équilibre de l’ozone dans l’atmosphère et celui du climat sont des problèmes a priori distincts. Cependant l’état de tout constituant dans l’atmosphère est influencé par les caractéristiques du milieu où il se situe et donc une interaction entre les deux problèmes est inévitable. Nous exposerons au chapitre 3 les différentes interactions de nature radiative et dynamique entre les variations d’ozone dans l’atmosphère et le climat. Chapitre 1 L’ozone troposphérique Introduction La présence de l’ozone dans la troposphère a d’abord été attribuée à des transferts dynamiques de masses d’air entre la stratosphère et la troposphère, et sa variabilité au niveau du sol était expliquée par l’effet de la turbulence et du vent sur les émissions d’origine naturelle. Au début des années 1970, les observations scientifiques ont montré que, pour expliquer les variations spatiales et temporelles de concentration observées dans la troposphère, il fallait aussi tenir compte des interactions physicochimiques impliquant des polluants émis par les activités humaines et les produits émis par la végétation, notamment les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV). La formation d’ozone étant favorisée par la présence de rayonnement solaire, les pics de pollution observés apparaissent en général au printemps et en été (Delmas et al., 2005). Les concentrations mesurées dépassent régulièrement les seuils d’alertes fixés par l’Union européenne (figure 3) pour ce gaz nocif, qui, à concentration élevée, affecte la capacité respiratoire des personnes les plus vulnérables (Bell et al., 2005) et diminue la productivité des cultures. Encadré n° 1 Quelles sont les conséquences de la pollution en ozone ? Au printemps et en été, des pics d’ozone sont fréquemment observés. Ces niveaux élevés peuvent affecter la santé des êtres vivants et la croissance de la végétation. L’ozone est susceptible de pénétrer en profondeur dans les voies respiratoires, et de provoquer une réaction inflammatoire bronchique. Les enfants asthmatiques et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Des études ont démontré que lors des pics d’ozone, on observe une augmentation à court terme de la mortalité et des hospitalisations pour pathologies respiratoires. Cet effet a été observé lors de la vague de chaleur de l’été 2013, ou les niveaux élevés d’ozone ont été associés à une mortalité importante en France. D’autre part la pollution à l’ozone a des effets nuisibles sur la végétation : les principaux processus physiologiques de la plante sont altérés et la productivité des cultures agricoles peut être significativement réduite. Sur un arbre soumis à des concentrations de 40 ppb pendant quelques heures, on peut constater l’apparition de petites taches nécrotiques sur la surface des feuilles. Si la pollution persiste, cela peut conduire au dépérissement des forêts et impacter la diversité des espèces végétales. Figure 3 – Dépassements des seuils d’information (valeurs supérieures à 180µg/m3 sur 1 heure) en ozone durant la vague de chaleur 2003 en Europe, observés par les stations locales du réseau européen (à gauche) et interpolées en pondérant inversement à la distance (à droite) (Source : European Topic Centre on Air and Climate Change, Fiala J. et al., 2003). Ces dernières années, les réglementations contraignantes ont conduit à une amélioration de la qualité de l’air en Europe, et les concentrations de nombreux polluants ont baissé. Ce n’est pas le cas de l’ozone, dont la concentration ne diminue pas ou peu près de la surface terrestre, et notamment dans des zones fortement peuplées, comme l’attestent les mesures locales et satellitaires. 1. Mécanismes de production et de destruction de l’ozone troposphérique La distribution spatiale et temporelle de l’ozone dans la troposphère est régie par quatre processus différents qui se combinent (figure 4) : - les échanges stratosphère-troposphère (échanges des masses d’air entre la stratosphère et la troposphère par mélange vertical et horizontal) ; - la production photochimique qui résulte de l’oxydation du monoxyde de carbone et des hydrocarbures en présence d’oxydes d’azote (et le transport horizontal des masses d’air) ; - la destruction par photodissociation et photochimie ; - le dépôt sec au sol qui résulte de l’absorption de l’ozone par les plantes et la surface du sol. Figure 4 – Sources et puits de l’ozone troposphérique (source : Académie des sciences, 1993). 1.1. Troposphère naturelle L’ozone troposphérique n’est pas émis directement dans l’atmosphère. C’est un « constituant secondaire » qui est produit photochimiquement dans les plus basses couches de l’atmosphère. Dans la troposphère naturelle (loin des sources primaires de polluants), la formation d’ozone résulte de la combinaison d’un atome d’oxygène dans l’état fondamental O(3P) avec une molécule de dioxygène O2, en présence d’un troisième corps (M) permettant de stabiliser les produits de la réaction : (1) L’atome d’oxygène est produit à partir de la photodissociation du dioxyde d’azote NO2, aux longueurs d’ondes du visible et du proche ultraviolet (inférieures à 400 nm) : (2) La formation photochimique de l’ozone, selon les réactions (1) et (2), conduit également à la production de monoxyde d’azote NO, qui réagit très rapidement avec l’ozone, pour reformer du dioxyde d’azote : (3) À partir de ces trois réactions, un équilibre photochimique s’établit ainsi entre NO2, NO et O3, sur une échelle de temps de quelques minutes. Mais l’ensemble des réactions (1), (2) et (3) ne peut pas conduire à une production nette d’ozone car il n’y a production nette d’ozone que lorsque le NO est converti en NO2 sans perte d’ozone. Cette conversion fait intervenir dans la troposphère naturelle les radicaux hydroperoxyle HO 2 et peroxyle uploads/Geographie/ ozone-pdf.pdf
Documents similaires


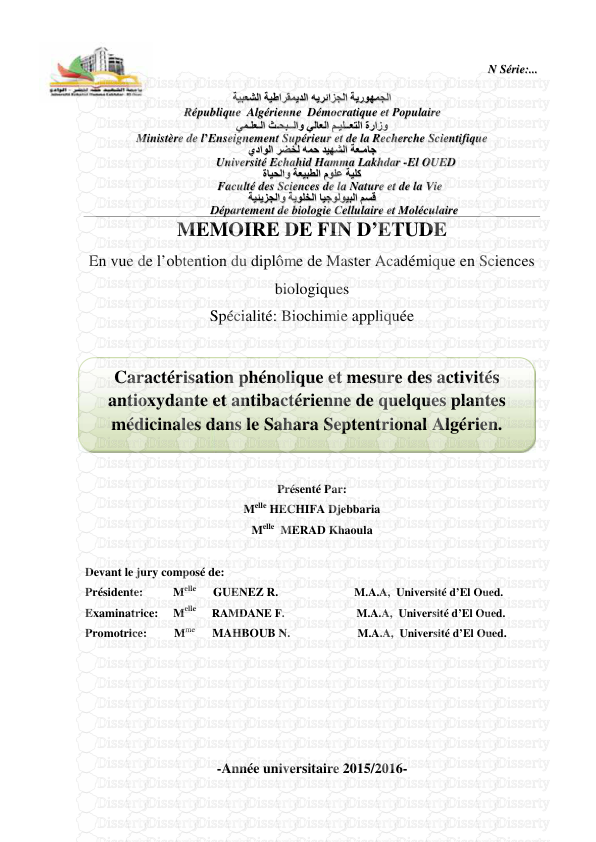







-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 05, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 3.1786MB


