Ian H. Magedera Désorienter l’Orient et les orients désorientés : Said, Derrida
Ian H. Magedera Désorienter l’Orient et les orients désorientés : Said, Derrida et le paradoxe du GPS Nous sommes la dernière semaine de juin 1905 et une carte postale a été envoyée de Cabourg à Royat. Comme on le voit si on regarde la reproduction de la carte postale sur la couverture de ce livre, cette ville arborait le nom grandiose de ‘Royat-les-Bains’ à l’époque. Avant d’examiner cette carte postale de près, nous constatons au premier abord que ces détails semblent être d’une banalité parfaite, car il s’agit sans doute d’une des milliers de cartes postales qui ont été envoyées en France cette semaine-là. Pourquoi cette carte postale devrait-elle retenir notre attention ? En guise d’avant-propos à notre réponse à cette question, rappelons ce que dit Jacques Derrida quant à la façon dans laquelle la carte postale mélange une relation épistolaire intime et un transfert par des circuits publics : ‘si la carte postale est une sorte de lettre ouverte [...] on peut toujours [...] tenter de la rendre indéchiffrable [...]’ 1 « Indéchiffrable » c’est bien le mot qu’il faut, puisque l’aspect public de cette carte postale est entièrement opaque. Il est incompréhensible si on ne lit pas le gujarati. Et pourtant, même si on fait partie de cette communauté linguistique qui compte 41 millions de membres, les sons énoncés par les caractères n’ont aucun sens, à moins que le gujaratiphone maîtrise également le français, puisqu’il s’agit des mots français transcrits en gujarati. Cette double condition requise pour assurer la compréhension de ce document augmente de manière exponentielle son exclusivité. Le schéma général de la communication humaine de Roman Jakobson, par exemple, serait insuffisant pour en faire l’interprétation.2 Si on tentait une interprétation de la carte postale selon le schéma de Jakobson il faudrait deux clés linguistiques pour déchiffrer le double code qui porte son message intime : ‘Je n’ai rien reçu aujourd’hui, ni carte ni lettre. J’espère avoir 1 Jacques Derrida, La Carte Postale: de Socrate à Freud et au-delà, p. 41. 2 Roman, Jakobson, ‘Closing Statement: Linguistics and Poetics’ dans Sebeok, Thomas A. (éd), Style in Language, p. 353 et p. 357. beaucoup demain matin. Madeleine et moi avons fait ce soir une promenade. Comme c’est monotone, quand tu n’es pas là. A toi, toujours ta fidèle Sooni’.3 Nous convenons, certes, que le contenu de ce message est exprimé d’une façon chaleureuse, mais il n’a rien de remarquable, on pourrait même dire qu’il est monotone. Donc pour justifier pourquoi ce document devrait retenir notre attention, il faut ré-aborder le mélange identitaire et linguistique du destinataire de cette carte postale et de celle qui la lui a envoyée. Cette carte a été expédiée par une épouse à son mari. La personne responsable pour l’envoi s’appelle Sooni Tata, elle est née Suzanne Brière à Paris en 1880 et le destinataire est Ratanji Dadabhoy (‘R. D.’) Tata, un membre important de la plus puissante famille d’industriels indiens de l’époque. Malgré son contenu banal et le fait qu’il n’est pas sorti du territoire national, cet envoi est significatif comme un acte de langage transnational. Ceci nous mène à considérer en quoi la situation de ces deux individus diffère de celle de la plupart des conjoints qui se sont envoyés mutuellement une carte postale au cours de cette semaine de l’été 1905. Le gujarati est la langue ancestrale des Tata, une famille parsie, originaire de cette région dans le nord-ouest de l’Inde. Donc l’utilisation par madame Tata des caractères gujaratis pour véhiculer sa propre langue maternelle peut être considérée, non seulement comme un cas de cryptage, une stratégie visant la soustraction de leur communication des regards curieux d’autres personnes, mais cette utilisation témoigne également de l’évolution dans l’image du moi de Sooni Tata depuis son mariage à R. D. Tata en 1902. La carte postale fait état d’un processus d’acculturation en cours. Entre 1902 et 1905 elle a voyagé à travers des pays comme la République tchèque, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis. Au cours de ces années elle a également fondé un foyer à Bombay (une ville connue actuellement sous le nom de Mumbai). Et cependant, la carte postale montre également les limites de son apprentissage des cultures de l’Inde puisque, bien que cette femme ait changé non seulement son nom, mais aussi son prénom lors de son mariage (« sooni » signifiant 3 Que M. Rajendraprasad Narla de Tata Central Archives soit remercié ici pour m’avoir gracieusement accordé la permission de reproduire la carte postale. « claire » en gujarati), elle n’est pas en mesure de s’exprimer couramment à l’écrit en gujarati. Ce document s’impose puisqu’il a un contexte local et national. Il montre en outre l’acquis de cette période de voyages autour du monde et l’évolution transculturelle de Sooni Tata. En plus cette carte postale opère une séparation entre une langue orientale (le gujarati) et sa terre d’appartenance tout en faisant un pont entre cette langue et une langue occidentale, à savoir le français en France. Cette carte postale constitue un exemple et de l’acte de désorienter l’Orient, et l’état des orients désorientés parce elle comprend non seulement le déplacement d’un Gujaratiphone en France, mais également la combinaison créatrice de la langue gujarati et de la langue française. Certes, l’hybride, issue de cette rencontre est une fleur rare, il s’agit d’un acte de langage fait par la femme dans lequel les caractères de la langue ancestrale de l’époux enrobent les mots de sa propre langue maternelle. Il s’avère donc que les deux objets d’analyse ici – l’acte de désorienter l’Orient et l’état des orients désorientés – s’associent toujours dans une relation parfois complexe.4 Nous nous donnons quatre objectifs dans notre argument. Le premier est de passer en revue les différences entre la désorientation de l’Orient comme processus et l’état des orients désorientés pour essayer de voir si on peut les combiner de manière à faciliter l’analyse. Notre deuxième objectif est de tracer une généalogie de ces deux termes en les rapportant à trois textes. Le premier est l’ouvrage d’Edward Said, Orientalism (publié en 1978) ; le deuxième est un précurseur français d’Orientalism et le troisième élément est une autre écrite par Said, à savoir Culture and Imperialism (publiée en 1993).5 Le troisième objectif général de notre argument est d’élaborer des éléments de comparaison entre ces deux termes (l’acte de désorienter l’orient, et l’état des orients désorientés) et la pratique de la déconstruction que l’on observe chez Jacques Derrida. Les trois premiers buts sont des préliminaires méthodologiques qui vont nous permettre de mieux définir notre propos. Une fois cette définition acquise, il est 4 Nous réservons la majuscule à la conception fétichisante et réductrice de l’Orient. 5 Edward Said, Orientalism (New York, Pantheon Books, 1978) et Culture and Imperialism (Londres: Vintage, 1993). nécessaire de l’appliquer et de la vérifier. Voilà les enjeux de notre quatrième but qui propose de mettre ces termes sur le banc d’essai par le biais d’une étude de cas. On utilisera pour cette fin l’image de soi que pouvait avoir une femme d’origine européenne (mais pas d’origine britannique) qui appartenait pleinement aux élites indiennes entre 1902 et 1948. Cette étude de cas interrogera de manière critique les limites des termes ‘désorienter l’orient’ et ‘les orients désorientés’. Définitions des termes de cette analyse Considérons au premier abord l’acte de désorienter l’orient. Dans ce cas on croirait avoir affaire à un processus critique qui puise sa force dans une critique soutenue des raisonnements idéologiques des colonisateurs occidentaux, identifiés par Edward Said dans son livre Orientalism en 1978. Et cependant si l’on prend l’acte de désorienter l’Orient au pied de la lettre, on verra qu’il remet en question (ou désoriente) ce qui constitue l’Orient dans l’étude de Said, c’est-à-dire l’Orient conçu principalement comme le Moyen Orient. Le terme ‘désorienter l’orient’ se sert d’un verbe pour déjouer un nom et donc on pourrait dire que l’acte de désorienter l’Orient emploie la critique des arguments réducteurs des colonisateurs occidentaux présente dans Orientalism de Said, pour l’appliquer contre l’argumentation du livre de Said. Si on veut élaborer une critique de l’étude de Said, il faut d’abord passer en revue un précurseur de cet ouvrage avant de considérer d’autres ouvrages écrits par Said. En ce qui concerne les précurseurs, des textes comme Contre-littératures de Bernard Mouralis (publié en 1975) présentent une critique lucide de l’idéologie coloniale que l’auteur définit comme une : ‘association étroite qui s’est souvent établie entre l’ethnographie et l’entreprise coloniale pour laquelle l’anthropologie « appliquée » ou « pratique » a pu effectivement constituer, comme on le sait, une pièce non négligeable dans la mise en place d’un système de domination politique et sociale’ (p. 189)’. A la différence de Said, Mouralis reconnaît qu’il y a des voix qui offrent une résistance à cette domination : ‘[l]e texte négro-africain se définit ainsi par son opposition globale au monde européen et aux idéologies que véhicule celui-ci [...] La protestation contre la situation coloniale, la valorisation de la culture négro-africaine, la neutralisation des différents discours européens caractérisent indéniablement un processus de contre- uploads/Geographie/ ian-magedera-desorienter-l-x27-orient-et-les-orients-desorientes-said-derrida-et-le-paradoxe-du-gps 1 .pdf
Documents similaires
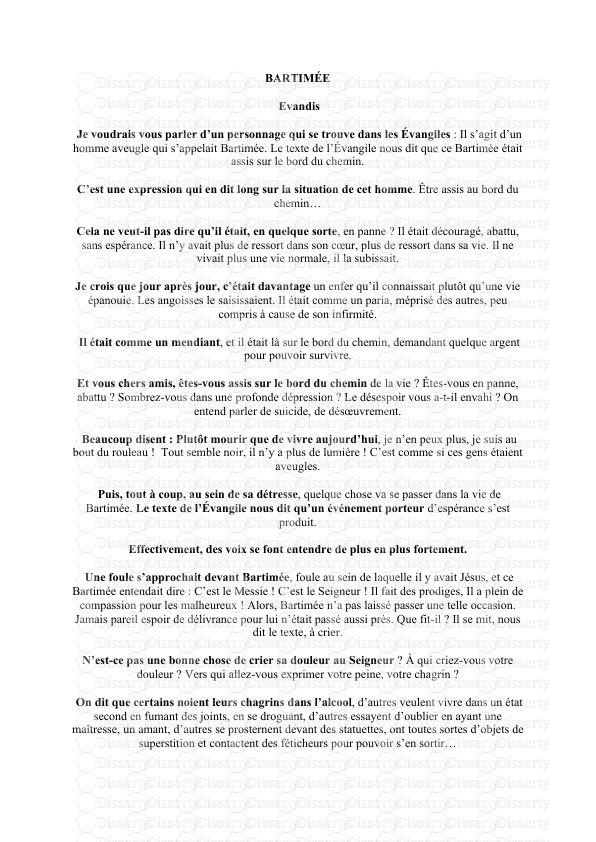









-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 29, 2022
- Catégorie Geography / Geogra...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1419MB


