Chimie organique – Arènes et substtutons électrophiles CHIMIE ORGANIQUE CHIMIE
Chimie organique – Arènes et substtutons électrophiles CHIMIE ORGANIQUE CHIMIE ORGANIQUE Cours 8 (1ère partee) – Arènes et substtutons électrophiles Pr Chang-Zhi Dong Ce document est un support de cours datant de l’année 2017-2018 disponible sur www.tsp7.net 1 I. Nomenclature, aromaticité et réactivité A. Nomenclature B. Aromaticité C. Réactivité II. Substitution électrophile aromatique (SEAr) A. Mécanisme général B. Substitutions électrophiles sur le benzène C. Substitutions électrophiles sur un arène substitué III. Autres réactions A. Halogénation d’une chaîne latérale B. Oxydation d’une chaîne latérale Chimie organique – Arènes et substtutons électrophiles I. NOMENCLATURE, AROMATICITÉ ET RÉACTIVITÉ Les arènes sont des dérivés du benzène. Le benzène est lui–même un cycle à 6 carbones, comportant 3 insa- turations, ce qui en fait un composé aromatique doté d’une grande stabilité. On verra par la suite que cete stabilité prédisposera ces cycles à des réactions de substitutions électrophiles. A. Nomenclature Le cycle benzénique comporte 6 carbones qui sont numérotés de 1 à 6. Chaque carbone pouvant porter un groupement ou substtuant spécifque, on veillera toujours à annoter les carbones de manière à ce que la somme des chiffres des carbones portant les substtutons soit toujours la plus faible pos- sible ; ainsi, un benzène monosubsttué sera numéroté de telle sorte que le carbone substtué porte le numéro 1. En cas de substtuton par un groupement alkyle, le composé obtenu sera nommé par le préfie correspondant suivi de « benzène ». Exemples : Remarque : il existe une nomenclature alternative (toluène, cumène, etc…) mais elle n’est probablement pas à connaître pour le concours (elle n’était pas à connaître pour l’année dernière). Soyez atentifs aux précisions du prof là-dessus si jamais les choses changent ! Les termes ortho, méta et para désignent la place des substtuants les uns par rapport aux autres. Ainsi, un noyau dont les substtuants ne sont séparés par aucun carbone sur le cycle est appelé ortho ; s'ils le sont par un carbone, on parlera de composé méta, et de compo- sé para lorsque les groupements sont « face à face » dans la molécule. B. Aromatcité Un composé aromatque est un composé chimique qui content un cycle respectant la règle d’aromat- cité de Hückel. Un eiemple classique est celui des cycles de type benzène avec 6 atomes de carbones for- mant un heiagone régulier et 6 électrons délocalisés autour du cycle. Petite précision : Le benzène est plus stable que n’importe quel composé éthylénique. La représentaton de ce système est un cycle heiagonal avec 3 doubles liaisons alternées avec 3 liaisons simples. Pour être plus fdèle à la mésomérie, il est souvent préférable d'utliser la représentaton avec un cercle à l'intérieur de l'heiagone. Les 6 liaisons sont d’une longueur identque, longueur intermédiaire entre celle d’une liaison simple et celle d’une liaison double. Un composé organique est dit aromatiue s’il respecte les règles suivantes : • Présence d’un cycle comportant un système π conjugué, formé de liaisons doubles et/ou de dou- blets non-liants (alternance de liaisons π et de liaisons σ) ; • Respect de la règle d’aromatcité de Hückel : le nombre d’électrons délocalisables π est égal à 4n+2 où n est un enter positf non nul ; • La délocalisaton des électrons π entraîne une diminuton de l’énergie de la molécule et lui confère une grande stabilité (énergie de résonance forte : 150 kJ). Il s'agit d'une délocalisaton parfaite. Ce document est un support de cours datant de l’année 2017-2018 disponible sur www.tsp7.net 2 Chimie organique – Arènes et substtutons électrophiles A. Réactvité Dans le cas des composés éthyléniques (alcènes), la double liaison C=C s’ouvrait pour donner lieu à des réactons d’additon. Ces réactons sont impossibles pour les arènes à cause de la grande stabilité du cycle benzéniiue. La réacton principale des arènes est la substtuton électrophile (SE) : un hydrogène du cycle est remplacé par un réactf électrophile E+. En effet les doubles liaisons riches en électrons sont le siège d’ataques élec- trophiles. Ici, avec la formation du C+, la règle de Hückel n’est plus respectée. Il y a rupture de l’aromaticité qui est énergétiquement défavorable donc réaction lente. Cete réacton s’effectue en 2 étapes passant par un compleie σ instable. La première étape est lente alors que la deuiième étape est rapide. Des réactons d’oiydaton sont possibles au niveau des chaînes latérales (= coupures des chaînes latérales) mais pas au niveau du noyau (perte de stabilité). II. SUBSTITUTIONS ÉLECTROPHILES AROMATIQUES (SEAR) A. Mécanisme général Additon électrophile de E+ Le complexe π correspond à l’intégraton du composé électrophile à la molécule : E+ interagit avec les électrons d’une double liaison (délocalisée) du cycle. Le compleie π va évoluer vers une forme σ, dans laquelle E+ se lie au cycle pour former un ion carbo- nium (ion C+ issu de la transition vers le complexe σ), très peu stable, qui détruit temporairement la struc- ture aromatque du cycle pour donner 3 formes mésomères. C'est une étape lente. Ici, on observe des ef- fets M mais la stabilité du C+ est relative car en soi, c’est un intermédiaire réactionnel très instable qui a dû demander beaucoup d’énergie pour le former. Ce document est un support de cours datant de l’année 2017-2018 disponible sur www.tsp7.net 3 Chimie organique – Arènes et substtutons électrophiles Éliminaton de H+ Très rapidement, la structure aromatque est rétablie par éliminaton d’un proton H+. Comme on l’a eipliqué précédemment, il n’y a pas d’additon nucléo- phile car celle-ci entraînerait la perte de l’aromatcité et donc dimi- nuerait la stabilité de la molécule. B. Substtutons électrophiles sur le benzène 1. Halogénaton Cete réacton consiste en la substtuton d’un proton par un ion halogénoïde sur le cycle benzénique. Elle est médiée par un catalyseur (un acide de Lewise) qui par défniton est régénéré en fn de réacton. D’autres exemples d’acides de Lewis : chlorure de fer, chlorure de zinc,... Pour cete réacton, E+ = Cl+ ou Br+. Selon que l’on fera réagir le dibrome ou le dichlore, le catalyseur sera AlCl3 ou AlBr3, qui permetront la dissociaton des dihalogènes en une paire d’ions Cl+ ou Br+. Cl+ ataque le cycle benzénique selon le schéma classique de la SE. L’ion issu du catalyseur, AlCl4–, réagit ensuite avec le proton libéré conduisant à la régé- nératon du catalyseur avec formaton d’acide chlorhydrique. 2. Nitraton Cete réacton a lieu en milieu acide : acide nitrique et acide sulfurique concentrés de manière à pro- duire le réactf électrophile NO²+. Ce document est un support de cours datant de l’année 2017-2018 disponible sur www.tsp7.net 4 Chimie organique – Arènes et substtutons électrophiles La SE a lieu selon le schéma général et conduit à la formaton de nitrobenzène. 3. Sulfonaton L’acide sulfuriiue concentré produit un réactf électrophile HSO3+, de charge générale positve, qui va ataquer le noyau benzénique. Ce réactf est chargé et se fie au benzène directement selon le schéma général (la même réaction peut avoir lieu avec un SO3 non chargé qui répercutera la charge des doublets de l'oxygène. L’oxygène ainsi chargé négativement va réagir avec le proton libéré lors de la réaction de SE conduisant à la formation d’un acide benzène sulfonique). On obtent alors de l'acide benzènesulfoniiue. 4. Alkylaton Cete réacton est le plus souvent appelée réacton de Friedel et Crats. Le réactf électrophile est un carbocaton généré à partr d’un dérivé halogéné. De même que pour la réacton d’halogénaton étudiée précédemment, on utlisera un catalyseur pour générer cete espèce io- nique. Il y a isomérisaton du groupement électrophile systématquement lorsque la chaîne qui s'ajoute possède plus de trois carbones (voir dessin ci-dessous) pour obtenir un C+ plus stable. Exemple de l'utilisation du chlorure d’éthyle en réactif électrophile : Exemp le de l'utilisation du chlorure de propyle en réactif électrophile avec réarrangement du C + durant l'étape lente : (isomérisation : passage d'un C+ secondaire à un C+ tertiaire) Ce document est un support de cours datant de l’année 2017-2018 disponible sur www.tsp7.net 5 Chimie organique – Arènes et substtutons électrophiles 5. Acylaton Une autre réacton mise en évidence par Friedel et Crats, est la réacton d’acylaton, la différence avec l’alkylaton est qu’ici, le réactf électrophile est un ion acylium formé à partr d’un halogénure d'acide, le plus souvent, un chlorure d'acide ou d’un anhydride d’acide. Note : Un halogénure d'acyle est une forme d'halo- génure d'acide. Ici, on utilise le terme halogénure d'acide (pour utiliser les formulations du Dr Dong) en tant qu'abus de langage pour désigner un halogénure d'acyle. On considèrera donc ces deux appellations comme équivalentes, sauf mention contraire. La réacton avec le chlorure d’acétyle, qui est le plus simple des chlorures d'acyles, conduit à la forma- ton de l’acétophénone. Le point tout à fait remarquable de la réacton d'acylaton est qu'elle ne provoque pas de réarrange- ment. Par conséquent, pour une réacton de SEAr avec une chaine carbonée de plus de trois carbones, le mode de substtuton de l'H par cete chaine sera forcé- ment une réacton d'acylaton suivie d'une réducton de la cétone en alkyle (par une réacton de Wolff--ish- ner par eiemple). Avec un anhydride d'acide, on uploads/Finance/ ue1-chimie-cours-8-1-2-arenes-1718-final.pdf
Documents similaires





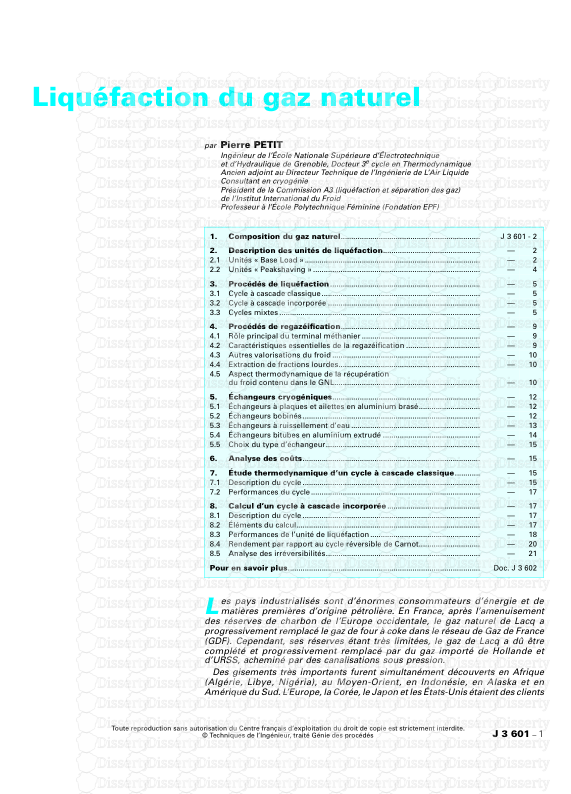
-
26
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 19, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.7500MB


