Le principe de participation : un succès inattendu Agathe VAN LANG - Professeur
Le principe de participation : un succès inattendu Agathe VAN LANG - Professeure à l'Université de Nantes, Droit et Changement Social, UMR-CNRS 6297. NOUVEAUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 43 (LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET L'ENVIRONNEMENT) - AVRIL 2014 Nous savons, grâce à Hans Christian Andersen, que le vilain petit canard a pu, au terme de douloureuses péripéties, se muer en cygne. Ainsi en est-il du principe de participation, branche longtemps atrophiée du triptyque de la démocratie environnementale (information, participation, accès à la justice(1)), dont les récentes transformations laissent entrevoir un épanouissement inespéré. La participation peut être définie, selon Michel Prieur, comme « une forme d’association et d’intervention des citoyens à la préparation et à la prise de décision administrative »(2). Cette conception nouvelle du fonctionnement administratif s’est affirmée de façon particulière en matière environnementale(3), portée dans un premier temps par des instruments internationaux. Après avoir été inscrit dans des textes dépourvus de force contraignante, tels que la Charte mondiale de la nature de 1982(4) et la Déclaration de Rio de 1992(5), le principe de participation a été proclamé avec une autorité accrue par la convention d’Aarhus du 25 juin 1998(6), qui lie pleinement les États parties. En droit interne, il figure parmi les principes généraux du droit de l’environnement depuis la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement(7) et a été promu au rang constitutionnel, sous la forme d’un « droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », par l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004. Les multiples occurrences du principe de participation en droit positif n’ont toutefois pas permis de le doter d’une signification précise, handicap qui entrave inévitablement sa portée. Le constat de sa moindre effectivité par rapport à d’autres principes, notamment celui d’information du public, est fréquemment établi(8). Quant aux principales procédures censées le mettre en œuvre, elles font l’objet de critiques récurrentes. Ainsi, l’enquête publique intervient trop tard dans le processus décisionnel, le public étant consulté sur un projet déjà très abouti et donc impossible à remettre radicalement en cause. Le débat public, situé plus en amont dans l’élaboration de la décision, souffre d’une portée très limitée : la Commission nationale du débat public se borne à publier un bilan du débat public, sans émettre d’avis(9). Le principe de participation s’est pourtant renforcé de façon spectaculaire ces dernières années, grâce à la conjonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’essor du concept de développement durable, qui postule l’adoption de politiques publiques respectueuses des ressources naturelles, implique la conciliation de préoccupations habituellement antagonistes - protection de l’environnement, croissance économique et progrès social(10). Il devient alors nécessaire de privilégier un mode d’élaboration des décisions concerté, afin que les différents intérêts en présence puissent s’exprimer et s’accorder. La promotion du développement durable constitue ainsi le terreau de la gouvernance, qui désigne une forme rénovée de gouvernement(11). La gouvernance vise la gestion de systèmes complexes et se caractérise par « l’élargissement du cercle des acteurs associés aux processus décisionnels et la recherche systématique de solutions de type consensuel »(12). Elle suppose donc la mise en place de procédures permettant le débat en amont de la décision, pour parvenir à l’édiction de normes négociées. Le processus du Grenelle de l’environnement illustre ce modèle, en inaugurant la formule de la « gouvernance à cinq » (État, collectivités locales, ONG, employeurs et salariés). Les deux lois qui en résultent avaient elles-mêmes pour ambition de réformer la gouvernance en matière environnementale(13). Ainsi, la loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, du 12 juillet 2010, a-t-elle inscrit « la participation du public » parmi les objets de l’enquête publique après l’information, à l’occasion de la réforme de cette procédure (art. L. 123-1 C. env.). Ce nouveau contexte idéologique et social, marqué par une attention accrue des citoyens à l’égard des questions environnementales, favorise la revendication du droit de participer aux décisions intéressant ce domaine. Il s’accompagne d’évolutions technologiques, telles que le développement des moyens de communication numériques, qui révolutionnent les modalités d’information et de participation du public. Parallèlement s’est développé un important courant doctrinal relatif à la démocratie administrative et à l’une de ses manifestations les plus abouties, la démocratie environnementale, qui place la participation des citoyens au cœur de ses réflexions(14). La satisfaction de l’exigence démocratique qui parcourt l’action publique a provoqué l’émergence de la notion de démocratie participative, conçue comme un correctif de la démocratie représentative, ayant pour objet d’associer des représentants de la société civile, avec un degré d’influence variable, à la prise de décision(15). Selon P. Rosanvallon, la démocratie participative peut être conçue « comme un processus d’implication, d’intéressement des citoyens à la chose publique ». Elle est alors « liée à l’idée d’association à la délibération, à l’information, à la reddition de comptes de la part des gouvernants. Dans cette mesure, on peut dire qu’il s’agit d’une démocratie interactive qui oblige en permanence le pouvoir à s’expliquer, à rendre des comptes et à informer »(16). Cette conception exigeante de la démocratie connaît une version atténuée avec la notion de démocratie délibérative, fondement d’une légitimité procédurale(17). Il s’agit d’une théorie développée par Jürgen Habermas à la fin des années 1980, pour qui « la démocratie impliquerait la confrontation permanente des opinions : dans une société démocratique, il faut que “les citoyens puissent se concevoir à tout moment comme les auteurs du droit auquel ils sont soumis en tant que destinataires”. Cela passe nécessairement par des processus de discussion et de délibération par lesquels la norme juridique progressivement se construit »(18). Dans cette optique, les procédures qui organisent la délibération revêtent une importance particulière. Dès lors, l’effectivité du principe de participation apparaît comme un enjeu majeur. Il constitue à la fois la source de la démocratie environnementale(19) en tant qu’il implique la mise en œuvre de procédures participatives et le moyen de réalisation de l’Administration délibérative que le Conseil d’État appelle de ses vœux(20). Enfin, la novation du cadre juridique, sous l’effet de la constitutionnalisation des droits et devoirs environnementaux en 2005 et de la création de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité en 2008, va constituer un puissant facteur de promotion du principe de participation. Le droit de participer reconnu à l’article 7 de la Charte s’articule en effet avec le droit de l’homme à l’environnement consacré à l’article 1 , en participant à sa concrétisation(21), et avec le devoir de chacun de contribuer à la protection de l’environnement affirmé à l’article 2, dont il représente une modalité d’exercice. La reconnaissance de sa pleine valeur constitutionnelle(22) suivie d’une série de décisions du Conseil constitutionnel abrogeant des er dispositions législatives le méconnaissant et obligeant le législateur à en préciser les conditions et limites, en font un symbole de réussite du système juridique. Compte tenu des nombreuses publications récentes relatives au principe de participation, il nous paraît intéressant de nous pencher plus spécialement sur sa contribution au caractère post-moderne ou « résolument moderne » du droit de l’environnement(23). Nous évoquerons à cet égard le pluralisme des sources matérielles et formelles dont la synergie a permis d’améliorer nettement sa définition (I), avant de constater que ses modalités de mise en œuvre traduisent la recherche de dépassement d’une contradiction propre à la logique participative « à la française » (II). Étant entendu que par son seul objet, le droit à la participation apparaît comme une incarnation du droit post-moderne. I – Le pluralisme normatif à l’appuifi d’une définition améliorée Dans un premier temps, la superposition des sources du principe de participation n’a certes pas favorisé sa lisibilité. Néanmoins, l’action combinée de la jurisprudence et du législateur a abouti à une définition plus cohérente du principe. A – La confrontation des sources Au sommet de la hiérarchie des normes, l’article 7 de la Charte constitutionnelle énonce que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Cette rédaction est fort éloignée de celle établie par la commission Coppens, qui proposait : « La loi détermine les formes de démocratie participative qui permettent au public d’être associé à l’élaboration des politiques et décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » (art. 11 du projet de loi constitutionnelle proposé par la commission). La référence à la démocratie participative, jugée trop audacieuse, a été supprimée pour céder la place à une conception plus délibérative de la participation. Celle-ci se manifeste dans l’ouverture du droit de participer(24) à toute personne, physique ou morale, publique ou privée. L’indication que ce droit concerne « l’élaboration » le cantonne dans une fonction consultative, visant à associer le public sans lui laisser le pouvoir d’initiative ni de décision finale, ce qui traduit également la logique délibérative. Son application aux « décisions publiques » permet d’englober non seulement les projets particuliers soumis à autorisation et enquête publique, mais aussi les plans, programmes et diverses réglementations. La uploads/S4/le-principe-de-participation-un-succes-inattendu-conseil-constitutionnel.pdf
Documents similaires






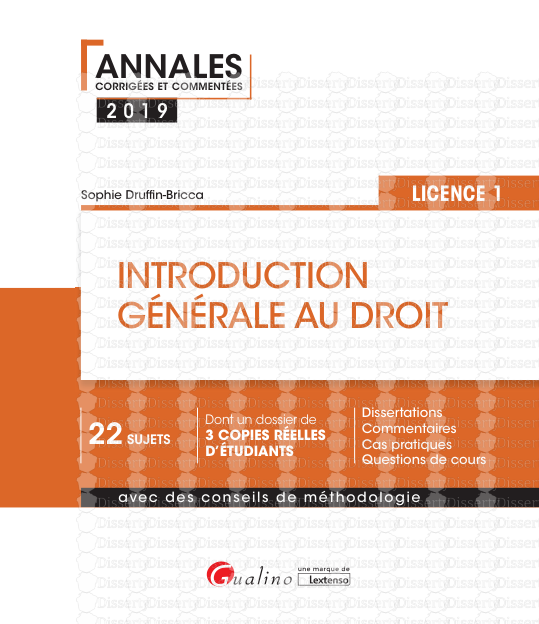



-
55
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4931MB


