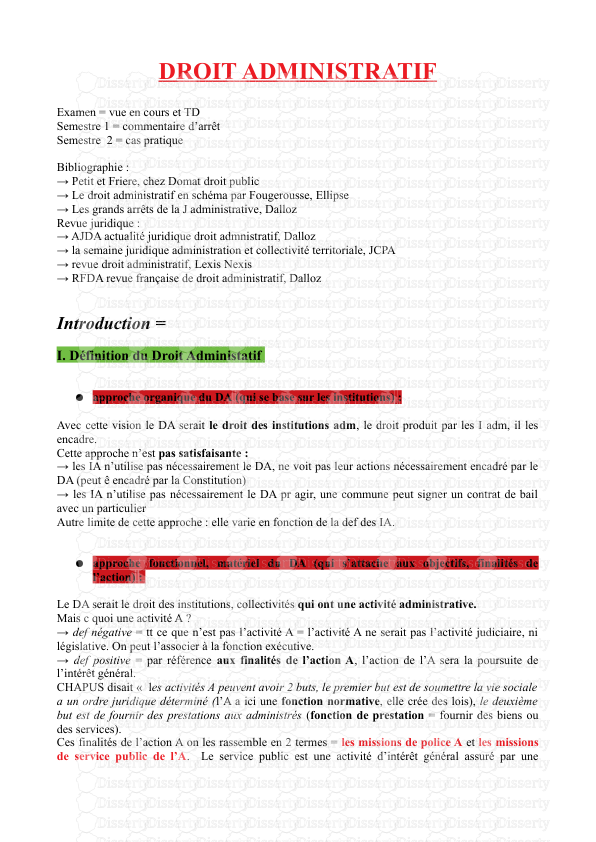DROIT ADMINISTRATIF Examen = vue en cours et TD Semestre 1 = commentaire d’arrê
DROIT ADMINISTRATIF Examen = vue en cours et TD Semestre 1 = commentaire d’arrêt Semestre 2 = cas pratique Bibliographie : → Petit et Friere, chez Domat droit public → Le droit administratif en schéma par Fougerousse, Ellipse → Les grands arrêts de la J administrative, Dalloz Revue juridique : → AJDA actualité juridique droit admnistratif, Dalloz → la semaine juridique administration et collectivité territoriale, JCPA → revue droit administratif, Lexis Nexis → RFDA revue française de droit administratif, Dalloz Introduction = I. Définition du Droit Administatif ●approche organique du DA (qui se base sur les institutions) : Avec cette vision le DA serait le droit des institutions adm, le droit produit par les I adm, il les encadre. Cette approche n’est pas satisfaisante : → les IA n’utilise pas nécessairement le DA, ne voit pas leur actions nécessairement encadré par le DA (peut ê encadré par la Constitution) → les IA n’utilise pas nécessairement le DA pr agir, une commune peut signer un contrat de bail avec un particulier Autre limite de cette approche : elle varie en fonction de la def des IA. ●approche fonctionnel, matériel du DA (qui s’attache aux objectifs, finalités de l’action) : Le DA serait le droit des institutions, collectivités qui ont une activité administrative. Mais c quoi une activité A ? → def négative = tt ce que n’est pas l’activité A = l’activité A ne serait pas l’activité judiciaire, ni législative. On peut l’associer à la fonction exécutive. → def positive = par référence aux finalités de l’action A, l’action de l’A sera la poursuite de l’intérêt général. CHAPUS disait « les activités A peuvent avoir 2 buts, le premier but est de soumettre la vie sociale a un ordre juridique déterminé (l’A a ici une fonction normative, elle crée des lois), le deuxième but est de fournir des prestations aux administrés (fonction de prestation = fournir des biens ou des services). Ces finalités de l’action A on les rassemble en 2 termes = les missions de police A et les missions de service public de l’A. Le service public est une activité d’intérêt général assuré par une personne public. La police A est l’ensemble des mesures adoptés par l’A pour préserver l’ordre public. Des personnes privées peuvent aussi avoir une activité A, une mission de service public. Le droit dont il sera question dans ce cours, le DA, sera le droit spécifique= différent du droit commun (c’est un droit qui encadre mais aussi qui est produit) qui s’applique aux activités A. Le DA a normalement une finalité d’intérêt général mais il est tjr la concrétisation entre les équilibres entre des nécessités d’intérêt général et la préservation de l’intérêt des particulier. La particularité du DA se traduit par des privilèges et des obligations imposé à l’A. Le DA est un droit composé de prérogatives reconnue à l’A. Exemple : la capacité d’adopter des décisions unilatérales qui s’impose aux administrés et modifie l’ordonnancement juridique. Exemple : les contrats de l’A connaissent un régime bien particulier ds lequel l’A dispose de pouvoirs qui n’existent pas dans les contrats de droit privé. Exemple : l’A a la possibilité de constituer des monopoles pr exercer des activités cad empêcher la concurrence lorsqu’elle a une fonction de prestation. L’A est soumise a des obligations qui n’existe pas autant ds le droit commun, ce sont des suggestions qui s’impose à l’A. Exemple : qd l’A passe des contrats elle dois respecter le principe de non utilisation des données publiques et un principe d’égalité Exemple : l’A qd elle recrute ses personnels doit respecter le principe d’égalité ce qui engendre un recrutement sur la base de concours II. Comment s’est construit le DA ? ●L’autonomisation progressive du DA La Révolution va favoriser l’apparition du DA. → l’autonomisation de la fonction A Cette autonomisation va se traduire par un certain nb de texte notamment par la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l’organisation judiciaire, notamment à travers l’art 13. On retient l’idée qu’il y a bien une spécificité de la fonction A. Le juge judiciaire n’a pas à connaître l’action de ceux qui ont une fonction A. Il y a après la Révolution l’émergence d’un pv réglementaire = le fait de pv adopter des normes de portée générale et absolue. Ce pv s’incarnera ds l’institution du préfet. → l’autonomisation de la justice A Les causes de cette autonomisation sont la loi de 1790(on écarte le juge judiciaire), et la C du 13 décembre 1799 art 52 = naissance d’une institution spécialisé ds l’A, aussi de l’art 75, et le décret du 2 sept 1796. Cette autonomisation de juge A va aussi passer par des textes et des décisions juridictionnels = loi du 24 mai 1872 qui organise la séparation des juridiction A et judiciaire. Cette loi est fondamentale car elle consacre le passage à la fin de la justice retenue et l’arrivée de la justice déléguée. Avant cette date, les décisions du juge A n’était exécutoire qu’à partir du moment qu’elle avaient été signé par le chef de l’état. Les arrêts et les jugements sont mtn rendu au nom du peuple français. L’arrêt CADOT du 13 dec 1889 est la deuxième étape de l’évolution, il met fin à la théorie du ministre juge, avant cette décision le principe était que les contestations des décisions administratives devaient ê adressé en premier lieu au ministre compétent et non pas à la juridiction administrative. Ds l’arrêt Cadot, le conseil d’état inverse la logique, il se reconnaît compétent par principe pour connaître les contestations relatives aux dispositions administratives sauf si un texte prévoit expressément la compétence du ministre en la matière. Les décisions de la juridiction administrative sont rendu après qu’un rapporteur public/commissaire du gouvernement ait proposé les conclusions = son rôle est de proposer une solution. La plupart du temps le rapporteur public est suivi ds ces décisions. Ou alors c’est une CCL contraire à la décision. → l’autonomisation du droit administratif Ce qui s’affirme c le droit A en temps que droit spécifique distinct du droit commun. On voit cette affirmation avec la décision du 8 fev 1873, l’arrêt BLANCO = cela affirme la spécificité du droit A, la spécificité de la compétence de la juridiction administrative. La responsabilité du fait de l’action du service public ne peut pas ê régit par les principes du droit commun. ✔ l’arrêt Blanco constitue l’affirmation de la compétence de la juridiction A pr connaître des litiges qui impliquent l’application du droit A, ✔ il lie la compétence et le fond, ✔ il permet d’identifier la spécificité du droit A. Cette autonomisation s’est aussi réalisé sous l’influence d’universitaires et de membres de la juridiction A, les commissaires du gouvernement ont joué un rôle fondamental. A leur côté des universitaires ont tenté de construire des théories permettant de définir le droit A. ➢HAURIOU, doyen de la faculté de Toulouse, il fondait le droit A sur l’idée de puissance publique, ➢DUGUIT, doyen de la faculté de Bordeaux, pr lui le droit A s’explique par sa finalité à savoir le service public, ●Les caractères principaux du DA La vision du DA va impliquer des caractéristiques particulières avec des finalités du DA qui impliquent des moyens particuliers et des agents particuliers. On a un droit aussi qui va ê construit par le juge à côté des textes ou sans texte. On a aussi une volonté de théoriser, d’expliquer le droit A ds la doctrine. C’est aussi un droit qui va lier la personne publique avec le droit A. Ajd le droit adm a largement évolué = → sur l’approche organique : des personnes privé peuvent ajd adopté des actes A → remise en cause de la place du fonctionnaire ds le fonctionnement de l’administration → la compétence de la juridiction A est encore déterminé par les critères évoqué mais elle est transformé par des dispositions législatives. → le droit A n’est plus composé de règles spécifiques et emprunte aux principes du droit privé → le droit A n’est plus uniquement un droit jurisprudentiel, il a bcp de domaines du droit A qui sont codifié (par ex code des relations entre publiques et administrations). Une ordonnance c une décision que rend le juge en tant que juge des référés = un référé permet de prendre une décision en situation d’urgence pr faire cesser une inégalité. Méthode du commentaire d’arrêt ✔ phrase d’accroche : référence à l’actualité juridique, à l’intérêt juridique ✔ présenter l’arrêt ✔ fiche d’arrêt → quel est la demande du requérant= on attaque un acte → présenter les faits et la procédure → les moyens du requérant → le raisonnement du juge (les motifs) → le dispositif (décision du juge) ✔ intérêt du sujet ✔ problématique du commentaire ✔ annonce du plan qui répond à la problématique = on annonce seulement I et II On doit ê en capable de mettre en perspective la décision. PARTIE 1 = Les sources du droit administratif La pyramide des normes va induire une architecture des contrôles cad que pr uploads/S4/droit-administratif 2 .pdf
Documents similaires










-
145
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3284MB