© Éditions Robert Laffont S.A.S., Paris, 2015, 2017 EAN : 978-2-221-20366-8 ISS
© Éditions Robert Laffont S.A.S., Paris, 2015, 2017 EAN : 978-2-221-20366-8 ISSN 2267-182X En couverture : Conception graphique : Joël Renaudat / Éditions Robert Laffont « Cette œuvre est protégée par le droit d’auteur et strictement réservée à l’usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre, est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. L’éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales. » Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo. Suivez toute l’actualité des Éditions Robert Laffont sur www.laffont.fr À mon père, qui aurait adoré lire ce livre Avant-propos « Non mais vous gobez vraiment n’importe quoi ! » Nous étions en 2010, et je m’adressais, indignée et consternée, à ma classe de terminale. Au début de cette année scolaire, j’étais pleine de bonnes intentions. D’ailleurs, quand j’avais élaboré ma progression pédagogique (les thèmes à traiter en cours en fonction du programme), j’avais eu l’impression d’avoir une idée géniale. Il existe un journal gratuit américain appelé The Onion, qui a maintenant son équivalent en France, ou du moins une version approchante : Le Gorafi. On trouve dans ces journaux des articles construits exactement sur le même modèle que de vrais articles de presse, sauf que tout y est faux, et que les sujets confinent à l’absurde. Ce décalage m’intéressait énormément. Pour l’année scolaire 2010-2011, j’avais décidé de parler de politique américaine, en prévision des primaires puis des élections présidentielles de 2012. J’avais pensé aussi, pour chacun des thèmes étudiés, inclure un article de The Onion, mais sans dire aux élèves d’où il provenait, et en l’abordant très sérieusement. Je les avais toutefois prévenus au début de l’année qu’un faux texte allait se glisser dans chaque partie du cours, à charge pour eux de le trouver, un peu comme un jeu. L’idée était à la fois de les amuser et de les obliger à garder les yeux ouverts, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu’on pouvait leur raconter. C’était une expérience. L’échec fut cuisant. On entend souvent les pessimistes dire que, de nos jours, la parole du professeur est contestée, discréditée, constamment mise en doute, comme l’autorité. On peut le déplorer. Il y a du vrai là-dedans. Ce qu’on pourrait prendre pour de l’esprit critique existe certes en classe, mais souvent il s’agit plutôt d’un rejet en bloc. Ce n’est pourtant pas cette réaction que j’ai rencontrée lors de mon expérience. « Dieu bénisse l’Amérique, et va te faire foutre, Nate ! » Pour étudier en classe de terminale les élections américaines de 2012, dont l’enjeu était la réélection de Barack Obama, j’avais trouvé un article qui datait des présidentielles de 2008. Le titre était : « Obama modifie son message Yes we can pour en exclure le minable du coin 1 ». Le « minable du coin » (area loser ou local loser en anglais) est un personnage fictif récurrent des articles de The Onion, que l’on imagine trentenaire, vivant chez sa mère, affalé en caleçon sur un canapé, ayant peu d’ambition à part celle de terminer son paquet de chips et son épisode de téléréalité avant la fin de la soirée. L’article était hilarant. Il mélangeait allusions sérieuses au message d’Obama et descriptions de ce personnage de minable appelé Nate Walsh. En conclusion était cité un discours (évidemment fictif) d’Obama qui se terminait ainsi : « Oui, nous pouvons, sauf Nate, prendre en main notre futur. Oui, nous pouvons, à l’exception de Nate et de son horrible short à poches de treillis qu’il ne lave jamais, tourner la page pour aller vers de nouveaux horizons. Je sais que nous – et quand je dis “nous”, je veux dire tout le monde sauf Nate – ferons face au cynisme, et aux doutes, et à la crainte, et à ceux qui nous disent que nous ne pouvons pas. Nous – une fois encore, sauf Nate – leur répondrons dans l’esprit du peuple américain en six mots simples : oui, nous pouvons, sauf Nate Walsh. » Obama ajoutait : « Dieu bénisse le peuple de Caroline du Sud, Dieu bénisse l’Amérique, et va te faire foutre, Nate ! » Ce texte est très intéressant à étudier en cours d’anglais pour des élèves de terminale parce qu’il reprend des expressions réellement utilisées par Obama. Aujourd’hui, il rappelle d’ailleurs, dans une perspective plus large d’analyse du discours politique contemporain, la fameuse anaphore « Moi, président » de François Hollande en 2012. Mais je trouvais que c’était un peu trop facile, je me disais que mes élèves, même les plus mal réveillés ou les plus inattentifs, allaient voir tout de suite qu’il s’agissait d’une fiction, ne serait-ce qu’à cause de la fin. Quand j’ai distribué cet article, contrairement à Barack Obama, je n’ai fait face ni au cynisme, ni au doute, ni à la crainte, mais à trente-quatre élèves par ailleurs parfaitement intelligents et raisonnables, qui lisaient le discours très sérieusement. Seule une petite voix a fini par s’élever au bout de quelques minutes : « Mais, madame, il est… enfin, l’article, il est… vrai ? » Si j’avais pu, rien que pour cette phrase, j’aurais augmenté la moyenne de cette élève de cinq ou six points. Ce jour-là, je me suis dit qu’il était temps de faire quelque chose. Mais quoi ? « Tu veux pas venir au Rwanda, samedi ? » Ce qui me contrariait le plus n’était pas nécessairement l’absence d’esprit critique de mes élèves, mais plutôt leur difficulté à l’exercer à bon escient. Nous sommes tous capables de nous montrer sceptiques, parfois à tort et à travers. Le problème qui s’est posé à moi était plutôt le suivant : pourquoi abdiquons-nous une faculté que nous possédons pourtant ? En d’autres termes, quelles sont les conditions d’une croyance aveugle à ce qui se présente ou nous est présenté comme de l’information ? Après l’épisode Nate Walsh, j’ai tenté de trouver un remède. J’étais en pleine lecture de La Fabrique du consentement de Noam Chomsky et je ne cessais de penser à une phrase du célèbre linguiste : « Si nous avions un vrai système d’éducation, on y donnerait des cours d’autodéfense intellectuelle 2. » Nous avons un vrai système d’éducation. Alors pourquoi pas, après tout ? L’été arrivait, j’aurais le temps de réfléchir, d’imaginer des objets d’étude, une approche intéressante. Un événement est venu donner une tournure différente au projet. Le premier jour des épreuves du bac, vers 18 heures, je m’apprêtais à quitter le lycée lorsque ma collègue Laure m’a arrêtée dans un couloir : « Dis donc, tu as quelque chose de prévu, ce week-end ? » Non, j’étais libre pour aller boire des mojitos, par exemple. « Tu veux pas venir au Rwanda, samedi ? » Ah ! Laure avait organisé un voyage scolaire à Kigali avec ses élèves de première professionnelle et quelques-uns de mes terminales (ceux qui aimaient bien les discours de Barack Obama). Un travail était mené avec une école rwandaise et un groupe d’élèves tutsis rescapés, ainsi que plusieurs associations culturelles ou regroupant des orphelins ou des veuves du génocide. J’étais au courant du projet, mais je n’en faisais pas partie. Cependant, deux des professeurs accompagnateurs étaient finalement coincés en France, d’où l’invitation de ma collègue. J’ai bien sûr accepté tout de suite. Sans aucune préparation, avec pour seules connaissances sur l’histoire du Rwanda ce que j’en avais appris à l’école, et à peine le temps de faire quelques lectures. Une fois à Kigali, le choc n’a pas été immédiat. Il s’est produit deux ou trois jours après mon arrivée, pendant la visite du mémorial de Gisozi, le plus grand de Kigali. On peut y voir des tombes à ciel ouvert, avec dans certains cercueils les ossements de plusieurs personnes lorsque les corps n’ont pu être entièrement reconstitués. On m’avait dit que le plus difficile était la visite de la salle des enfants, où se trouvaient de grandes photos, avec sous chacune une biographie du petit massacré : son plat préféré, son meilleur ami, la façon dont il était mort. Pour moi, le choc a pourtant eu lieu dans la salle suivante, dont les murs étaient recouverts d’une gigantesque mappemonde sur laquelle étaient indiqués tous les génocides au fil de l’histoire : le groupe ciblé, le nombre de morts. Je me suis dit alors que personne n’était à l’abri, quelle que soit la région du monde où il vivait. La marche du progrès n’y changeait rien. Les génocides pouvaient avoir lieu partout et tout le temps. Je ne savais plus quoi penser de la nature humaine. Cependant un autre point m’obsédait : la façon dont le Rwanda en était arrivé là, les mécanismes ayant mené à une extermination aussi méthodique, et surtout ces discours de haine qui avaient largement contribué à l’organisation du massacre. « C’est pour ça uploads/S4/ sophie-mazet-manuel-dautodefense-intellectuelle 1 .pdf
Documents similaires





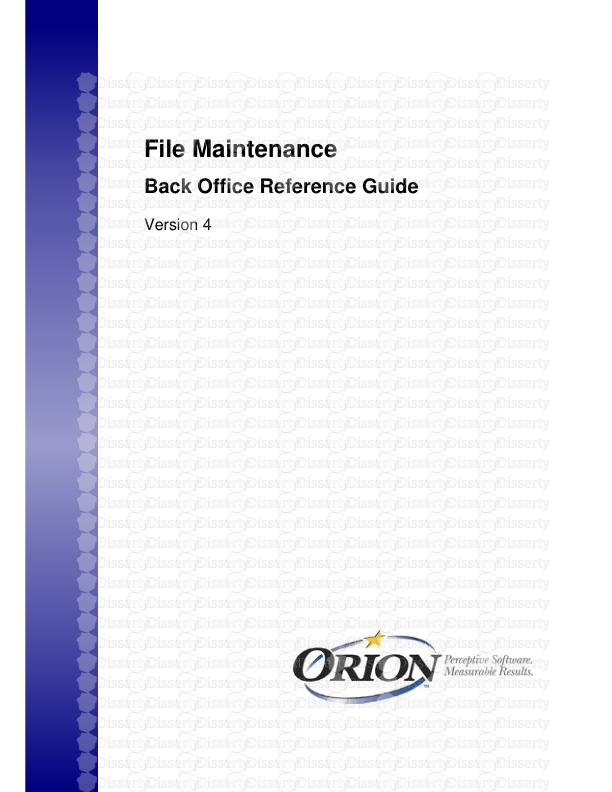




-
39
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 1.4391MB


