Les Quatrains d'Omar Kháyyám, traduits du persan sur le manuscrit conservé à la
Les Quatrains d'Omar Kháyyám, traduits du persan sur le manuscrit conservé à la "Bodleian Library" d'Oxford, publiés [...] Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Ham Nšpr, al-Dn ab al-fat Omar bin Ibrhm (1048-1131). Les Quatrains d'Omar Kháyyám, traduits du persan sur le manuscrit conservé à la "Bodleian Library" d'Oxford, publiés avec une introduction et des notes, par Charles Grolleau. 1902. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. BmHjj^3ïiSiEBOEE3 Tiré à cinq cents exemplaires, tous numérotés et paraphés par l'éditeur, savoir : 15 sur papier de Chine, de i à 15 ; 3o sur papier du Japon, de i6 à 45 ; 455 sur vergé d'Arches, de 46 à 5oo. LES QUATRAINS d'Omar Khâyyâm traduits du persan sur le manuscrit conservé à la BODLEIAN LIBRARY d'Oxford publiés avec une Introduction et des Notes PAR CHARLES GROLLEAU CHAT{fES CAT{1{mGTCm i3, Faubourg Montmartre PARIS 1902 A ALBERT SÉR1EYS Son ami C. G. INTRODUCTION JJVTTiOmiCTlOJV m&£$\ A P°^s'e a cec' de divin qu'elle échappe, •J|§ip aussi bien par son essence que par ses manifestations, aux mensonges dorés des exhi- bitions et des musées. On l'entend ou on ne l'entend pas : c'est af- faire de surdité ou de clairaudience spirituelle, mais on ne peut l'abstraire de la vie intérieure dont elle est l'expression musicale, pour la clouer, morte, au mur d'une galerie. Pourtant, figée dans le langage humain, elle participe, dans une certaine mesure, à ses infir- mités dont la plus grande est d'être multiforme, 2 -( ,0 )«- ce qui limite son pouvoir, au double point de vue de l'expression et de la transmission universelle. De l'aveu même de ceux qui nous apportent ses indicibles messages, les plus beaux vers ne sont qu'un faible écho des harmonies qu'ils ont perçues. Que dirons-nous donc, lorsque, reprenant l'oeuvre à son tour, le traducteur en change la forme native et prétend nous en conserver la beauté ? Besogne ingrate, s'il en fut jamais. Par quel sortilège est-il possible qu'une étude fervente nous initie à la beauté extérieure comme à celle intime et essentielle d'un chef-d'oeuvre en langue étrangère, et que, devenus conscients de l'émotion subie, pouvant l'analyser et en disserter, nous ne puissions la restituer dans notre langue maternelle, intégrale et non défor- mée? Faut-il conclure de cette faiblesse à l'inanité des traductions? Ce serait fermer la porte qu'elles entr'ouvent, du moins, et qui laisse filtrer de nouvelles lueurs de l'universelle Beauté. Ce serait, en tout cas, laisser sans aliment le désir légitime et très fécond d'aller, à travers elles et par elles, vers le chef-d'oeuvre lui-même. Quand il s'agit, d'ailleurs, d'un chef-d'oeuvre incontesté, les différences que l'on note entre les traductions et l'original sont intéressantes, parce qu'elles révèlent, si elles ne procèdent pas de l'incapacité du traducteur, les multiples motifs d'émotion que contenait intrinsèquement cet original. Que ceci serve de préambule et d'excuse à la traduction des Quatrains d'Omar J^hâyyâm, offerte par nous au lecteur français. Cette tra- duction se justifie, du reste, par ce fait que de nombreux manuscrits existent, tous reflétant —( >2 )— jusqu'à un certain point la pensée du poète persan, mais n'offrant pas, comme celui-ci, une homogénéité parfaite. Il serait difficile, il est vrai, d'affirmer qu'il est le seul authentique parmi ceux que conservent les Bibliothèques d'Europe. Ce qui est cer- tain, c'est qu'il est le plus ancien (1460 de l'ère chrétienne), qu'il contient seulement cent cin- quante-huit quatrains, sans répétitions formelles, sans contradictions de pensée et, pour celui qui s'est donné la peine de vérifier la plupart des versions publiées jusqu'à ce jour, donne bien l'impression d'une oeuvre originale. Je ne songe point à médire du travail de mon devancier, M. Nicolas, si érudit, si conscien- cieux, qui essaya jadis de faire connaître en France l'oeuvre de Khâyyâm. Ce qui fit avorter cette honorable tentative, ce ne fut pas tant la traduction elle-même que le choix du manuscrit. Des quatrains, évidemment apocryphes, y abon- -( .3 y- dent, où la pensée maîtresse se noie en de mul- tiples répétitions. Du fait de son originalité même, le livre des Rubaiyat fut, depuis des siècles, en proie aux scoliastes de toutes les écoles. L'indécision de l'âme de Khàyyâm, son douloureux scepticisme qui cherche à s'apaiser dans les joies brèves du réel et du palpable, ses cris d'angoisse devant la Destinée que son éducation première lui mon- trait implacable, sa science amère, tout cela pou- vait bien apparaître à l'observateur non prévenu comme suffisamment et clairement expliqué, mais la phraséologie orientale, enveloppant de son voile de brume pailletée cette pensée morne et plaintive, lui donnait l'aspect mystérieux d'un symbole, et les Soufis en revendiquèrent pour eux seuls l'interprétation définitive. Petits bré- viaires pessimistes, horx nocturnse du rêve impuissant, des copies circulaient, sans doute, partout où la langue persane était comprise -.( 14 )— et admirée, et chacun inscrivait aux marges les motifs que son âme exécutait sur le même thème. Peut-être des quatrains, vraiment nouveaux et s'appariant comme pensée et comme forme aux quatrains authentiques, s'ajoutèrent-ils ainsi à l'oeuvre originale, mais il est probable que de plates redites et de ridicules amplifications vinrent grossir le nombre, sans doute restreint, des quatrains dus à l'âme désenchantée du vieux Khâyyâm. Mais la destinée de cette oeuvre curieuse n'était pas seulement que sa sobriété, son élégance émouvante et simple, unique dans la littérature persane, disparût pour faire place à des ampli- fications de rhétorique : elle devait plus tard ser- vir de motif à des interprétations absolument contradictoires. Celle qu'a voulue M. Nicolas n'est pas la moins étrange, et j'en dirai plus loin quelques -( '5 y- mots. J'ai d'abord à noter rapidement ce que nous savons de la vie de Khâyyâm. Les renseignements, glanés çà et là dans les écrits arabes ou persans, ne permettent que de tracer une biographie très brève. Le poète astronome naquit probablement en l'an 433 de l'hégire (1040 de l'ère chrétienne), à Nishapour, ville alors célèbre, dont la renommée contrebalançait celle de Bagdad et du Caire, et que devait ruiner pour jamais, au treizième siècle, le grand massacreur Gengis-Khan. 11 mourut à une date qu'il est possible de fixer entre 1111 et n35; les témoignages les plus autorisés parlent de 1123. Son nom de Khâyyâm paraît indiquer que son père exerçait le métier de « fabricant de tentes », mais il est peu probable qu'il l'ait entrepris à son tour, son existence ayant été toute consacrée à l'étude des sciences mathématiques et, en parti- culier, de l'astronomie. -( .6 )- L'histoire, ou la légende, veut qu'il ait été l'élève de Muvaffiq ed Din, un des plus fameux docteurs de Khorasan, et qu'il ait eu pour condisciples et pour amis deux enfants dont la destinée fut extraordinaire. L'un d'eux devait porter le nom célèbre de Nizam ul Mulk, le vizir d'Alp Arslan, puis de Melik Shah, fils et petit-fils du Tartare Toghrul Bey, fondateur de la dynastie des Seljucides. L'autre était Hassan i Sabbah, celui qui devait être le fameux « Vieillard de la Montagne », uploads/S4/ les-quatrains-d-x27-omar-khayyam.pdf
Documents similaires

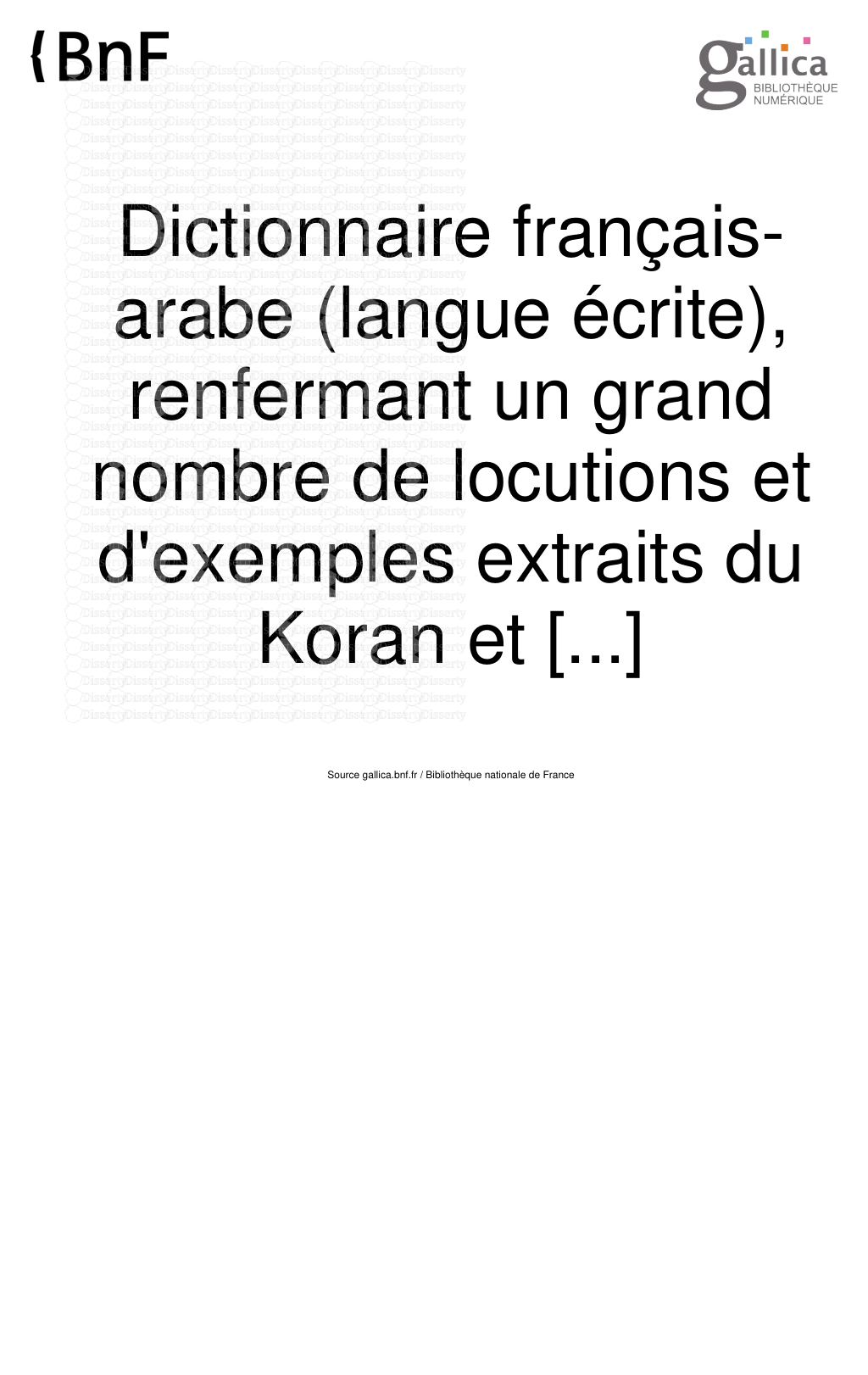



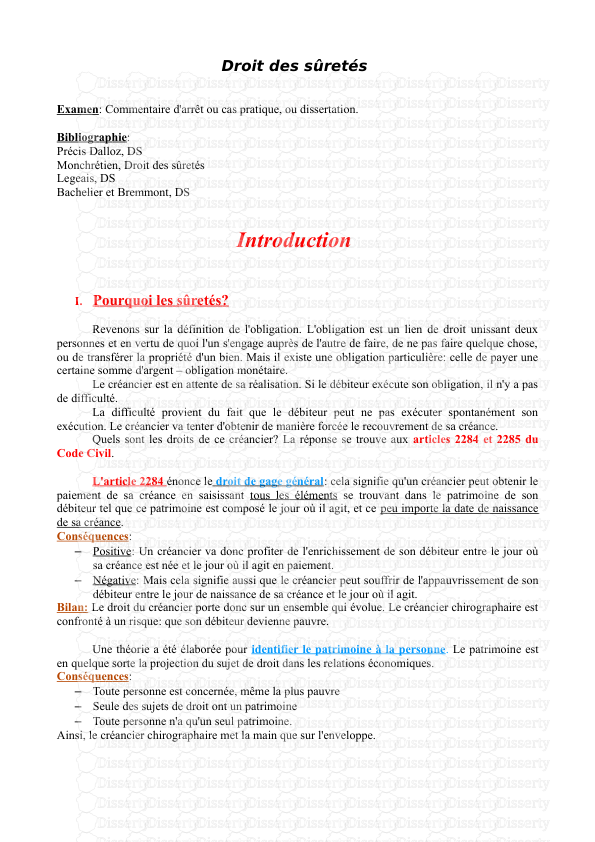




-
107
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 23.4093MB


