IUAINSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN DROIT CIVIL LES OBLIGATIONS : LE RÉGIME GEN
IUAINSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN DROIT CIVIL LES OBLIGATIONS : LE RÉGIME GENERAL DE L’OBLIGATION COURS DR SAMY Justine 13/11/2017 1 INTRODUCTION L’obligation est définie comme un lien de droit en vertu duquel le créancier peut exiger de son débiteur l’accomplissement d’une prestation. On distingue ainsi 3 éléments dans l’obligation : • C’est un lien de droit ayant un caractère contraignant. Ceci permet de distinguer l’obligation civile qui est pourvue de contrainte de l’obligation naturelle, dont l’exécution ne dépend en principe que du bon vouloir du débiteur ; • C’est un lien entre 2 personnes. On a un sujet actif qui est le créancier et un sujet passif qui est le débiteur : c’est un droit personnel. L’obligation étant un lien entre 2 personnes, se distingue du droit réel, qui est un droit qui porte directement sur un bien. • L’obligation appelée encore créance porte sur un objet qui est l’accomplissement d’une certaine prestation (obligation de donner, obligation de faire, obligation de ne pas faire). Cette créance qui est la satisfaction due sous forme d’action ou d’omission traduit le caractère vénal de l’obligation. Le régime général de l’obligation renvoie à l’ensemble des règles qui sont applicables à l’obligation indépendamment de sa source. Qu’elle soit issue d’un acte juridique (article 1101 du code civil), d’un fait juridique ou de l’autorité seule de la loi (article 1370 du code civil), l’obligation est soumise à un régime uniforme : elle donne des droits au créancier, elle peut être affectée de certaines modalités, elle peut circuler, se transformer, s’éteindre etc. ce régime est général car il exclut les règles spéciales, propres à certaines obligations. Ce concept de « régime général de l’obligation » est ignoré du code civil de 1804 mais issu de la doctrine. Toutefois en France, la réforme du droit des obligations, issue de l’ordonnance du 10 février 2016 consacre ce concept. Dans le cadre de ce cours, nous étudierons d’abord les caractères ou modalités pouvant affecter l’obligation et qui permettent de comprendre le fonctionnement de l’obligation quel que soit sa source. (1ère partie). La force contraignante de l’obligation exige que le débiteur puisse exécuter sa prestation : c’est le droit à l’exécution du créancier qui se manifeste par plusieurs moyens (2ème partie). Par ailleurs, en tant qu’élément du patrimoine l’obligation est aussi une créance ou une dette susceptible d’être transmise par le débiteur ou le créancier. Ces opérations sur obligations feront l’objet d’étude (3ème partie). Enfin l’exécution de l’obligation qui se réalise normalement par le paiement entraîne son extinction (4ème partie). 2 3 PREMIÈRE PARTIE : LES MODALITÉS DE L’OBLIGATION Les modalités de l’obligation traduisent certaines particularités ou certaines manières d’être de l’obligation. L’obligation simple est un lien de droit entre un seul créancier et un seul débiteur pour l’accomplissement d’une seule prestation. Elle implique une exécution immédiate et sans condition. Il peut arriver que l’obligation soit assortie de certaines modalités. Soit qu’elle comporte plusieurs objets ou plusieurs sujets : les modalités affectent le lien d’obligation ou la structure de l’obligation (chapitre I). Soit que l’obligation ne sera exécutée qu’à partir d’une certaine date ou ne naîtra que si tel évènement se réalise : ce sont les modalités temporelles (chapitre II). CHAPITRE I- LES MODALITÉS STRUCTURELLES La structure d’une obligation ou le lien d’obligation peut être affectée par la multiplication des objets dus ou par la multiplication des sujets de l’obligation. On parle alors d’obligations complexes. SECTION 1 : LA PLURALITÉ D’OBJETS Il y a pluralité d’objets lorsque le débiteur peut être amené à exécuter des prestations différentes. On distingue l’obligation conjonctive ou cumulative, l’obligation alternative et l’obligation facultative. § 1- L’OBLIGATION CONJONCTIVE OU CUMULATIVE Elle est celle qui oblige le débiteur à exécuter plusieurs prestations cumulativement. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le débiteur doit cumulativement au même créancier, plusieurs prestations en vertu d’une obligation unique. Et il ne peut se libérer qu’en les fournissant toutes. Exemple : le contrat de vente porte à la fois sur un meuble et un immeuble. Exemple : la vente porte à la fois sur un immeuble et un fonds de commerce ; le donataire assume la charge de loger et nourrir un tiers. 4 Exemple : le contrat de vente portant sur une voiture neuve prévoit que l’acheteur devra non seulement payer une somme d’argent, mais également remettre son ancien véhicule au vendeur. En principe l’obligation conjonctive ne soulève pas de difficultés d’exécution. Le débiteur doit exécuter toutes les différentes prestations pour être libéré à moins qu’il n’ait été stipulé la possibilité d’une exécution partielle ou successive. L’obligation conjonctive ne doit pas être confondue avec l’hypothèse où dans un contrat portant sur un objet, le débiteur est assujetti à plusieurs obligations. Ex : dans le contrat de vente, le vendeur assume plusieurs obligations : transférer la propriété de la chose vendue, livrer la chose vendue, garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue et contre son éviction. § 2- L’OBLIGATION ALTERNATIVE Selon l’art. 1189 C. Civil, elle est celle qui, ayant pour objet deux ou plusieurs prestations, permet au débiteur de se libérer complètement par l’accomplissement d’une seule d’entre elles. Exemple 1 : Le débiteur doit au créancier une maison ou une certaine somme d’argent. Exemple 2 Le donataire devra loger un grand parent ou lui verser une rente de tel montant. CHOIX DE LA PRESTATION : En principe selon l’art. 1190 C. Civil, c’est au débiteur de choisir la prestation qui va le libérer. Mais une clause du contrat peut réserver le choix au créancier. Dans cette hypothèse, le choix est irrévocable. Que le choix appartienne au créancier ou au débiteur, le créancier ne peut être contraint d’accepter une partie d’une des prestations et une partie de l’autre et le débiteur ne peut choisir ou être contraint d’exécuter partie d’une prestation et partie de l’autre. L’obligation alternative peut redevenir pure et simple dans 2 hypothèses : •Si l’une des prestations est impossible ou illicite : selon l’art. 1193 al. 1, l’obligation alternative devient pure et simple si l’une des prestations ne peut être exécutée en raison d’un cas de force majeure ; •Lorsque l’une des 2 choses promises vient à disparaître par la faute du débiteur, celui-ci se libère en remettant l’autre chose. Le prix de la chose disparue ne peut pas être offert à la place. Toutefois, lorsque le choix de la prestation a été réservé au créancier, et que la perte du bien est due à la faute du débiteur, alors l’art. 1194 prévoit 2 solutions : -en cas de disparition de l’une des choses promises, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui a disparue. 5 -en cas de disparition des 2 choses promises, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre chose à son choix. Dans l’obligation alternative, lorsque les 2 objets viennent à disparaître et que le débiteur est irréprochable, l’obligation est éteinte. § 3- L’OBLIGATION FACULTATIVE Le code civil1 ne prévoit pas cette modalité mais en pratique elle peut être envisagée. Dans cette obligation, une seule chose est due mais le débiteur, s’il le préfère a la faculté de se libérer en exécutant une autre prestation. L’option ne peut qu’appartenir au débiteur Exemple : le débiteur doit livrer un certain nombre de matériels informatiques. Il peut se libérer en exécutant une autre prestation, par exemple en versant une somme d’argent. Exemple : le contrat portant sur le dépôt de bijoux peut prévoir que le dépositaire de bijoux qui doit les restituer à une certaine date, pourra se contenter de verser une somme représentant la valeur des bijoux déposés. A la différence de l’obligation alternative, une seule chose est due à titre principal dans l’obligation facultative. Cette dernière ne comportant qu’un seul objet, est éteinte si l’objet vient à disparaître par cas fortuit avant l’exécution. La prestation de l’autre chose n’est pas une alternative pour le débiteur, mais c’est une facilité de paiement. Le débiteur ne doit la prestation subsidiaire que si la prestation principale périt par sa faute. De même le créancier ne peut exiger de lui que l’exécution de la prestation principale. L’obligation facultative se distingue de la dation en paiement par le fait que la prestation différente est prévue dès l’origine. Dans la dation en paiement, il ya exécution d’une prestation différente de celle prévue à l’origine, à la suite d’un nouvel accord des parties. 1 Toutefois, la reforme française du droit des obligations la consacre : article 1308 de l’ordonnance de 2016 6 SECTION 2 : LA PLURALITÉ DE SUJETS Il ya pluralité de sujets lorsque plusieurs créanciers ont droit à la prestation due ou que plusieurs débiteurs doivent exécuter une prestation au profit du créancier. Dans l’hypothèse où on est en présence de plusieurs créanciers : on parle de pluralité active ; et en présence de plusieurs débiteurs : on parle de pluralité passive. On distingue ainsi l’obligation conjointe, l’obligation solidaire, l’obligation in solidum, l’obligation indivisible. § 1- L’OBLIGATION CONJOINTE L’obligation conjointe profite à plusieurs créanciers ou pèse sur plusieurs débiteurs entre lesquels uploads/S4/ l2-obligation-3-2017-2018-2.pdf
Documents similaires









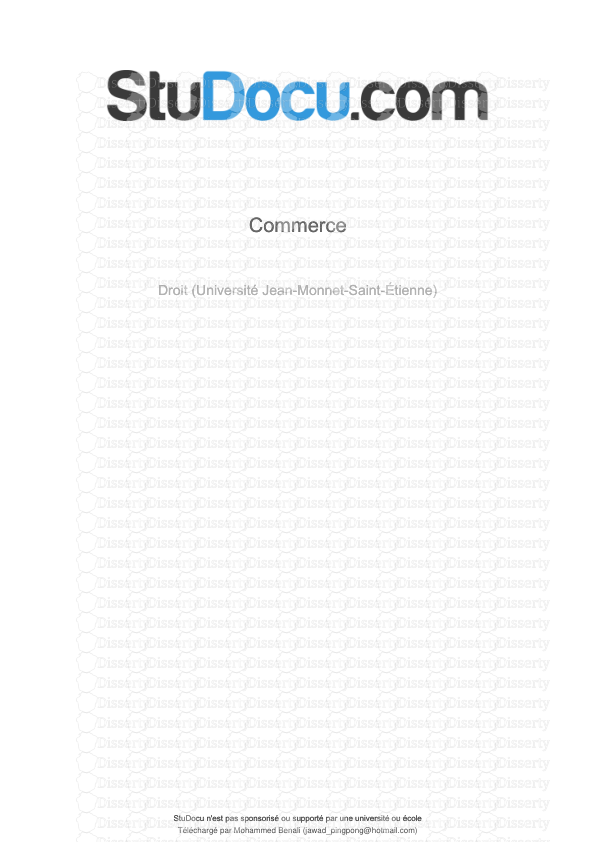
-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.4820MB


