Méthodologie de l’introduction du commentaire d’arrêt POSTED ON 2 A V R I L 2 0
Méthodologie de l’introduction du commentaire d’arrêt POSTED ON 2 A V R I L 2 0 1 2 Le commentaire d’arrêt est un exercice purement académique si bien qu’il apparaît souvent aux yeux de l’étudiant de première année comme inutile, à l’instar de son formalisme jugé trop contraignant. En réalité ses bénéfices sont doubles. D’abord sur le fond, savoir analyser un arrêt pour en dégager l’apport et en esquisser les suites prévisibles est indispensable à la pratique de n’importe quelle profession juridique. Le droit est vivant, les connaissances acquises lors des cours magistraux ne seront par conséquent jamais suffisantes, l’étudiant doit être capable de raisonner par lui même pour pouvoir les actualiser. Même dans un système de civil law victime de l’inflation législative comme le nôtre, la jurisprudence occupe une place prépondérante, plus encore dans certaines branches comme le droit de la responsabilité civile. Or, contrairement aux pays de common law, les arrêts de la Cour de cassation adoptent un style lapidaire qui rend leur compréhension malaisée à ceux qui ne sont pas rompus à la technique de cassation. L’exercice du commentaire d’arrêt permet donc de former l’étudiant à l’analyse de la jurisprudence afin qu’il puisse par la suite en extraire seul la quintessence, ce qui lui sera utile à l’exercice de sa profession quelle qu’elle soit (avocat, juriste d’entreprise, huissier, enseignant, etc). Ensuite sur la forme, qui peut paraître inutilement pesante, il s’agit cette fois d’apprendre à structurer son raisonnement. Avoir compris est une chose, faire comprendre en est une autre. Or, là encore quelle que soit sa profession future, l’étudiant sera amené à communiquer avec d’autres spécialistes ou des profanes, il devra donc être capable de retranscrire sa pensée de la manière la plus intelligible possible. Mieux, il devra souvent convaincre, la forme aura alors au moins autant d’importance que le fond. “La forme, c’est le fond qui remonte à la surface” écrivait Hugo. Nombre d’étudiants argueront que le cadre du commentaire d’arrêt a l’inconvénient de la rigidité, et que la pensée souvent complexe se laisse difficilement enfermer dans un cadre aussi simpliste. Pourquoi diable aller contre nature en cherchant à réduire son raisonnement à une division binaire quand l’arrêt répond à un pourvoi composé de trois moyens se prêtant ainsi a priori parfaitement à une division tripartite ? En réalité les commentaires qui peuvent difficilement se réduire à un raisonnement binaire sont extrêmement rares, l’étudiant doit faire un effort de conceptualisation pour réduire sa pensée à deux axes. Surtout, et on en revient toujours au même, il faut penser à son interlocuteur, rendre sa pensée la plus intelligible possible. Si l’on rédige un commentaire d’arrêt, c’est pour qu’il soit lu, en l’occurrence par un correcteur. Ce dernier a en général un nombre important de copies à corriger, et sa tâche serait extrêmement complexe si chaque étudiant adoptait une structure particulière pour son devoir. Certes, ce formalisme peut être un peu pesant pour l’étudiant, mais c’est un élément à part entière de la formation de juriste, l’étudiant doit être capable d’appliquer des règles de forme strictes. Que l’on songe aux avocats qui rédigent des conclusions ou mémoires, aux huissiers qui effectuent des actes de procédure ou encore aux magistrats qui rédigent des décisions, chaque profession juridique a sa part de formalisme. Après ce long propos introductif qui aura, à n’en pas douter, définitivement convaincu l’étudiant de l’utilité du commentaire d’arrêt, attaquons le vif du sujet. L’introduction est probablement la partie la plus formaliste du commentaire d’arrêt, elle ne laisse pas beaucoup de place à l’imagination excepté dans la phrase d’accroche et dans l’annonce de plan. Ces deux parties mises à part, l’introduction est mutatis mutandis une fiche d’arrêt, c’est-à- dire, très schématiquement : faits, procédure, problème de droit et solution. Il serait très difficile d’énumérer exhaustivement toutes les conventions d’usage applicables à l’introduction du commentaire d’arrêt, je n’ai nullement la prétention de condenser des années d’apprentissage en un simple billet de blog, et le résultat serait de surcroit probablement indigeste. Je tenterai par conséquent dans ce billet de rappeler les principales règles et celles qui sont, d’après ma modeste expérience de correcteur, les plus méconnues quantitativement. Pour illustrer le propos, j’utiliserai le célèbre arrêt Cruz rendu le 15 décembre 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation relatif à l’exécution forcée de la promesse unilatérale de vente. C’est un arrêt très court, qui a fait l’objet d’abondants commentaires de la part de la doctrine, et dont la solution ne semble toujours pas solidement fixée en jurisprudence. La promesse unilatérale de vente (souvent désignée par ses initiales PUV entre juristes) est parfois étudiée en droit des contrats, un cours dispensé en licence 2, ou en droit des contrats spéciaux, un cours dispensé en licence 3 ou en master 1 selon les universités, cependant on ne s’attachera que très peu au fond ici, c’est la méthodologie qui nous intéresse et donc la forme. Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y…, qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X… une promesse de vente d’un immeuble, valable jusqu’au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X…, ayant levé l’option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ; Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l’obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu’en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu’il s’agit d’une obligation de faire, la cour d’appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. LA PHRASE D’ACCROCHE Devant sa feuille blanche, l’étudiant de première année à la plume fébrile est saisi d’une question que l’on s’est tous posée : comment commencer son commentaire ? Certainement pas directement par les faits, ce serait très abrupt et c’est pourquoi on exige une phrase d’accroche. On parle communément de “phrase d’accroche”, mais en réalité il peut y en avoir deux ou trois tant que le tout tienne en un paragraphe de taille raisonnable. On doit retrouver dans l’accroche les références de l’arrêt commenté, c’est-à-dire la juridiction et la date, ce qui permettra ensuite d’attaquer les faits par “En l’espèce (…)”. A défaut d’inspiration on pourra utiliser une phrase vraiment très basique contenant les références de l’arrêt donc, mais aussi son thème. Le correcteur retrouvera probablement la même phrase d’accroche dans les trois quarts des copies, mais ce sera toujours beaucoup mieux que de ne pas en mettre, écueil que l’on retrouve malheureusement toujours dans quelques copies, quel que soit le niveau. Pour notre arrêt cela donnerait par exemple : Dans un arrêt du 15 décembre 1993, la troisième chambre civile de la Cour de cassation aborde le délicat sujet de l’exécution forcée en nature de la promesse unilatérale de vente. Les meilleurs étudiants, qui auront à coeur que leur copie se détache du lot, chercheront une phrase d’accroche plus originale. Toutes les phrases sont bonnes tant qu’elles ne sont pas hors sujet et qu’elles respectent les quelques règles qui ont été énumérées. Lors d’un devoir maison, il est relativement aisé de trouver une accroche originale car l’étudiant a le temps de chercher l’inspiration ou de trouver une citation. Lors d’une épreuve, limitée en général à trois heures, l’opération est beaucoup plus délicate car assez chronophage avec le risque pour l’étudiant, pressé par le temps, de se contenter finalement d’une accroche au lien très distendu avec l’arrêt commenté. La meilleure solution, bien que peu pédagogique, reste peut-être de noter quelques citations glanées au fil des lectures et de les apprendre par coeur avant l’épreuve, avec leurs références bien sûr car il faut offrir au correcteur le moyen de vérifier l’exactitude de la citation employée. En se débrouillant, on peut couvrir la totalité des arrêts potentiels avec seulement une petite dizaine de citations. Pour notre arrêt cela pourrait donner : “Tel l’orfèvre de la Renaissance qui ciselait ‘le combat des Titans au pommeau d’une dague’, le juriste moderne est capable d’enfermer dans une note d’arrêt des développements à l’infini” (Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Champs Flammarion, 1996, p. 72). L’arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation illustre parfaitement ce constat du regretté doyen Carbonnier, tant il a fait -et continue à faire- l’objet de nombreux commentaires, pour la plupart eschatologiques. L’utilisation d’une citation ou d’une anecdote en guise d’accroche n’est conseillée que uploads/S4/ intro-commentaire-d-x27-arret.pdf
Documents similaires

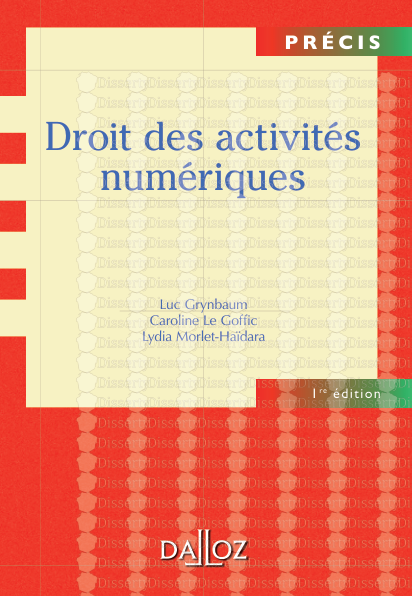

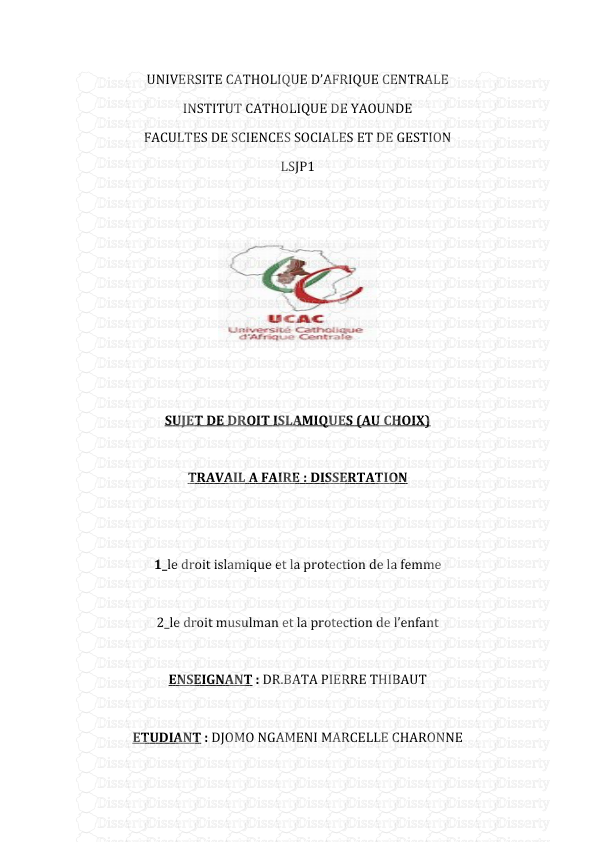






-
131
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2862MB


