Histoire du droit et des institutions publiques après 1789 : C'est l’histoire d
Histoire du droit et des institutions publiques après 1789 : C'est l’histoire des institutions, des règles qui encadrent le pouvoir (le gouvernement et les administrations) à partir de la révolution jusqu’à la fin du XIXe s. C'est l’histoire des régimes juridiques que les hommes se fixent. INTRODUCTION : Les institutions françaises à la veille de la révolution de 1789 CHAPITRE 1 : LA SOCIÉTÉ D’ANCIEN RÉGIME La société avant la révolution française était organisée par des règles juridiques. L’Ancien Régime est une société traditionnelle =société dans laquelle le passé fait le droit et ce qui existe a vocation a demeurer, ne doit pas être changé, doit perdurer. Ce qui existe depuis longtemps devient une règle, plus la règle est ancienne plus elle a de valeur et ne peut être changée. C'est aussi une société inégalitaire juridiquement : tous les individus qui forment la société n’ont pas les mêmes droits, cela dépend de leur groupe social, de leur métier, de leur origine sociale… ex : droit de propriété, droit de mariage, droit pénal… L’inégalité juridique se traduit par une société de corps : les individus sont intégrés dans différents corps et en fonction de ces corps (groupes) les droits sont différents ex : le droit du mariage n’est pas le même à Strasbourg qu’à Rouen : le droit territorial n’est pas le même. ex : les corps de métiers : chaque métier avait ses propres règles —> église = corps ecclésiastique. Les individus se définissent donc par l’appartenance a un corps, et non pas par leur personnalité ou autres caractéristiques individuelles. À ces groupes étaient attachés des privilèges (droit spécifique/droits particuliers attachés à une catégorie de population, attachés aux différents corps). Un privilège n’a pas de caractère négatif ou positif c'est un régime, un droit différent des autres. Dans une société traditionnelle personne ne peut toucher aux privilèges, pas même le roi. Section 1. Une société de corps : l’exemple des ordres Avant la révolution française, on parle d’ordres (et non pas de classe sociale) pour décrire la société. Cette division de la société en 3 remonte au début du Moyen-Age : cela consiste à diviser la société en fonction de la position que l’on occupe : 1/Le clergé 2/La noblesse 3/Le Tiers-état 1 À l’origine les clercs (membres du clergés) sont chargés d’une fonction religieuse, la noblesse sont les seuls à pouvoir porter des armes, puis il y a les « autres » : le Tiers-état (qui signifie 3e statut). Il y a une hiérarchie sociale entre ces 3 ordres : ces groupes ne sont pas égalitaires, les 2 premiers sont les ordres privilégiés (clergé+noblesse), car ils ont des droits spécifiques rattachés à eux mais le Tiers-état n’a pas de privilèges par rapport aux autres. L’appartenance aux 2 premiers confère une dignité, ils offrent une valeur particulière procurant un sentiment de supériorité à ses membres par rapport à ceux du Tiers-état. Cette hiérarchie sociale est intégrée. ex : les membres du Tiers-état s’écartent quand un noble arrivent, ils “reconnaissent“ son statut social comme supérieur au leur. Le clergé désigne les hommes d’église catholique. Ils sont considérés comme le 1er des ordres privilégiés car ils sont supposés amener la population au paradis. Toute une série de droits particuliers leur sont rattachés ex : prêtres pas le droit de se marier, d’avoir des enfants, de commercer, ne paie pas d’impôts… Mais le clergé ne représente seulement qu’ 1 à 2 % de la population. Il est socialement très diversifié : haut clergé : riches, très éduqués ou à l’inverse petits curés de campagne : pauvres, peu éduqués qui vivent dans les mêmes conditions que les paysans…. La noblesse est au départ un ordre de personne qui combattent, ce sont les seuls qui peuvent porter des armes, mais elle est plus tard devenue essentiellement composée de descendants d’anciens nobles (la noblesse est héréditaire). La noblesse peut aussi être accordée par le roi, c'est ce qu’on appelle l’anoblissement. Les privilèges attachés à la noblesse sont par exemple des privilèges fiscaux (les nobles ne paient pas d’impôts ou peuvent percevoir des impôts spécifiques…). La noblesse ne représente que 2 à 3 % de la population à la veille de la révolution. La noblesse c'est un ordre, un état (on le nait on le devient) alors que la seigneurie est une manière de détenir et d’exploiter les terres à la campagne, la seigneurie concerne donc uniquement la campagne. Souvent, à la campagne il y a un seigneur par territoire, le seigneur est toujours un noble et les terres lui appartiennent depuis des générations, il ne les exploite pas mais des paysans la cultive et l’exploitent. Le seigneur a concédé l’exploitation de la terre aux paysans depuis des générations mais en échange les paysans doivent payer des impôts aux seigneur pour pouvoir utiliser leur terre (une part des récoltes ex : 1/3 de la py de blé annuelle revient au seigneur, ou parfois de l’argent, ou même il y a une obligation des paysans de participer à des travaux appelés corvées ex : 1x par an les paysans doivent contribuer à l’entretien de la route du château). De +, les paysans n’ont pas le droit d’avoir de four, moulin ou autres outils de production donc pour en utiliser ils doivent payer une taxe. Il en est de même pour l’utilisation des ponts, la traversée des terres etc… (une sorte de droit de douane ou de péage pour chaque pont, chaque passage, chaque moulin….) Tous ces droits que perçoivent les seigneurs paraissent de - en - légitimes à la veille de la révolution ( néanmoins tous les nobles ne sont pas riches et tous les paysans ne sont pas pauvres). Tout ce qui relève de cette exploitation des terres et de ces impôts que payent les paysans s’appelle la féodalité ou les droits féodaux. 2 Le Tiers-état représentait 70 à 80% de la population française. Il est très diversifié incluant paysans et artisans dans les campagnes ou encore avocats et médecins dans les villes. Section 2. Une société catholique 1/L’unité religieuse du royaume Le catholicisme est ce qui reste du christianisme après la séparation avec le protestantisme. Il n’y a normalement qu’une seule religion pratiquée en France. Les sujets suivent la religion de leur souverain. Apres le XVIe s, la France devient une terre catholique jusqu’à la révolution, les autres religions n’y sont pas tolérées ni même l’athéisme. C'est une société religieuse pour laquelle la religion a une influence importante car elle sert à légitimer l’ordre social (inégalitaire) en disant que c'est ainsi que Dieu l’a crée : il est donc important de pouvoir maintenir l’unité religieuse du royaume. Pour qu’un système perdure les sujets doivent donc croire en la même religion que le roi pour pouvoir légitimer l’ordre social. Le protestantisme et le judaïsme ont tout de même perduré de manière cachée à cette époque. Il y avait beaucoup d’interdits juridiques pour les non catholiques, c'était un régime très restrictif et donc pas un régime de droit commun. 2/Le rôle social de l’Église Le catholicisme s’est structuré comme une institution au cours du Moyen-âge (hiérarchie, règles juridiques = presque une structure administrative). Il n’y avait aucune séparation entre l’Eglise et l’Etat : l’organisation de la société, comme l’organisation des pouvoir était liée à la religion. L’Etat ne se conçoit pas sans l’Eglise et l’Eglise ne se conçoit pas sans l’Etat. C'est ce qui explique le rôle fondamental de l’Eglise dans ses missions qui aujourd'hui relèveraient de l’Etat. ex : système éducatif : depuis le Moyen-Âge c'est l’Eglise qui est chargée de l’éducation et de l’instruction ou de l’assistance publique (hôpitaux gérés par l’Eglise). L’état civil (naissance, mariage, décès) était tenu par l’Eglise. Elle finançait tout le système d’instruction et d’assistance du pays car elle percevait des impôts (ex : la dîme), et aussi car elle était le premier propriétaire foncier du royaume : elle possédait entre 25% et 1/3 des terres de tout le royaume grâce aux dons des fidèles, se constituant ainsi un patrimoine considérable. L’église n’était pas directement en lien avec le pape, car les évêques, curés et autres hommes d’église considéraient le roi comme leur supérieur direct. 3 CHAPITRE 2 : LA MONARCHIE ABSOLUE Section 1. Les principes du gouvernement monarchique 1/Les fondements du pouvoir royal La France est une monarchie, une royauté et le pouvoir est entre les mains du roi. Sur le trône se succèdent les descendants d’Hugues Capet (roi) pendant plus de 800 ans. Il y a un fort lien entre pouvoir pq et religion en France. Le pouvoir du roi s’appuie, depuis le Moyen-Age, sur une légitimité religieuse. On dit que Dieu est à l’origine du pouvoir du roi, c'est lui qui a choisi à quelle famille donner son pouvoir et comment l’exercer. L’obéissance au pouvoir est aussi lié à la religion : la légitimité religieuse est donc très importante. Le sacre du roi est une cérémonie religieuse dirigée par l’archevêque de Reims qui marque le lien entre pouvoir politique et religion. Cette cérémonie symbolique démontre une légitimité religieuse (Louis uploads/S4/ histoire-du-droit-l1-droit-general.pdf
Documents similaires

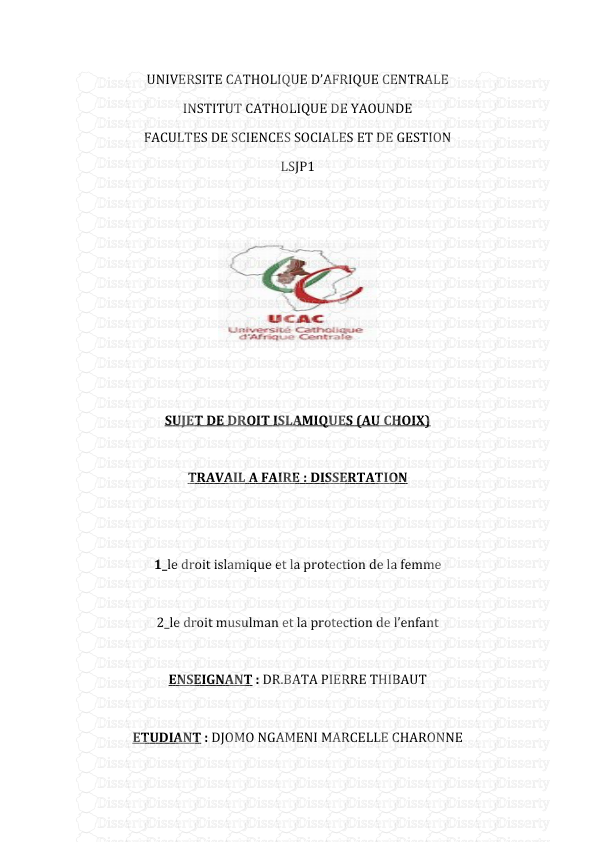








-
32
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5607MB


