UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS - PARIS II Année universitaire 2017-18 Deuxième année
UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS - PARIS II Année universitaire 2017-18 Deuxième année de la Licence en droit ou en science politique Cours de Monsieur le Professeur Olivier GOHIN DROIT ADMINISTRATIF I – équipe 2 (2055) PARTIEL DU 18 JANVIER 2018 (1er semestre – 1ère session) Durée de l'épreuve : 3 heures Documents autorisés : aucun _____________________________________________________ Les étudiants traiteront, au choix, l'un des deux sujets suivants : Sujet I : L’incompétence du juge administratif français en droit positif Sujet II : Commentez les extraits suivants de l’entretien exclusif donné, le 8 novembre 2017, par M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, à Acteurs publics (propos recueillis par MM. Bruno Botella et Pierre Laberrondo). Le Conseil d’État juge et conseille le Gouvernement. Comment voyez-vous évoluer cette double fonction ? Cette double fonction est essentielle car c’est l’identité même du Conseil d’État, son ADN. Elle nous permet de juger avec l’expérience de l’administrateur et de conseiller avec la sûreté du juge. Cela contribue à donner plus de pertinence et d’autorité à nos avis et à nos arrêts. Sentez-vous peser une menace sur cette double fonction ? Non. L’équilibre entre les deux fonctions a été clairement menacé dans les années 1980, quand le Conseil d’État était submergé par les appels. Ce problème a été résolu par la création des cours administratives d’appel et, aujourd’hui, au Conseil d’État, nous affectons les deux tiers de nos moyens à la fonction juridictionnelle et un tiers à la fonction consultative. Par ailleurs, des réformes internes ont été conduites pour assurer la séparation des fonctions et l’impartialité de nos procédures. La Cour européenne des droits de l’homme en a pris acte. Notre dualisme fonctionnel ne fait aujourd’hui plus débat. (…) Qu’est ce qui justifie aujourd’hui de conserver deux ordres de juridictions séparés, judicaire et administratif ? Le Premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, a récemment remis en cause cette dualité… Cette dualité n’est en rien une exception française. Elle s’inscrit dans un courant universel de spécialisation qui va de pair avec la diversification et la complexification du droit. Même le Royaume-Uni, pays de l’unité de juridiction par excellence, a créé des administrative tribunals, spécialisés dans le contentieux administratif. Mais pourrait-on au moins envisager un corps unique de magistrats ? Je ne pense pas que la massification de la justice soit la bonne réponse. Par ailleurs, il faut rappeler que la dualité des ordres juridictionnels procède d’un principe constitutionnel et de la conception française de la séparation des pouvoirs. Il serait absurde de réviser la Constitution à cette fin. Il me semble que les deux ordres ont assez à faire, ensemble et séparément, pour dispenser aujourd’hui une justice de qualité et qui progresse. Point n’est besoin de se perdre dans des débats qui ne résoudraient en rien les graves problèmes qui se posent à la justice française dans son ensemble. Enfin, la fusion des ordres de juridictions sonnerait le glas de la fonction consultative du Conseil d’État, si essentielle à la qualité du droit. (…) Quel regard portez-vous sur l’évolution du Conseil d’État depuis une dizaine d’années ? Est-il moderne, à l’écoute de son temps ? Le Conseil d’État s’inscrit dans la fidélité à une double tradition. D’une part, il est attaché à sa double mission de conseil et de contrôle, ainsi que d’éclairage du débat public par ses avis, ses arrêts et ses études. D’autre part, il continue de s’inscrire dans une tradition de protection des droits et des libertés et de défense de l’intérêt général. Une fois réaffirmé l’attachement à ces traditions, le Conseil d’État poursuit bien évidemment son adaptation aux transformations de ce monde, sur le plan jurisprudentiel, mais aussi dans l’exercice de sa fonction consultative. Par exemple ? Le Conseil d’État a pris en compte la réalité de la fonction de régulation et il y a adapté son contrôle, notamment en définissant des règles applicables au droit souple et aux décisions prises par les autorités de régulation. Je pense aussi aux contentieux économiques et au rôle du Conseil d’État au cours de la dernière décennie pour refonder le cadre juridique de la commande publique et du contrôle des contrats publics. Nous avons poursuivi des objectifs en apparence contradictoires : assurer l’effectivité des principes du droit des contrats et, en même temps, garantir la stabilité et la loyauté des relations contractuelles. Je crois que nous y sommes parvenus : l’effectivité des voies de recours et la sécurité juridique des contrats sont bien mieux garanties aujourd’hui. Il y a eu aussi l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)… L’attention croissante du Conseil d’État à la protection des droits fondamentaux a encore été soutenue par la création de la QPC avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le Conseil d’État s’est pleinement investi dans ce dispositif et il renvoie chaque année au Conseil constitutionnel entre 40 et 60 questions, c’est-à- dire un quart de celles qu’il reçoit directement ou par le truchement des autres 2 juridictions administratives. Enfin, nous portons la plus grande attention à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’nomme. Tout ceci s’est développé dans le contexte de la montée en puissance du référé-liberté, qui date de la loi du 30 juin 2000. L’appartenance de la France à l’Union européenne pose régulièrement des questions de droit… Au cours de la dernière décennie, le Conseil d’État n’a pas renouvelé la révolution copernicienne qu’il avait entreprise en 1989 avec les arrêts Alitalia et Nicolo sur les rapports entre le droit interne et le droit européen et international, mais il a complètement pris en compte les obligations qui résultent de l’appartenance de la France à l’Union européenne. Il a rendu l’arrêt Arcelor de 2007 sur l’articulation de nos obligations européennes et de nos obligations constitutionnelles. Il existe sur ce sujet une grande parenté entre la démarche du Conseil d’État dans l’arrêt Arcelor et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Melki et Abdeli de juin 2010. À l’époque, se posait la question de savoir si la QPC était, parce que prioritaire, compatible avec le droit de l’Union européenne. Cette question est à présent derrière nous. Le dernier grand arrêt rendu en la matière, c’est l’arrêt Mme Perreux, d’octobre 2009, par lequel le Conseil d’État a abandonné la jurisprudence dite “Cohn-Bendit”. L’enjeu était le suivant : le Conseil d’État avait jugé en décembre 1978 qu’une directive européenne non transposée ne pouvait pas servir de base au contrôle d’un acte administratif individuel. Cette jurisprudence, qui a duré plus de trente ans, est devenue caduque. Le Conseil d’État est aussi très visible depuis quelques années sur les grands débats de société… Oui, le Conseil d’État a précisé, en application de la loi, le cadre juridique du règlement de questions sensibles, notamment dans le domaine de la fin de vie, de la laïcité, du numérique… Il fait régulièrement des études sur ces sujets. Dans notre effort d’adaptation aux évolutions du monde, le Conseil d’État s’attache à rester un repère dans des débats difficiles. Il continue d’être le gardien des principes fondamentaux de notre pacte social. Il a une claire vision de l’intérêt général et il assume sa mission en veillant, aussi, à la simplicité et la clarté de ses rédactions et à la pédagogie de sa communication. Je précise que tout ceci s’est fait sans aucun accroissement de ses compétences et de ses moyens et sans réforme de procédure substantielle. (…) 3 uploads/S4/ gohin-2055-equ-2-droit-administratif-1.pdf
Documents similaires
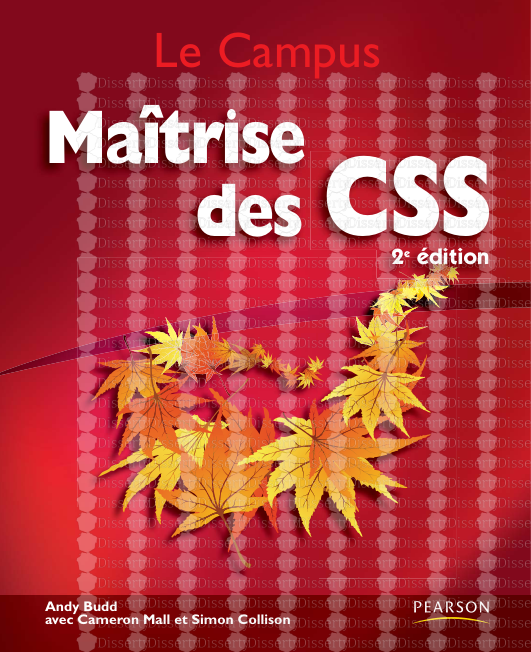





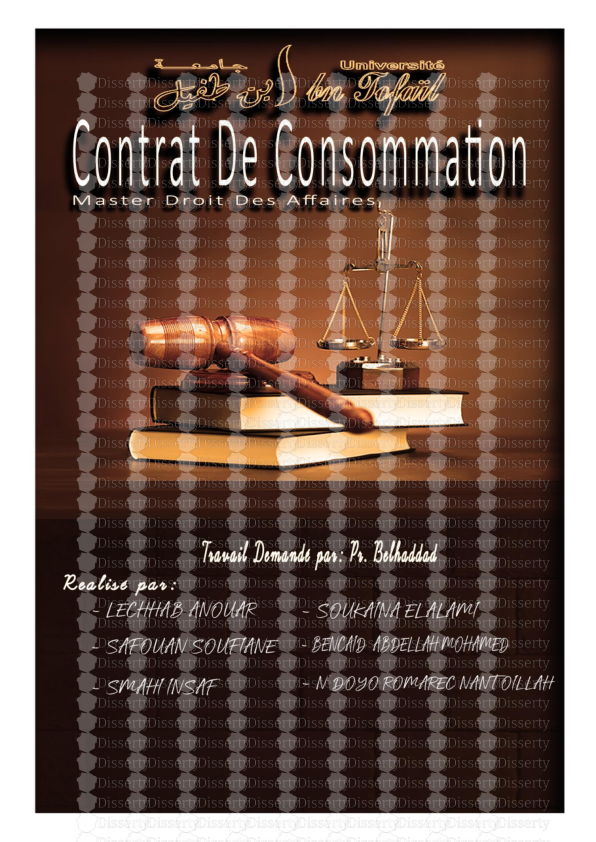



-
34
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0917MB


