1 L’état des lieux en traduction juridique – regard d’un praticien Christian De
1 L’état des lieux en traduction juridique – regard d’un praticien Christian Després* (article rédigé avec la collaboration de Karine McLaren) Le 6 novembre 2015 Les opinions formulées dans le présent article n’engagent que leur auteur et sont exprimées à titre personnel. Introduction La traduction juridique : une discipline à part entière En 1979, le professeur Jean-Claude Gémar écrivait, en avant-propos du numéro spécial sur la traduction juridique de la revue Meta : Depuis quelques années on assiste à un regain (ne serait-ce plutôt un gain?) de faveur du monde de la traduction pour une discipline [. . .]. Cette discipline, puisque discipline il y a, c’est la traduction juridique. (Gémar 1979 : 7) Ce regain de faveur ne s’est certes pas démenti au cours des trente dernières années. On peut à juste titre dire, selon moi, que la traduction juridique est devenue une discipline à part entière, tout comme la terminologie juridique et la jurilinguistique. On peut sans doute dire aussi que, durant cette période, le Canada est devenu un foyer d’expertise en ces matières. Cette expertise est d’ailleurs reconnue et recherchée dans le monde entier, comme en témoigne le nombre de spécialistes canadiens de ces disciplines qui ont au fil des ans travaillé à l’étranger, notamment pour des tribunaux internationaux, ou qui le font encore. Période de transition Bien qu’à l’instar de nombreux « rockeurs », bon nombre d’intervenants du milieu de la traduction juridique – traducteurs, terminologues, jurilinguistes et formateurs – continuent toujours de travailler, l’exode tant annoncé de ceux-ci vers la retraite est bel et bien amorcé. À titre d’exemple, pour ce qui concerne le Service de jurilinguistique de la Cour suprême du Canada, il suffit de signaler que de 2008 à 2013, pas moins de quatre jurilinguistes et un pigiste ont pris leur retraite. Ces personnes possédaient toutes de 25 à 30 années d’expérience en traduction juridique. Une période de transition est donc véritablement en cours. 2 Le point Il convient de regarder d’abord tout le chemin parcouru, afin de bien prendre conscience des acquis, puis de considérer quelles mesures pourraient permettre de préserver et de consolider ces acquis. À cette fin, il est important que tous ceux qui participent à la formulation du langage du droit, non seulement les traducteurs, les terminologues et les jurilinguistes, mais aussi les juristes (légistes, juges et praticiens), se concertent. Car en dépit des énormes progrès réalisés, il faut demeurer vigilant pour éviter, par exemple, que des conditions moins propices à l’exécution des travaux de traduction n’aient pour effet d’en réduire la qualité et l’utilité et, partant, la confiance qu’on leur accorde et le respect qu’on porte à ceux qui les exécutent. De plus, l’accroissement remarquable des connaissances et de l’expertise dans les domaines de la traduction juridique, de la jurilinguistique et de la légistique tend à se réaliser dans un isolement relatif. En effet, malgré l’existence de moyens de télécommunication et d’outils de travail toujours plus perfectionnés et performants, il faut reconnaître que le rythme généralement effréné du monde du travail et de la vie moderne laisse bien souvent peu de temps pour l’apprentissage et les échanges. Réflexion et action Le texte qui suit se veut donc une invitation à réfléchir à l’état des lieux, et à agir, et ce, dès à présent – dans la mesure de nos moyens et à l’intérieur de notre « sphère » d’influence respective, aussi restreinte soit elle. En d’autres mots, une invitation à « penser globalement tout en agissant localement ». Il faudra en effet compter sur les efforts de tous les gens du milieu (théoriciens et praticiens), appuyés par les autres personnes concernées (employeurs, donneurs d’ouvrage, politiciens et autres décideurs). Cela suppose naturellement que tous les intéressés, particulièrement ceux appartenant au second groupe, possèdent suffisamment d’information pour bien connaître le domaine et les enjeux et, ainsi, être à même de voir quel est leur intérêt à apporter leur contribution. C’est précisément à cette fin que je donne un certain nombre de renseignements avec lesquels beaucoup de lecteurs sont sans doute déjà familiers. Je sollicite donc à l’avance l’indulgence de ces lecteurs. Pour lancer ou poursuivre cette réflexion, je vous propose une série d’observations, évidemment bien personnelles, en tant que praticien de longue date qui a amorcé sa carrière à une époque où les conditions d’exercice de la profession, notamment au début, étaient assez différentes, et qui a par la suite eu la chance de pratiquer sa discipline à divers titres et de l’observer sous divers angles – étudiant et formateur, traducteur « généraliste » et traducteur 3 « spécialisé », révisé et réviseur, employé et gestionnaire, fournisseur de services et donneur d’ouvrage, traducteur et juriste. Considérations générales La traduction – nécessité, réalité et source de fierté Dans un vaste pays bilingue comme le Canada, la traduction est une nécessité et une réalité incontournable. En effet, au Canada, non seulement les lois fédérales mais également celles des provinces et territoires suivants – Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan (en partie), Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut – sont adoptées et publiées dans les deux langues. De plus, même dans les administrations où l’on pratique la corédaction des textes de loi, on fait appel soit à des jurilinguistes pour appuyer les rédacteurs, soit à des traducteurs pour la préparation des règlements, soit aux deux. En outre, aux termes du paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, « [c]hacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement »1. Pour ces raisons, les traducteurs juridiques, particulièrement ceux travaillant dans les domaines législatif et judiciaire – ainsi que leurs collègues jurilinguistes et terminologues juridiques évidemment – jouent un rôle crucial dans la formulation, la diffusion et la compréhension des règles de droit. Bref, leur intervention est essentielle pour permettre aux citoyens de connaître leurs droits et leurs obligations, de se conformer à la loi et de pouvoir faire valoir leurs droits, notamment devant les tribunaux, « en ayant les mots pour le dire » dans la langue de leur choix. Parlant de la common law en français, le professeur Donald Poirier a affirmé que celle- ci « n’aurait pas pu exister sans la traduction » (Poirier 2005 : 563). La traduction a été l’instrument ayant permis (notamment au Nouveau-Brunswick) la création d’un vocabulaire, de textes législatifs et de décisions judiciaires transcrivant la common law en français. Grâce à l’abondance et à la qualité des travaux de terminologie, de traduction, de jurilinguistique et de légistique réalisés au cours des trente dernières années – autant dans le domaine de la common law en français que du droit civil québécois en anglais –, les traducteurs juridiques et les jurilinguistes aident quotidiennement les citoyens et les justiciables à connaître et à exercer leurs droits dans la langue officielle de leur choix partout au Canada. Les divers 1 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11. 4 intervenants du milieu de la traduction juridique et de la jurilinguistique ont tout lieu d’être fiers de cette contribution essentielle, qu’il importe de faire connaître. La traduction juridique – responsabilité considérable Cette possibilité de contribuer à la formulation de la règle de droit et à la diffusion de l’information juridique s’accompagne toutefois d’une responsabilité considérable, qui oblige tous les intervenants à tenir compte d’un impératif d’accessibilité qu’a bien su résumer le professeur Gémar : [L]e propre de la manifestation juridique, du moins lorsqu’elle prend la forme de la langue juridique, est d’être accessible à tout un chacun puisqu’elle est censée s’imposer à tous. (Gémar 1979 : 7) La prise en compte de cet impératif d’accessibilité – au sens de compréhension – de l’information juridique revêt selon moi une importance accrue aujourd’hui, et ce, pour au moins quatre raisons qui seront examinées dans le cours du texte : le volume grandissant de l’information juridique de toute sorte, l’accès toujours plus grand et plus rapide des citoyens à cette information, la situation économique en général et les contraintes budgétaires des administrations publiques en particulier, et, enfin, le nombre sans cesse croissant de justiciables qui se représentent eux-mêmes devant les tribunaux. Le dernier point mentionné fait bien ressortir l’importance de toujours garder le citoyen et le justiciable au cœur de nos préoccupations quand nous participons, à quelque titre que ce soit, à la formulation de la règle de droit et, plus généralement, à la diffusion de l’information juridique. D’ailleurs, durant sa comparution devant le comité chargé d’examiner sa candidature au poste de juge à la Cour suprême du Canada, le juge Richard Wagner a répondu ce qui suit, à une question qui lui avait été posée en anglais à ce sujet : When we’re talking about access to justice, one of the first criteria is to make sure that the judgments, the reasons, are not only well delivered, but that they’re clear enough to be understood by everybody.2 Exercice uploads/S4/ etat-des-lieux-christian-despres.pdf
Documents similaires

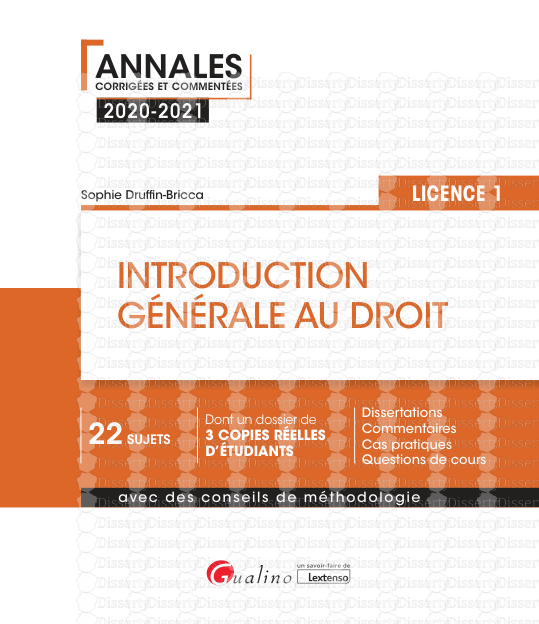





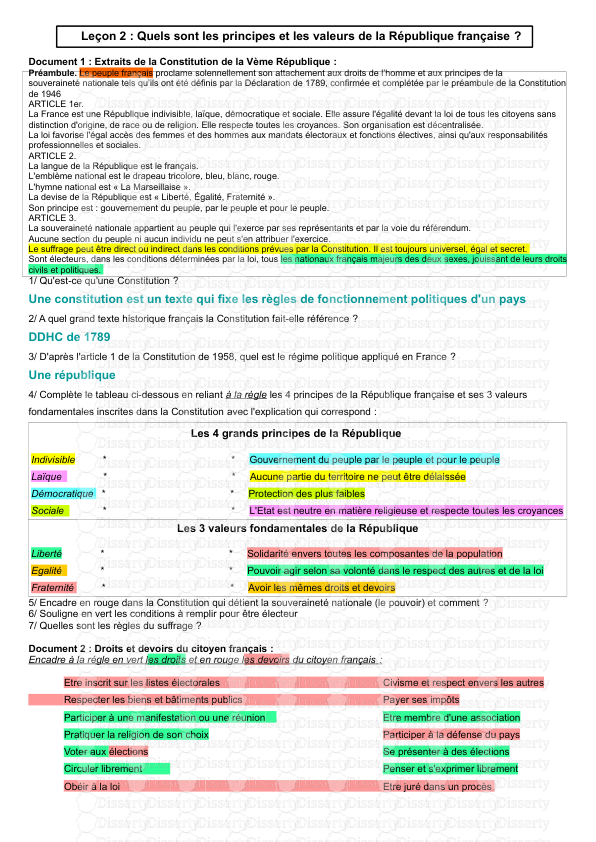


-
105
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.5329MB


