Novikov, Ilya V. Prof. Robert Kolb BARI 2009/2010 DROIT INTERNATIONAL PUBLIC PR
Novikov, Ilya V. Prof. Robert Kolb BARI 2009/2010 DROIT INTERNATIONAL PUBLIC PREMIERE PARTIE : ASPECTS INTRODUCTIFS Chapitre I - La définition du droit international public : • Contrairement au droit pénal, ou au droit de la famille, qui ont pour objet des notions familières pour tous, le concept de droit international public échappe à la plupart des personnes. Les composantes du terme sont pourtant révélatrices - droit inter nation al désigne effectivement le droit qui régit les relations entre les nations, et le terme public indique que les sujets de ce système juridique sont les Etats. - Définition : sujet de droit : toute personne (physique ou morale) ou entité qui a l’aptitude d’être titulaire de droits ou d’obligations juridiques. • Définition : droit international : « […] droit applicable à la société internationale. Cette formule […] implique l’existence d’une société internationale distincte de la société nationale ou société interne, ou encore étatique. Elle délimite, en même temps, les champs d’application respectifs du droit international et du droit interne. Elle confirme enfon le lien sociologique, donc nécessaire, entre droit et société. Toute société a besoin de droit et tout droit est un produit social. Ubi societas, ibi jus [là où il y a société, il y a aussi droit] est un adage qui est vérifié dans le temps et dans l’espace. » (DAILLIER, FORTEAU, PELLET, « Droit International Public », 8ème éd., Paris, 2009, p.43) - « La dénomination « droit international » est aujourd’hui celle qui est le plus couramment employée pour désigner le droit de la société internationale. [Cette expression] revient [au philosophe britannique Jeremy Bentham, qui a ressuscité la formule latine « ius inter gentes » (droit entre les gens) pour désigner le « droit entre les nations »]. « Droit international » doit être alors considéré comme synonyme de droit réglant les relations entre Etats, ou droit interétatique. » (Idem, pp. 43-44) - « [En] rapport avec la transformation de la société internationale, il doit être également compris comme un droit qui n’est plus exclusivement interétatique, même s’il le reste principalement en raison du rôle premier des Etats dans la vie internationale et de l’influence déterminante qu’exerce la notion de souveraineté [caractéristique essentielle de l’Etat]. » (Idem, p. 44) - « [Le droit de la société internationale] est également présenté parfois comme le droit de la « communauté internationale » ; [ceci a été remis en question car on] a objecté que l’extrême hétérogénéité des Etats dispersés de par le monde est incompatible avec l’existence d’une communauté internationale considérée comme communauté universelle. Les différences de langue, de culture, de religion, de civilisation séparent au lieu d’assembler les peuples. » (Idem, pp. 44-45) - 1 - a). Différentes conceptions du droit international : • Il existe deux écoles de pensées définissant le droit international et la société internationale actuelle, l’une dominante, l’autre minoritaire : i). Conception dominante : • Selon la conception dominante, le droit international public (ci après, DIP) est l’ordre international qui régit essentiellement les relations des Etats entre eux, ainsi que vis-à-vis d’autres sujets de droit. Les organisations internationales (ci après, OI) possèdent également des droits et des obligations au niveau international. • Certaines organisations non-gouvernementales (ci après, ONG), telles que la CICR, sont des associations ayant un statut international qui leur est reconnu par le droit coutumier et diverses conventions. Les deux peuvent conclure des traités avec d’autres sujets du DIP, ils possèdent donc une personnalité juridique internationale, ce qui permet l’extension du DIP aux rapports entre les OI et ONG. • Puisque le droit international est un droit entre Etats, le DIP est donc essentiellement un droit politique et c’est pour cette raison que l’on appelle public. Le DIP est dénommé ius inter potestates, ou droit entre les puissances. ii). Conception minoritaire : • Selon cette conception très anciennes, dont les origines remontent au droit romain, le DIP régit toutes les relations qui transcendent les frontières nationales. L’Eglise, les entreprises multinationales, les personnes (physiques ou morales) s’engageant dans une activité qui transcende une frontière entreraient dans le domaine du DIP. • Cette conception beaucoup plus large du DIP, prônant l’agglomération du règlement de tout rapport entre individus et entités dans un même ordre juridique mondial, provient du ius gentium romain et suscite aujourd’hui un intérêt nouveau, du fait du recul de la sphère publique par l’avancée de la privatisation qui atteint toutes les sphères, y compris le domaine des relations internationales. b). Distinctions structurelles entre le droit international public et le droit interne : • Outre des différences évidentes, telles que la différence des sujets de droit, de leur droits, de leurs obligations et de leurs compétences, il y a une différence structurelle fondamentale qui échappe souvent les esprits : il s’agit de la verticalité du droit interne, qui s’oppose à l’horizontalité du droit international public : i). Verticalité : • L’ordre juridique interne est basé sur la subordination des sujets de droit à la collectivité organisée. Le droit Suisse, une fois adopté, s’impose aux sujets de droits, à chaque membre du corps social, il est en ce sens vertical et pourvu de sanctions centralisées, et implique la soumission des citoyens à l’Etat. - 2 - ii). Horizontalité : • Le droit international public n’est non pas subordinatif, mais coordinatif. Il est exécuté entre des Etats souverains se rencontrent sur un pied d’égalité. Alors que les citoyens sont soumis à l’Etat. Les Etats n’acceptant pas de supérieurs, des règles de droit ne peuvent être établies que dans le cadre d’accords entre les premiers. Il est infiniment plus difficile d’imposer une règle à un Etat à cause de sa souveraineté. – d’où le caractère coordinatif de l’ordre juridique international. • Il existe donc des différences structurelles énormes entre le [DIP] et le droit interne. Dans le cadre de la législation au niveau interne, le jour où une nouvelle loi entre en vigueur, elle est valable pour tous. Au niveau international, les règles ne sont non pas imposées (sauf exceptions rares), mais proposées et négociées. Lorsqu’un Etat donne son accord à être lié par une nouvelle règle de droit international, il décide de la date de son entrée en vigueur, et peut produire des réserves à cette nouvelle règle. • La souveraineté rend tout procédé juridique infiniment plus compliqué dans le DIP, et donc pour juger de la qualité ou de la bonté (le fait que l’ordre juridique remplisse ses fonctions) de l'ordre juridique international, il le faire à partir faut partir de ce concept de souveraineté, qu’est la base fondamentale de l’ordre juridique international moderne. - « La distinction entre [DIP] et droit international privé [...] repose sur une différence d’objet. Alors que le [DIP] règle les rapports entre Etats, le droit international privé règle les rapports entre personnes privées, physiques ou morales. Au cœur du droit international privé, les mécanismes de « conflits de loi » s’efforcent de permettre la détermination du droit applicable lorsque le recours à deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux peut être envisagé pour régler un problème donné. » (DFP, « Droit International Public », p. 45) - « Selon la Cour Permanente de Justice internationale, « les règles de droit international privé font partie du droit interne », exception faite de l’hypothèse où elles seraient « établies par des conventions internationales [etc.] » » (Ibid.) - « [En ce qui concerne le droit transnational], le [DIP] et le droit international privé [y] trouveraient leur place, [toutefois, il s’étendrait] au-delà et couvrirait également le droit interne à portée internationale et les relations juridiques directement nouées par les personnes privées entre elles. [Le droit transnational englobe en réalité plusieurs ordres juridiques distincts, dont le degré d’autonomie réelle par rapport à ceux des Etats est variable]. » (Idem, p. 46) - « Pas plus que la société internationale, le droit international n’est homogène. Il est fait de la juxtaposition de règles générales et de règles particulières, dont la combinaison est parfois malaisée. » (Idem, p. 49) - « [Le] droit international général est celui qui est applicable à la communauté internationale universelle. Pour de nombreux juristes, la notion de communauté internationale sous-entend la communauté juridique fondée sur le fait que tous les Etats sont soumis à un même droit. Cette conception « universelle » du droit international est pleinement confirmée par le droit positif. Ce même droit international positif reconnaît l’existence de règles particulières, propres à certains Etats ou à certains groupes d’Etats. » (Idem, pp. 49-50) - 3 - Chapitre II - L’évolution du droit international public : • L’évolution du droit international public peut être expliqué à travers 4 axes principaux : - Durant le XIXème siècle, le droit international est fondamentalement un droit européen : le ius publicum europeum, issu des moult péripéties de l’effondrement de l’Empire Romain. Ce droit des puissances européennes dominant le monde divise l’humanité en trois groupes inégaux – les nations civilisés (comprenant les Européens et leurs colons), les nations barbares (« Orientaux ») et les nations sauvages (toutes les autres). Si au uploads/S4/ droit-international-public 6 .pdf
Documents similaires

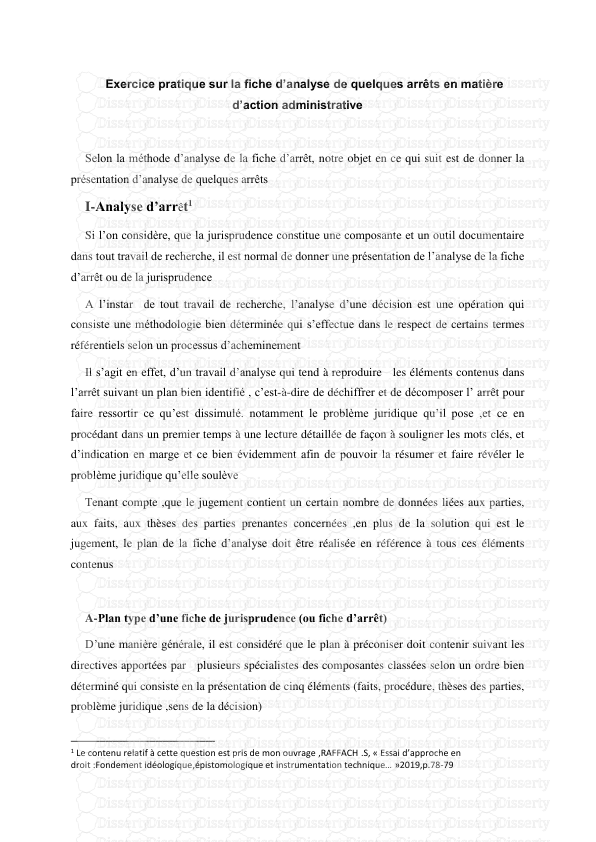



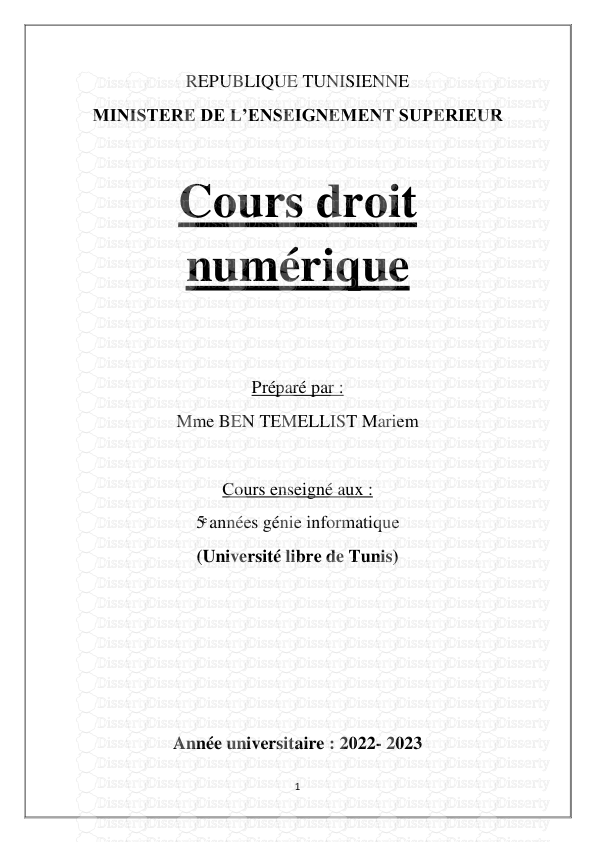




-
74
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 19, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.6408MB


