Introduction : Essai de définition du Droit Constitutionnel : Une distinction e
Introduction : Essai de définition du Droit Constitutionnel : Une distinction entre droit public et droit privé s'est faite au fur et à mesure à la suite de l'Ancien Régime. Mais à l'intérieur du droit public on ne faisait pas encore la distinction que l'on fait maintenant entre le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques et le droit international public (qui était le droit des nations). Le Droit Constitutionnel est une branche du Droit, mais sa spécificité est qu'il est le Droit de l'État. Au Droit Constitutionnel on peut donner une définition matérielle, et une définition formelle. Il peut être considérer comme une science du Droit. Il y a lieu alors de faire d'autres types de distinctions : entre le Droit positif et le Droit naturel et entre le Droit Constitutionnel et la Science politique. Section 1 : Le Droit Constitutionnel en tant que branche du Droit. §1. La définition matérielle. La Constitution, alors envisagée comme un ensemble de normes qui sont caractérisées par leur objet, lequel a toujours une relation étroite avec l'État. C'est un Droit qui concerne l'Etat. Au XVIIIème siècle on a vu apparaître, avec la philosophie des Lumières, le constitutionnalisme qui concevait la liberté et le pouvoir comme étant antinomiques. Pour assurer la liberté, il fallait organiser le pouvoir, lui donner des règles de fonctionnement qui en précisent les limites. Mais ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est le pouvoir de l'Etat; la Constitution a donc un lien d'identité complète avec l'organisation de l'Etat. C'est à partir de la Renaissance que la notion moderne de l'Etat appelle le concept de constitutionnalisme. Le Droit Constitutionnel définit les règles relatives à l'organisation de l'Etat moderne (au sens du XVIIIème siècle), c'est-à-dire les règles relatives à la désignation des autorités qui exercent les pouvoirs, la limite de leurs pouvoirs respectifs, et les rapports entre ces autorités de l'Etat. En Droit International Public, suivi sur ce point par le Droit Constitutionnel, on considère que pour qu'il y ait un Etat il faut que soient réunies trois conditions : un territoire, une population et une puissance publique. - Pour qu'il y ait un Etat il faut qu'il y ait un territoire à l'intérieur duquel s'exerce exclusivement la puissance publique. La fonction politique du territoire est indispensable puisqu'elle a fonction d'unité du groupe social sur lequel s'exerce le pouvoir. C'est le territoire qui définit l'étendue même du pouvoir effectif. Le territoire est aussi un cadre de compétence où les personnes qui vivent sont subordonnées à une réglementation des autorités qui sont à la tête du pays. Politiquement, le territoire est aussi un moyen d'action de l'Etat, c'est sur le territoire que s'exerce les politiques étatiques. Une puissance publique ne se définit pas seulement par ses missions régaliennes, il faut que le pouvoir face quelque chose pour se substituer éventuellement à la carence des initiatives privées. - L'existence d'une population, c'est-à-dire un ensemble limité d'Hommes soumis à un même ordre juridique et qui n'ont comme caractéristique commune que d'être soumis à cet ordre juridique. Lorsque le peuple, structuré par un Etat, a le souci d'homogénéité il devient une Nation; il arrive que ce soit l'Etat qui ait créé la Nation, cela a été le cas en France sous l'Ancien Régime; il arrive que ce soit le contraire et qu'une Nation, qui a subit l'autorité d'un État auquel elle était étrangère, fonde un État en prenant son indépendance. -L'existence d'une puissance publique, c'est-à-dire des autorités qui sont constituées pour exercer le pouvoir sur la population dans les limites territoriales de l'État. Mais elle peut être inférieure à d'autres pouvoirs au sein du pays. Ces trois éléments correspondent à des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes naturels ni même sociaux. En effet, il peut y avoir des États au sens juridique du terme auxquels ne correspondent pas ni une population homogène, ni un territoire homogène. Ces trois éléments ne peuvent être donc envisagés que d'un strict point de vue juridique, la définition que nous donnons ici est une définition purement juridique qui peut ne pas correspondre à des phénomènes sociaux. On peut envisager le Droit Constitutionnel, toujours dans une définition matérielle, comme un système d'organes. Art. 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789: il faut avoir une séparation des pouvoirs et une garantie des libertés pour avoir une Constitution. Cet article veut dire que dans un État il y a une pluralité d'autorités (ce qui n'exclut pas la présence d'une autorité suprême, mais elle ne peut pas tout faire), il y a nécessité d'une répartition des compétences au sein de l'État. Cette répartition entre les autorités résulte d'une Constitution. §2. La définition formelle. La Constitution formelle, ce sont les normes qui sont supérieures aux autres dans un système pyramidal de hiérarchie des normes, et qui servent de fondement à la validité des normes plus basses. Mais de plus en plus dans certains pays, cette Constitution formelle fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Elle est appliquée, elle est interprétée par des juges qui apprécient si les normes inférieures restent bien conformes aux normes supérieures. C'est ce qu'on appelle un juge constitutionnel. Il résulte de l'existence de ce juge constitutionnel, une jurisprudence constitutionnelle qui est une partie du Droit Constitutionnel. Le Droit Constitutionnel se définit donc là par sa forme : les normes supérieures dans la hiérarchie du système des normes. Les deux définitions ne coïncident pas totalement. Une norme dans la Constitution est constitutionnellement valable, mais son objet peut ne pas l'être (Constitution suisse de 1874 : elle interdit l'abattage du bétail rituel dans le rite juif, il n'y a là aucun rapport avec le Droit Constitutionnel d'un point de vue matériel). En revanche il y a des objets matériellement constitutionnels qui ne sont pas considérés dans la Constitution. En France la Constitution ne donne pas les bases électorales (mode de scrutin). Dans la plupart des Etats, la préférence est donnée à la définition formelle de la Constitution car il s'agit de protéger les libertés formellement définies dans le texte de la Constitution. Il y a eu un déplacement de l'objet principal du Droit Constitutionnel dans le cours du XXème siècle alors qu'au début du XXème siècle l'objet principal du Droit Constitutionnel c'était l'organisation des pouvoirs; on est passé à un objet latéral qui a pris de plus en plus d'ampleur vers la fin du XXème siècle, c'est la protection constitutionnelle des droits et des libertés. Le pays qui a contribué le plus au Constitutionnalisme (la Grande Bretagne) n'a pas de Constitution. Et quand on veut changer une institution en Grande Bretagne, il suffit de rédiger une loi ordinaire. Cette exception nous donne à réfléchir : y a-t-il un pays où les libertés soient mieux respectées? Section 2 : La définition du Droit en tant que science du Droit. Sur la nature et les méthodes de cette science de la Constitution, il existe des conceptions différentes : elles reflètent d'ailleurs les oppositions que l'on trouve à propos de la science des autres branches du Droit, notamment du Droit Civil, la plus classique étant l'opposition que l'on fait entre le positivisme et le jus naturalisme et la plus spécifique au Droit Constitutionnel étant l'opposition que l'on fait entre la dogmatique juridique et la sociologie (c'est-à-dire l'opposition entre le Droit Constitutionnel au sens strict et Science politique). §1. L'opposition entre le Droit Positif et le Droit Naturel Il existe des théories qui considèrent qu'il n'existe pas un seul Droit, mais qu'il y en aurait deux : le Droit Constitutionnel matériel qui est le Droit Positif car il a été posé par la volonté de certaines autorités; et un autre immanent à la nature des choses d'où son nom de Droit Naturel, lequel existerait avant le Droit Positif et lui serait supérieur, il lui servirait de fondement. Le Droit Naturel aurait pour fonction de déterminer quelles sont les autorités politiques qui sont légitimes et à quelles conditions le Droit que cette autorité politique produit est lui- même valide. Une autorité légitime peut abuser de ses pouvoirs et produire des normes qui ne seraient pas conformes au Droit Naturel et qui donc seraient privées de validité, et le principe d'obéissance qui s'impose aux normes supérieures ne serait donc pas imposable à ces normes. Contenu du Droit Naturel : les autorités d'un Etat doivent produire un Droit Positif qui réalise la Justice. Qu'est-ce que la Justice ? Les différences d'accord sur la notion de Justice tiennent à la source du Droit Naturel. Pour les écoles du Moyen Age, le Droit Naturel trouvait son origine dans volonté de Dieu. Pour les écoles des philosophes du XVIIIème, le Droit Naturel trouve son fondement dans la nature des choses (c'est un Droit Naturel laïcisé). A ces deux conceptions correspondent des notions divergentes du principe de Justice : ou bien la justice humaine est là pour réaliser, autant qu'elle peut, la justice divine, ou bien cette justice humaine est contenue dans un certain nombre de grands principes immanents qui n'ont pas à figurer dans la Loi uploads/S4/ droit-constit-1er-semestre.pdf
Documents similaires







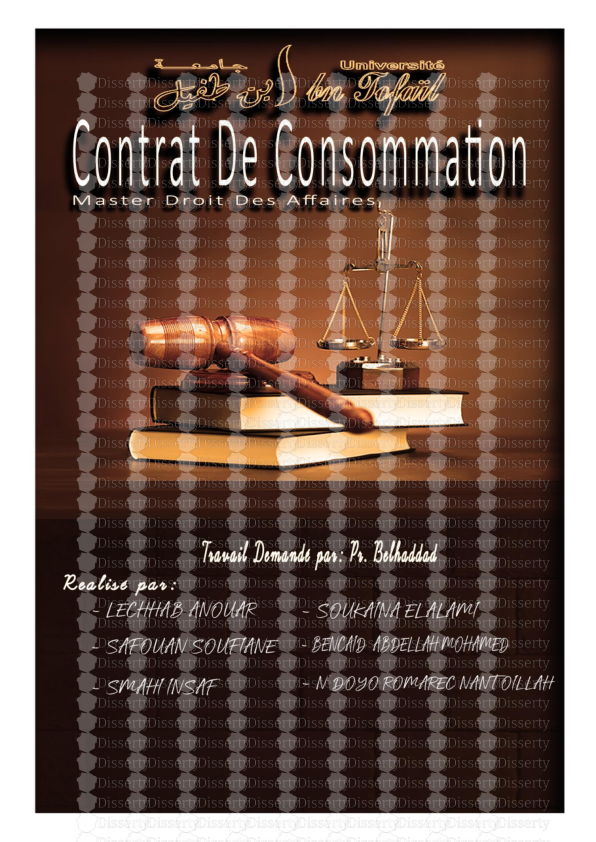


-
170
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 14, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.3524MB


