L. MASSIGNON DOCUMENTS SUR CERTAINS W AQFS . DES LIEUX SAINTS DE L'ISLAM princi
L. MASSIGNON DOCUMENTS SUR CERTAINS W AQFS . DES LIEUX SAINTS DE L'ISLAM principalement sur le waqf Tamimi à Hébron et sur le waqf tlemcénien Abû Madyan à Jérusalem Extrait de la Revue des Éludes islamiques ANNÉE 1951 PA~RI~S LIBRAIRIE ORIENTALISTE PAUL GEIJTHNER 12, RUE VAVIN, VIe - 1952 1IIIIiilID~I~~lili~rnlllll 134482 DOCUMENTS SUR CERTAINS W AQFS DES LIEUX SAINTS DE L'ISLAM principalement sur le waqf Tamimi à Hébron et sur le waqf tlemcénien Abû Madyan à Jérusalem réunis et annotés par L. MASSIGNON INTRODUCTION (1) Les waqls des Lieux saints de l'Islam, de ses IV {( Haram », sont les plus significatifs, ceux qui permettent le mieux de saisir leur rôle essentiel: per- pétuer la communauté dans le temps et l'espace, puisqu'ils permettent l'extension maxima de la Hijra, de l'hégire des expatriés volontaires, des per- sonnes déplacées de la croyance, allant là où peut se renouveler la science de leur foi commune : {( fî sabîl Allah ». Avant l'Islam, l'Arabie avait connu ces déplacemnts, mus par la recherche de l'encens dans son pays natal, le Shihr al-Lubân sud-arabique, pour les temples de toute l'antiquité; - et voici que la recherche du pétrole y centra- lise de nouveau des {( personnes déplacées» du travail des mines, à Abadân ct à Dhahrân, ce qui met en péril certain les Lieux saints de l'Islam. Néanmoins, je ne pense pas que ceci doive tuer cela; je pens~ même que le droit des gens européen gagnerait à récupérer tel ou tel élément du vieux droit sémitique d'Arabie, tel que le droit d'asile (<< Right of Sanctuary », (1) On l?-'a pas normalisé les transcriptions en arabe des sources diverses. 6 • REVUE DES ÉTUDES ISLAMIQUES dit-on excellemment en ahglais), qui est précisément à la base des waqfs des Lieux saints de l'Islam (1). « La notion juridique de waqf est la plus importante d'entre les notions juridiques en droit musulman, car elle est entremêlée, interwoven, avec toute la vie religieuse et l'économie sociale. » Cette maxime d'Ameer Ali est rappelée par A. A. Fyzee en: tête de son chapitre sur le waqf (2). Etymologiquement, le waqf (en maghreb, le habîs; pl. hubûs, vulgo habous) est une partie de la sadaqa ou « aumône charitable» (en vue de Dieu; le don profane, c'est la hiba) ; on pratique, on réserve à sadaqa le sens d'une aumône dont la substance est consommée; tandis que le waqf est une aumône charitable permanente, qui dérive d'un bien-fonds donné à Dieu : ainsi récupéré par Lui. On a commencé de publier des chartes de waqf : soit d'après des inscrip- tions (une des plus anciennes est celle du Mashhad Lut près d'Hébron datable d'entre 356 et 400 de l'hégire, comme " nous verrons plus loin), soit d'après des pièces d'archives (par ex. le k. waqf al-qâdî Ibn al-Munajjâ, publié à Damas en 1949 par S. Munajjed). J'ai publié jadis la grande " charte de la mosquée Mirjân de Bagdad, datée de 758/1356, où se trouve cité le fameux hadîth : « Quand l'homme meurt, son œuvre s'interrompt, et ne lui survit qu'en trois choses: l'aumône perpé- tuelle (sadaqa jâriya), la science qui profite aux autres, et un fils pieux qui prie pour lui» [Muslim, sahih : selon Abü Hurayra] ; or, ajoute l'inscrip- tion, « l'aumône perpétuelle, c'est le waqf » (3). Puisque « les actions dépendent de leurs intentions » (N° 1 des hadîth de Bukhari), le waqf existe dans la mesure où l'intention (nîya) du fondateur est maintenue, intacte, en vue de Dieu (cf. Qur. LI, l, 3 : pour « qurba » et « jâriyât »; IX, 60, 100; XXX, 38 (inverse de l'usure), LVII, 17 (prêter à Dieu), jusqu'au jour du Jugement (Qur. II, 255 ; XIV, 36). (1) Ce qui a été très insuffisamment défini dans la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que l'a observé la XLe conférence interpl1rlementaire à Istanbul (31 août-6 sept. 1951). (2) Mr. Asaf A. Fyzee a donné un résumé excellent du régime des waqfs musulmans dans l'Inde d'août 1947, ap. Outlines of Muhammadan Law, Oxford, 1949, p. 230-281. Ce résumé est ainsi divisé: introduction (waqf d'Omar à Khaybar, etc.) ; - définition, but, bénéficiaires; le waqf familial ('alâ' lawlâd) ; loi nO VI du 7 mars 1913, avec effet rétroactif depuis la loi nO XXXII du 23 juillet 1930, com- plétée par la loi nO XLII de 1923 ; - mosquées, takia, khânqâh (dirigé par un sajjadé-nashîn), dargâh, imambara; - rôle des kazis (= cadis) ; procès du Masjid Shahld Ganj à Lahore; constitution ~t cons- truction d'un wakf. (3) Cf. ma Mission en M ésopotamie, 1912, t. 2, p. 1-31; cf. corrections de Must. Jawad, ap. Lughat al-'arab, VII, 615, 690-692 et pour N edjmi (Mission, 1910, t. I, p. 54-55) dans; son édition de Fuwatî, tarikh, 442 ; et Sal'l'c-Herzfeld, Arch. R eise, t. 2, 190-192. DOCUMENTS SUR CERTAINS WAQFS DES LIEUX SAINTS DE L'ISLAM 75 D'où il s'ensuit que l'une des attributions les plus importantes de la classe bourgeoise des « notaires» (sic: originairement « Témoins instrumentaux »), des shuhûd, est de témoigner, en cas de contestation, pour le maintien de l'intention du fondateur d'un waqf. La constitution d'un waqf consacré à une fin déterminée, d'utilité commu- nautaire perpétuelle (tasbîl, tahrîm, tahbîs, qurba), est bien l'aumône par excellence; elle implique même en général les deux autres cas de survie: C'est généralement un lieu de prière qui est « waqfé » pour l'enseignement de tels et tels textes scientifiques déterminés dans ' la waqfiya (1), - et, de génération en génération, les prières qui y sont dites valent au fondateur et à sa famille les bénédictions divines (2). Les biens de mainmorte musulmans les plus caractéristiques sont les waqfs constitués pour les Lieux saints, pour leurs· pèlerins (hujjâj) comme pour leurs défenseurs (musabbilîn, muj âhidîn) : ils renforcent la structcre géographique dynamique de l'Islam, axée par le mouvement de « convection» du Hajj (et du Jihâd) sur ses Quatre Haram. Nous allons donc résumer ici rapidement deux exemples de constitution historique de waqfs pour l'Arabie (La Mekke et Médine), puis pour la Palestine (Hébron et Jérusalem). Puissions-nous attirer l'attention de nos lecteurs qui ont médité sur l'effon- drement du droit public international élaboré en Europe occidentale depuis le XVIIe siècle (Grotius, traités de Münster, d'Osnabrück, traité d'Oliva), et détruit par l'échec du pacte Kellogg (1929) sous la réaction du racisme colonialiste, afin qu'ils envisagent les ressources juridiques du vieux droit sémitique, pour une restauration de rapports internationaux moins implacables et plus humains: les fondant sur la notion du droit d'asile, de l'Amân, Dhimma, lkrâm al-Day! (3) : qui confère la sauvegarde de l'hos- pitalité à tout hôte désarmé, sans discrimination, sans tolérer à son encontre d'exception, absolument comme la Croix-rouge internationale soigne tous les blessés, amis et ennemis, sans discrimination; qui accorde à l'hôte étranger (sans l'obliger à abandonner sa nationalité) l'aumône de la science comme celle du pain (tandis que la morale raciste actuelle célèbre les services de ren- (1) Of. la thèse d'Ibrahim Salama, Bibliogr. an. et crit. enseignement en Egypte (XIUe-XIXe), 1938, 311 pp. (2) En principe, l'Islam considère que chaque génération est seule à « porter son fardeau» (lâ tazir. Qor. 6, 164). Mais il y a des intercessions posthumes pouvant servir au mort. (3) risâla d'Ibr. Harbî t 283/898. 76 REVUE DES ÉTUDES ISLAMIQUES seignements quand ils se font hospitaliser afin d'espionner et même de livrer les hôtes qui les hébergent au nom du droit d'asile). Le droit musulman a été, dès le début, pluraliste, alors quela chrétienté ne l'était pas encore, et non seulement il a protégé de sa dhimma «( protection tutélaire ») les minorités des « gens du livre» (juifs et chrétiens), mais les « capitulations» qu'il leur a accordées (dont la France, puis l'Autriche ont obtenu, du côté chrétien, la garantie en terre ottomane depuis 1532) autorisaient expressément ces mino- rités à avoir leurs propres waqls. Si bien qu'il y a de bons esprits, parmi les spécialistes des problèmes internationaux, qui se demandent si, pour sauvegarder la position sociale, économique et culturelle légitime des minorités européennes destinées à survivre à la liquidation du colonialisme ruciste, dont l'Irgoun sioniste paraît devoir être le dernier spécimen, - il n'y aurait pas lieu de baser certains traités d'établissement sur la conception musulmane du droit d'asile, en plaçant les waqls qui seraient créés pour ces Européens sous la « dhimma » des nouveaux Etats musulmans devenus indépendants, et conférant ainsi double nationalité. Aux Indes, une secte musulmane aberrante, mais très habilement dirigée, les Ahmadiya (1), a su s'attirer la sympathie britannique en préconisant une « gleichberechtigung » de ce genre; et son influence dans le jeune Etat du Pakistan travaillera peut-être dans ce sens. Ce qui serait un nouvel encou- ragement pour les juristes français qui ont mis à l'étude cette solution tant à Tunis qu'à Rabat. Cette extension de la notion musu]mane du waqf à des établissements étrangers en pays musulman pourrait être l'objet d'une seconde généra- lisation, uploads/S4/ documents-sur-certains-waqfs.pdf
Documents similaires

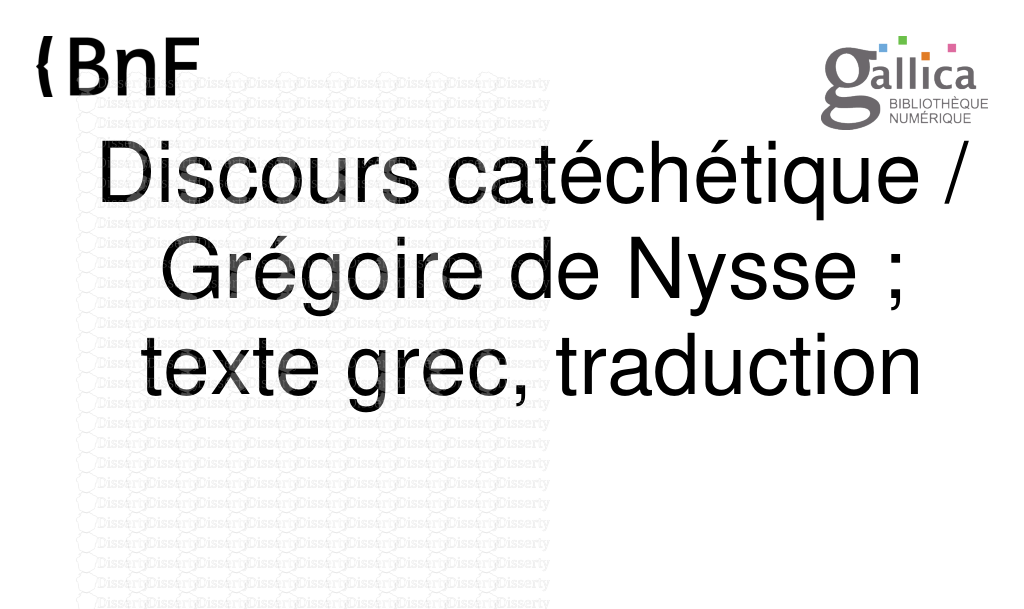








-
42
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 7.7553MB


