1 Droit communautaire1 et droit national dans l’espace OHADA Par Mayatta Ndiaye
1 Droit communautaire1 et droit national dans l’espace OHADA Par Mayatta Ndiaye MBAYE, Agrégé des facultés de droit, Maître de conférences à l’UCAD La grosse difficulté d’une organisation, c’est l’organisation parfaite ; l’organisation parfaite des moyens, l’organisation parfaite des pouvoirs. Cette difficulté se présente, comme dans toute communauté, dans l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) créée par le Traité relatif à l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port Louis (Ile Maurice) et entré en vigueur en 1995. Ce texte, devant les multiples difficultés rencontrées dans l’organisation des institutions qu’il prévoit, a été modifié et complété par le Traité portant révision du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 2008 à Québec (Canada). Ce dernier traité, dont le processus de ratification par les Etats Parties se poursuit pour son entrée en vigueur, a vu notamment la création d’une nouvelle institution dans l’OHADA, la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement, à côté des autres institutions qui existaient auparavant (le Conseil des Ministres, le Secrétariat Permanent, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) et l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA). Toutefois, ce traité révisé ne répond pas à toutes les interrogations que soulève l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. En effet, se pose essentiellement la question du rapport entre le droit communautaire issu de 1 La notion de droit communautaire ne doit pas ici être entendue au sens large. Elle se limite au droit communautaire de l’OHADA c’est-à-dire essentiellement les actes uniformes issus du traité de l’OHADA. 2 l’OHADA et le droit national des Etats parties, c’est-à-dire celle des rapports entre les actes uniformes issus de l’OHADA et les législations nationales des Etats parties. Cette question comporte deux aspects : - le premier aspect est lié à la supériorité des dispositions des actes uniformes sur les législations nationales des Etats parties et partant à la portée abrogatoire de l’article 10 du traité OHADA ; - le second aspect, quant à lui, est lié à l’application des dispositions des actes uniformes et des législations nationales, application qui se heurte au conflit de compétence entre la CCJA et les Cours suprêmes des Etats parties. Ces deux aspects de la question des rapports entre le droit communautaire et le droit national dans l’espace OHADA ne sont pas autonomes ; ils s’imbriquent, le premier ayant un effet sur le second. Ce sont ces deux aspects de la question des rapports entre droit communautaire et droit national dans l’espace OHADA qui nous intéressent aujourd’hui. Ces questions s’intéressent d’abord aux conflits de lois dans l’espace OHADA (premier aspect de la question) (I), ensuite aux conflits de juridictions dans l’espace OHADA (deuxième aspect de la question) (II). I- Les conflits de lois dans l’espace OHADA La notion de conflit de lois, dans le cadre de cette étude, ne porte que sur les conflits entre les règles communautaires et les règles nationales dans l’espace OHADA. Il n’est donc pas ici question d’appréhender les conflits de lois au sens classique du DIP dont le noyau dur est constitué par les conflits entre lois d’Etats souverains. 3 Ces conflits entre les règles communautaires et les règles nationales ont pour cause principale l’article 10 du traité de l’OHADA et l’interprétation qu’en a faite la CCJA. En effet, dans le cadre de l’OHADA, par souci d’interprétation et d’application uniformes des textes issus de l’organisation, notamment du traité, des actes uniformes et des règlements, l’article 14 du Traité de Port-Louis a-t-il confié la tâche de l’interprétation à la CCJA2. Cette dernière, par l’avis consultatif du 30 avril 2001 demandé par l’Etat de Côte d’Ivoire le 19 octobre 2000, se prononce sur le sens et l’effet abrogatoire de l’article 10 du traité OHADA et des articles 1er alinéa 1er et 2 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, 1er, 916 alinéa 1er et 919 alinéa 1er de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE, 257 de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif , 35 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage et 336 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution (A). Mais, il faut reconnaître que si cette interprétation avait pour but d’éclairer le sens des dispositions précitées, elle rend beaucoup plus flou le sens des règles établies et partant, beaucoup plus complexe l’impact de l’unification par l’OHADA des règles du droit des affaires sur le droit interne des Etats parties (B). A- La portée abrogatoire reconnue aux dispositions communautaires par l’interprétation faite par la CCJA Selon l’article 10 du traité de l’OHADA, « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Sur la question de savoir 2 En effet, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes. » 4 si cet article 10 abroge tout texte législatif ou réglementaire de droit ayant le même objet que les actes uniformes ou uniquement les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant le même objet que celle d’un acte uniforme et étant contraires à celles-ci, la CCJA a procédé par une interprétation large du texte pour apporter une réponse complexe à la question posée : En effet, elle considère d’abord qu’en principe, l’effet abrogatoire de l’article 10 concerne l’abrogation ou l’interdiction de l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet que celle de l’acte uniforme et contraires à celles-ci. Ensuite, elle précise que cette abrogation concerne aussi les dispositions de droit interne identiques à celles des actes uniformes. Cette dernière partie de la réponse signifierait alors qu’en règle générale, et sauf dispositions contraires expresses des actes uniformes, toutes les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire de droit interne ayant le même objet que celle de l’acte uniforme sont abrogées dans leur ensemble, qu’elles soient antérieures ou postérieures, contraires ou conformes aux textes résultant de l’acte uniforme. Concernant l’article 1er alinéa 1er et 2 de l’acte uniforme portant droit commercial général et l’article 1er de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciale et du GIE, la CCJA considère que lorsque toutes les dispositions d’une loi ou d’un règlement ayant le même objet qu’un acte uniforme sont contraires à ce dernier, la loi ou le règlement est abrogé dans son ensemble. En revanche, si seules quelques dispositions de cette loi ou règlement sont contraires à l’acte uniforme les dispositions non contraires à celles de ce dernier demeurent applicables. En outre si la subsistance des dispositions législatives ou réglementaires de droit interne spécifique auxquelles sont soumises les sociétés 5 bénéficiant d’un régime particulier ne pose aucune difficulté car résultant de l’application du principe « specialia generalibus derogant » ,l’acte uniforme sur les sociétés n’ayant rien prévu les concernant hormis les règles générales applicables à toutes les sociétés, les réponses sur les dispositions abrogatoires des articles 257 de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif et 35 de l’ acte uniforme sur le droit de l’arbitrage restent également insatisfaisantes . En effet, relativement à ce dernier article, après avoir admis que l’acte uniforme s’est substitué à toutes règles de droit interne relative à l’arbitrage, elle ajoute que cette substitution est sous réserve des dispositions non contraires susceptibles d’exister en droit interne. La CCJA enfreint donc la règle unanimement reconnue selon laquelle « il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas », l’article 35 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage ayant prévu qu’il tient lieu de loi relative à l’arbitrage dans tous les Etats parties. Par ailleurs, la CCJA affirme que les dispositions abrogatoires contenues dans les actes uniformes sont conformes à l’article 10 du traité OHADA. Or, après lecture des textes abrogatoires spécifiques des actes uniformes, le principe qui paraît le plus évident est la subsistance des textes de droit interne conformes aux dispositions issues de l’OHADA. Il faut relever que cette interprétation des textes de l’OHADA engendre quelques conséquences pratiques. 6 B- Les conséquences pratiques de l’interprétation faite par la CCJA Le maintien des dispositions de droit interne conformes aux actes uniformes pose la question de leur application. Devant une affaire appelant l’application des textes identiques mais de sources différentes dans un domaine (les uns issus de l’OHADA, exemple : les actes uniformes ; les autres faisant partie du droit interne de l’Etat partie), le juge compétent dans l’Etat partie sera amené à choisir entre le droit interne conforme à l’acte uniforme et l’acte uniforme lui-même. Dans ce cas, le juge enfreindra-t-il le principe de la supranationalité pour appliquer le droit interne en écartant le droit communautaire ou appliquera-t-il le droit communautaire en tenant compte de sa supranationalité ? La première option renie tout intérêt à l’unification du droit et la seconde montre que le uploads/S4/ communique-mayatta-ndiaye-mbaye-droit-communautaire-et-droit-ohada.pdf
Documents similaires
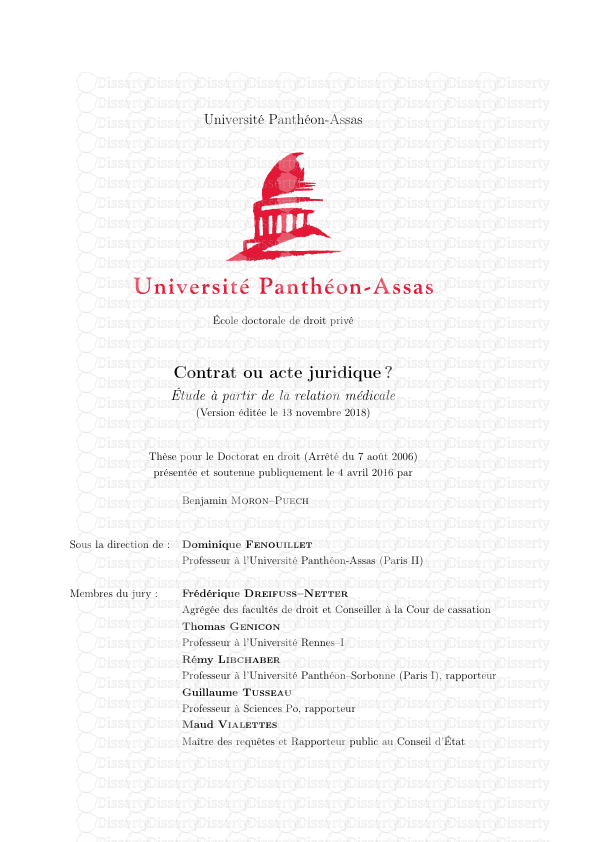









-
31
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0752MB


