CHAPITRE 2 Les conditions de la protection du droit d’auteur Article Premier :
CHAPITRE 2 Les conditions de la protection du droit d’auteur Article Premier : Le droit d'auteur couvre toute œuvre originale littéraire, scientifique ou artistique quels qu'en soient la valeur, la destination, le mode ou la forme d'expression, ainsi que sur le titre de l'œuvre. Il s'exerce aussi bien sur l'œuvre dans sa forme originale que sur la forme dérivée de l'original. Article 18.1 nouveau : La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quel que soit la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel. → De la lecture de ces deux articles, il ressort que la loi de 1994 / modifiée par la loi de 2009 n’a exigée aucune condition formelle ou procédure de dépôt de l’œuvre (condition négative) et s’est contenté de prévoir explicitement deux conditions de fond (conditions positives). Section 1 ; Les conditions positives : de fond « L’originalité constitue l’âme de l’œuvre, la forme étant son corps » Pour que l’œuvre soit protégeable la loi exige en réalité deux conditions : la première consiste dans le fait que l’œuvre prenne la forme d’une création c'est-à- dire qu’elle soit mise en forme (A) et qu’elle soit originale(B). L’œuvre protégée est une création intellectuelle concrétisée dans une forme qui de surcroît doit être originale. A : L’exigence d’une création Cette condition exigée par les termes de l’article 18 nouveau de la loi de 1994 selon lequel « La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quel que soit la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel » implique que l’œuvre soit mise en forme : peu importe qu’elle soit achevée ou non, il suffit qu’elle fasse l’objet d’une forme de réalisation et de matérialisation. L’article L 111-2 du CPI français a clairement stipulé cette condition en disposant que « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ». Des dispositions de ces textes, il ressort que pour être créateur, il faut intervenir dans l’univers des formes : celui qui se contente de fournir des idées ou des thèmes ne peut revendiquer la qualité d’auteur. . Les idées et le savoir faire en tant que tels ne sont pas inclus dans le domaine de la protection au titre du droit d’auteur. Cette exclusion est d’ailleurs expressément mentionnée dans l’article 1er de la loi de 1994 / modifiée en 2009 selon lequel « la protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tels, Le droit d’auteur ne protège donc pas les idées en elles même mais seulement la forme dans laquelle celles-ci sont exprimées. L’idée en tant que représentation d’une chose de l’esprit, une manière de voir, une conception de l’esprit peut être librement reprise par un tiers sans que celui qui l’avait formulée en premier puisse prétendre avoir sur elle un monopole. L’un des grands principes de la propriété littéraire et artistique étant que « les idées sont de libre parcours » la doctrine admet dans ce sens que l’idée brute non formalisée d’une façon spécifique est assimilée à un fonds commun inappropriable. Pour conclure, pour être légalement protégée, la création devra être un minimum matérialisée B : L’exigence d’une création originale La loi de 1994 a exigée cette condition dans l’article 1er sans pour autant définir l’originalité. En fait, c’est à la doctrine et à la jurisprudence que revient le mérite de la définition de cette notion et la délimitation de son domaine. La définition classique et unanime de l’originalité consiste dans « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Ce qui est original, c’est le résultat d’une création de l’esprit, portant « l’empreinte de la personnalité » de son auteur ou encore la création intellectuelle propres de son auteur / un style d’écriture, un coup de pinceau, des photographies avec une composition particulière… D’une manière générale, il convient de prendre en compte tout ce qui permet d’identifier un créateur et sa réflexion, sa pensée… Le degré d'originalité est indifférent. Une œuvre peu originale (telle une revue de presse) ou qui emprunterait des éléments à une œuvre première (telle la traduction d'un texte dramatique) est considérée comme une œuvre originale. La définition de l’originalité reste cependant abstraite, à partir du moment où la création artistique suppose un travail intellectuel, aboutissant à un résultat, l’empreinte personnelle devrait être aisément déduite. De même, il ne suffit point que l’œuvre soit nouvelle pour qu’elle soit considérée comme originale. → Ainsi, pour mieux cerner cette notion, il ya lieu de traiter la différence ente l’originalité et la nouveauté (1) avant d’étudier le caractère relatif et subjectif de la notion de l’originalité (2). 1. L’originalité diffère de la nouveauté. Ce qui met en évidence l’originalité d’une création c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En effet, « lorsque l’empreinte personnelle de l’auteur est décelée, l’originalité en découle ». C’est le reflet de la personnalité de l’auteur, sa marque personnelle qui va permettre de différencier sa création des autres. Ainsi définie, l’originalité doit être distinguée de la nouveauté. Une œuvre originale n’est pas forcément une œuvre nouvelle. L’exigence de la nouveauté est une condition spécifique propre à la propriété industrielle. La notion de « nouveauté » est une notion objective marquée par l’absence objective d’antériorité, alors que l’originalité est une notion subjective du fait que ce qui est pris en considération ce n’est pas la date de l’apparition de l’œuvre mais l’apport artistique, scientifique, culturel ou littéraire de l’auteur de l’œuvre. On considère qu’une œuvre est originale lorsqu’elle exprime le style de son auteur, sa façon personnelle de comprendre et de traiter le sujet choisi. L’originalité est appréciée de façon souveraine par les juges du fond. Elle est constatée au cas par cas et c’est à celui qui se prévaut d’un monopole qu’incombe la charge de la preuve de ce qui le fonde, l’auteur devra donc démontrer l’originalité de son œuvre. 2. L’originalité est une notion relative et subjective L’originalité est une notion subjective dont l’appréciation dépend du pouvoir souverain des juges du fond. Les idées étant de libre parcours tout le monde peut avoir l’idée de peindre le soleil, mais tout le monde n’étant pas Van Gogh, toutes les œuvres produites ne seront pas forcément protégeables en droit d’auteur. Seule l’œuvre qui porte l’empreinte personnelle de son auteur sera protégée. Pour mieux apprécier l’originalité, la doctrine s’est référée à son antonyme : la banalité qui consiste en la reprise, par un auteur prétendu, de matériaux artistiques connus de tous, déjà employés auparavant par d’autres et qui n’appartenant à personne. Ce que les spécialistes appellent- par un emprunt déformant au droit administratif - le domaine public. L’œuvre banale ne fera pas donc l’objet d’une protection par les droits d’auteur. En pratique ces questions d’originalité et de banalité se retrouvent lorsque l’auteur d’une première œuvre se plaint de ce qu’un deuxième auteur lui aurait emprunté. Afin d’apprécier s’il y a faute, il faut bien vérifier l’originalité conditionnant la protection de la loi. A propos d’une affaire jugée par le Tribunal de première instance de Tunis en 1975, la demanderesse se prévalait d’un contrat qu’elle a passé avec les héritiers du poète Abou Kacem chebbi, pour publier son recueil de poèmes « les chansons de la vie ». Elle prétendait être chargée de la vérification du texte initial des poèmes et de la recherche de leur date ce qui, selon elle, lui aurait conféré le droit d’auteur sur le recueil « les chansons de la vie ». Et à ce titre, elle demanda la destruction des exemplaires d’un livre initial intitulé « Abou- Kacem chebbi, sa vie, ses poèmes » qui reprend la majorité des poèmes contenus dans ‘’les chansons de la vie’’ et dont l’auteur est Mohamed Kerrou. Le juge a refusé la qualité d’auteur à la demanderesse, la recherche de la date des poèmes et des circonstances de leur création ne pouvant être assimilé à une création personnelle (originale) donnant lieu à l’octroi du droit d’auteur. Section 2: L’absence des conditions de forme La protection d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique par le droit d’auteur ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité (A). L’œuvre est protégée quels que soient sa valeur, sa destination, son mode ou sa forme d’expression (B). A : L’absence de formalité Exprimée implicitement dans da loi de 1994- qui n’a prévu aucune condition de forme- cette absence de formalisme est expressément reprise et confirmée par la loi de 2009 dans l’article 18 nouveau sus indiqué « la protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création ». *La même solution est consacrée par la loi française dans l’article 111-1 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à uploads/s3/ titre-1-chapitre-2.pdf
Documents similaires
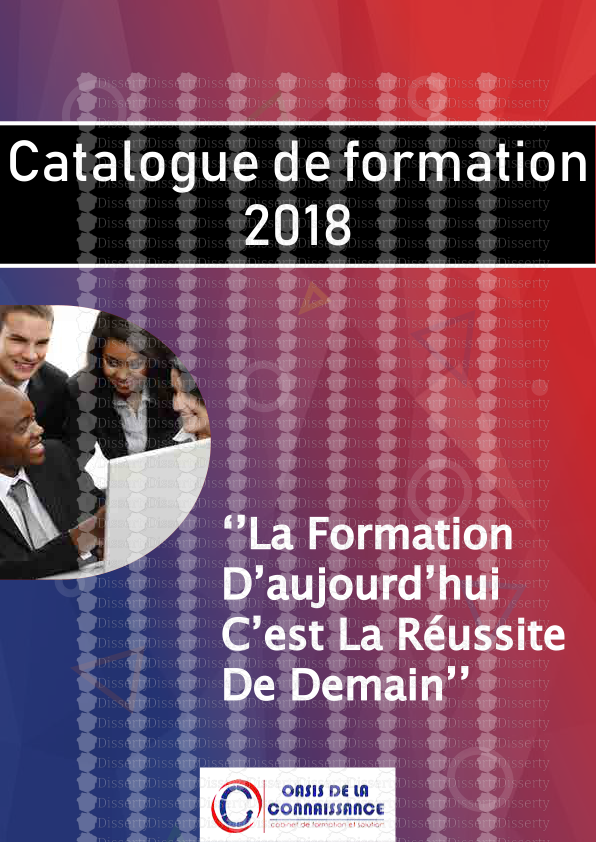
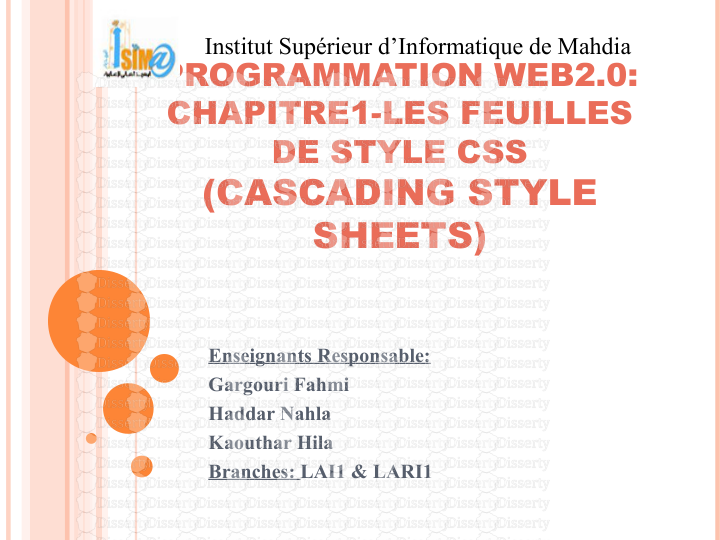





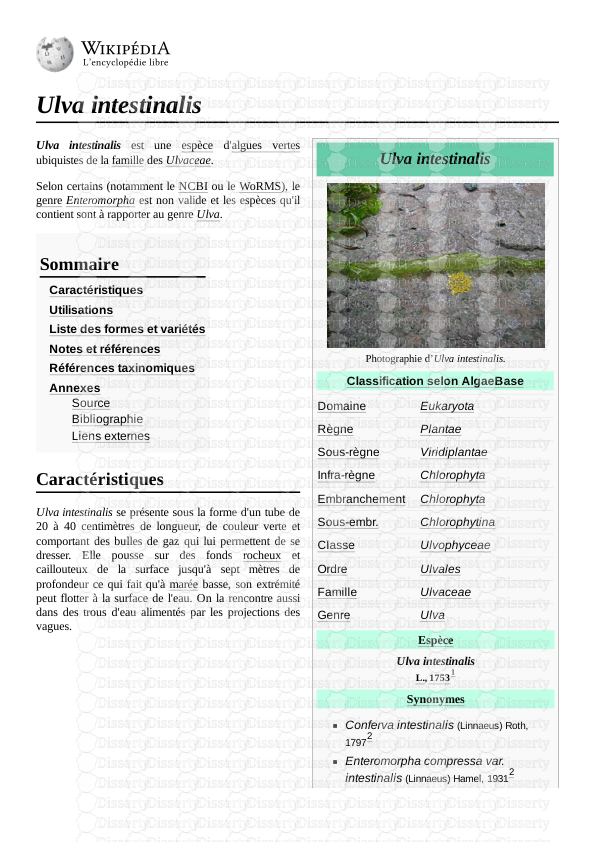
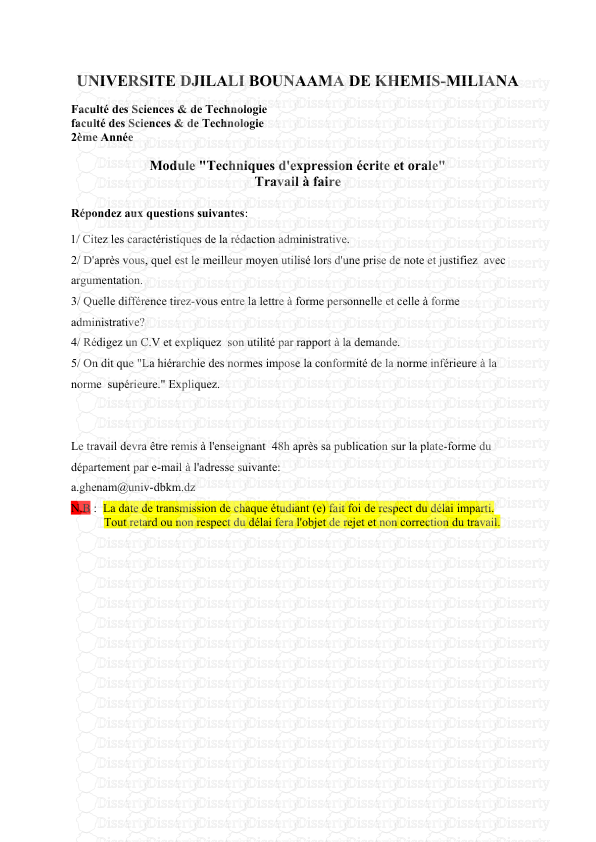

-
60
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 02, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.0946MB


