19 CHAPITRE 2: BROYAGE DES ALIMENTS 1- THÉORIE DU BROYAGE 1.1- Introduction Le
19 CHAPITRE 2: BROYAGE DES ALIMENTS 1- THÉORIE DU BROYAGE 1.1- Introduction Le broyage est une opération unitaire (toute production fait appel, qu'elle que soit l'échelle, à une suite coordonnée d'opérations fondamentales distinctes et indépendantes du procédé lui-même, appelées opérations unitaires. Une opération unitaire est donc une subdivision d'un procédé industriel qui consiste en général en une opération physique ou chimique. C’est une opération où est réalisée une seule transformation chimique ou physique) visant à fragmenter un matériau pour en réduire la taille afin de lui donner une forme utilisable ou d’en séparer les constituants. À cette fin, le matériau est soumis à des sollicitations mécaniques qui entraînent une augmentation de son énergie libre (l'énergie libre est la quantité de travail qu'un système thermodynamique peut effectuer). Cette énergie, lors de la fragmentation peut être transformée suivant différents processus en énergie élastique (l'énergie élastique est l'énergie associée à la déformation élastique d'un objet solide ou d'un fluide. L'élasticité est la propriété d'un matériau solide à retrouver sa forme d'origine après avoir été déformé. La déformation élastique est une déformation réversible) qui met en jeu les défauts de réseaux qui donnent naissance à la fissuration, en énergie de surface (la densité surfacique d'énergie ou énergie surfacique, voire densité énergétique, est la quantité d’énergie par une unité de surface) qui fait progresser les fissures et génère des fractures, et diverses autres formes d’énergie [avec comme possibles conséquences l’amorphisation (l'amorphisation est la transformation d'un matériau cristallin en un solide amorphe. Un matériau ainsi amorphisé est 20 dit métamicte) superficielle ou massique des solides cristallins, l’agglomération, les réactions mécano- chimiques]. 1.2- Fracture et mécanismes de rupture des matériaux 1.2.1- Physique de la fracture L’application d’une contrainte croissante à un solide, engendre dans celui-ci des déformations qui aboutissent à la fragmentation (partager, séparer en fragments). Pour des cas idéaux, la courbe représentant la déformation en fonction de la contrainte permet de distinguer deux grands domaines : - dans une première zone, la déformation est une fonction linéaire de la contrainte (cette zone permet de définir le module d’Young), la déformation y est élastique et donc réversible. - Si on augmente la contrainte et que l’on dépasse un point appelé limite d’élasticité, on entre dans un domaine dit de plasticité (la plasticité est la tendance d'une matière à rester déformée après réduction de la contrainte déformante à une valeur inférieure ou égale à celle de son seuil d'écoulement), dans lequel les déformations sont irréversibles. Ce domaine de plasticité se termine par un point de rupture (point au-delà duquel une chose, un objet se brise sous l'effet de contraintes ou de tensions excessives ); la cassure du matériau intervient au franchissement de ce point. Si le point de rupture est très proche du point de limite d’élasticité (la limite d'élasticité est la contrainte à partir de laquelle un matériau arrête de se déformer d'une manière élastique, réversible et commence donc à se déformer de manière irreversible. Pour un matériau fragile, c'est la contrainte à laquelle le matériau se rompt, notamment du fait de ses micro- fissures internes), la rupture est dite fragile, elle est alors brutale et se propage à grande vitesse suivant des surfaces de cohésion minimale. 21 Lorsque le point de rupture est situé après un large domaine de plasticité, la rupture est dite ductile (qui peut être allongé, étendu, étiré sans se romper. Se dit d'une déformation sans rupture), elle est progressive et nécessite le maintien de la contrainte jusqu’à la séparation des fragments. Les courbes déformation-contrainte, permettent de classer les matériaux en trois grandes catégories : - Les matériaux “fragiles” (cassants) ne présentent pas de domaine d’élasticité, ils se brisent au choc sans absorber beaucoup d’énergie; les morceaux peuvent être réassemblés comme un puzzle pour redonner la forme initiale. - Les matériaux “semi-fragiles” ces matériaux se cassent en présence de défauts (une entaille peut conduire à la rupture) avec un début de déformation plastique. - Les matériaux “malléables” qui présentent une grande plasticité et présentent de grandes déformations avant d’atteindre le point de rupture. Des forces de contact appliquées sur un volume solide créent dans celui-ci un réseau de fissures qui va, de par sa densité (la densité est le rapport de la masse d'un gaz à la masse d'air qui occupe le même volume à la même température et la même pression ou le rapport de la masse d'un liquide ou d'un solide à la masse d'eau occupant le même volume à la température de 4 °C) et son orientation, conditionner la taille et la forme des fragments qui résulteront après la rupture du matériau. Le résultat d’une opération de broyage est donc la conséquence d’une part des propriétés du solide broyé, et d’autre part de la nature, de la répartition et de l’intensité des contraintes que lui appliquent l’outil de broyage. 22 1.2.2- Modes de fragmentation Suivant le type de broyeur utilisé, les contraintes infligées à l’aliment à broyer sont de nature différente: - la compression ou l’écrasement sont souvent utilisés notamment dans les industries alimentaires où l’on retrouve fréquemment des broyeurs à cylindres lisses ou cannelés, - les broyeurs à impacts permettent d’atteindre différents ordres de grandeur en terme de tailles, allant du broyage grossier avec les broyeurs à marteaux au broyage ultra fin avec les broyeurs à jets d’air en passant par le broyage fin avec les broyeurs à broches, - le broyage par attrition est mis en œuvre dans les broyeurs à colloïdes ou broyeurs à disques, - le découpage et le cisaillement qui permettent éventuellement l’obtention de produit de dimension finie (couteaux, dilacérateurs) sur des matières qui peuvent présenter une certaine élasticité. 1.2.3- Mécanismes de fragmentation Suivant le matériau traité et le mode de fragmentation mis en œuvre, différents mécanismes de fragmentation restent possibles. On considère en général trois grands types de mécanisme de fragmentation qui compte tenu de l’inhomogénéité de la répartition des défauts structuraux des particules, interviendront souvent simultanément: - l’abrasion (action d'user par frottement) consiste en une érosion de la surface des particules; elle génère deux grandes populations: la première de taille voisine de la particule abrasée, la seconde constitué par les fragments arrachés étant une population de particules beaucoup plus fines que la population de départ. L’abrasion, a donné lieu à de nombreuses études notamment de la part des spécialistes de la fluidisation (la fluidisation est un processus par lequel une substance granulaire est 23 soumise à un fluide traitant dont la charge va se déposer sur ledit matériau. Ce processus se produit quand un fluide est passé vers le haut à travers la substance granulaire), domaine dans lequel ce mode de fragmentation est généré par un phénomène indésirable: l’attrition. L'attrition est définie comme une usure de deux particules dures par frottement. - la désintégration résulte d’un apport énergétique suffisamment intense pour engendrer une contrainte qui dépasse largement le point de fracture. Les particules ainsi générées sont de petite taille devant celle de la particule mère et la distribution de taille de ces fragments est très étalée. - le clivage (fracture selon certains plans d'orientation précise), phénomène intermédiaire entre l’abrasion et la désintégration, engendre la production de particules du même ordre de grandeur que la particule mère, il résulte d’un apport énergétique juste suffisant à la propagation de fractures préexistantes dans le matériau traité. 1.3- Caractéristiques des matériaux à broyer Le comportement d’un lot de particules vis-à-vis d’un processus de broyage va être étroitement lié à la nature de ces particules. Nous proposons ci-après un rapide inventaire des principales propriétés relatives à l’aptitude au broyage d’un matériau qui devront être prises en compte pour le choix d’un type de broyeur à utiliser. Le choix d’un broyeur dépend principalement de trois facteurs: - la nature de la matière première: est-elle abrasive (qui, par frottement, use, nettoie, polit), huileuse, dure, cassante, élastique, thermosensible, hygroscopique, etc..? - la distribution granulométrique (la granulometrie est la mesure des dimensions des grains d'un mélange, détermination de leur forme et étude de leur répartition dans différents intervalles dimensionnels. Il s’agit 24 donc de la taille moyenne et la variance) de l’aliment que l’on cherche à obtenir. - le dimensionnement de l’unité industrielle: quantité et/ou débit. 1.3.1- Dureté La dureté (caractère de ce qui est dur, de ce qui résiste au choc, à la pression; résistance ou inversement la fragilité) est vraisemblablement la propriété la plus couramment employée dans l’industrie. Elle traduit, au moyen de tests standardisés, la résistance du matériau à la propagation des fissures. On peut la définir comme l’aptitude d’une particule à résister à la pénétration d’une autre. Cette propriété permet de classer les différents matériaux des plus “fragiles” aux plus “durs”. 1.3.2- Abrasivité Cette propriété est intimement liée à la précédente: c’est l’aptitude d’un matériau à user une surface. Elle est d’une grande importance économique: elle conditionne l’usure du broyeur par le matériau à broyer et la contamination de l’aliment qui en résulte. 1.3.3- Adhésivité L’adhésivité traduit l’aptitude des particules à se coller entre elles (agglomération) ou aux parois du broyeur. Cette caractéristique est liée à la taille uploads/s3/ structure-physique-des-aliments-chapitre-2.pdf
Documents similaires
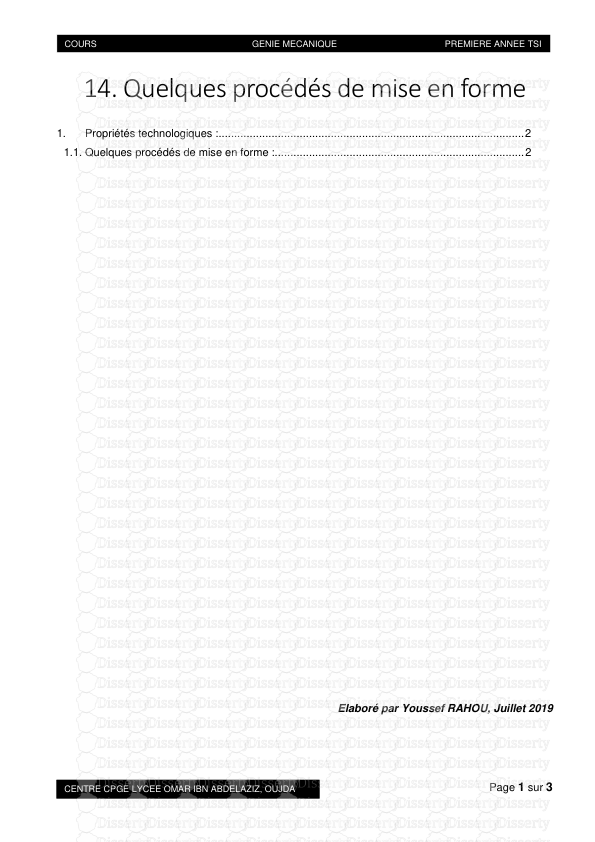









-
66
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 03, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1614MB


