Perspective Actualité en histoire de l’art 1 | 2014 L’atelier De l’atelier au m
Perspective Actualité en histoire de l’art 1 | 2014 L’atelier De l’atelier au monument et au musée From studio to monument to museum Oskar Bätschmann, Aldo De Poli, Dario Gamboni, Daniel F. Herrmann et Giles Waterfield Traducteur : Géraldine Bretault Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/perspective/4345 DOI : 10.4000/perspective.4345 ISSN : 2269-7721 Éditeur Institut national d'histoire de l'art Édition imprimée Date de publication : 1 juin 2014 Pagination : 43-54 ISSN : 1777-7852 Référence électronique Oskar Bätschmann, Aldo De Poli, Dario Gamboni, Daniel F. Herrmann et Giles Waterfield, « De l’atelier au monument et au musée », Perspective [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 31 décembre 2015, consulté le 02 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/perspective/4345 ; DOI : https:// doi.org/10.4000/perspective.4345 débat PERSPECTIVE 2014 - 1 43 De l’atelier au monument et au musée Points de vue de Oskar Bätschmann, Aldo De Poli, Daniel F. Herrmann et Giles Waterfield, avec Dario Gamboni L’évolution récente des musées, avec l’accent mis sur l’événementialité des expositions temporaires et la tendance à la délocalisation par créa tion de filiales, voire de franchises, a donné un relief nouveau aux institu tions qui, comme les ateliers d’artistes ayant fait l’objet d’une patrimonia lisation, s’inscrivent dans une temporalité plus longue et sont liées pour leur raison d’être à une personne et souvent à un lieu. La conservation des ateliers, comme celle des maisons d’artistes dont ils sont souvent (mais non toujours) une partie, a dépendu d’abord de la piété et servi au culte de l’art et des artistes. Cette dimension cultuelle, particulièrement évidente lorsque les lieux concernés incluent la sépulture de l’artiste, n’est pas incompatible avec la valeur historique ni avec l’intérêt scienti fique, lequel doit au contraire en tenir compte et l’intégrer à son propos, mais elle s’oppose au postulat d’autonomie qui a gouverné l’esthé tique muséologique moderniste. Comme l’atelier lui-même, la problématique de la conservation de l’atelier fait partie d’ensembles plus vastes : maisons d’artistes, monuments, lieux de mémoire… Leur spécificité tient au fait qu’ils attirent et retiennent en raison de leur proximité, réelle ou supposée, avec le phénomène de la création artistique. À ce titre, ils appartiennent à la fois au passé dont ils témoignent, et au présent de la réception des œuvres, toujours actualisée par chaque sujet : ils représentent un lieu physique où ces deux moments du temps peuvent entrer en contact. L’enjeu de cette articulation soulève des questions nombreuses, dont plusieurs sont abordées dans notre débat : celle du cadre de délimitation de l’objet conservé, et du contexte qui lui demeure ou non associé ; celle des conditions de l’authenticité (matérielle, génétique, vécue) de la trans mission ; celle du rapport entre la dimension mythique de l’atelier, comme représentation et comme attente, et la volonté d’informer objectivement ; celle, enfin, de l’actualité de l’atelier au vu de l’évolution des pratiques et des lieux de l’activité artistique. [Dario Gamboni] Dario Gamboni. Les ateliers, notamment ceux qui ont été conservés, faisaient souvent partie d’ensembles architecturaux et fonctionnels plus vastes, comprenant selon les cas habitation, galerie, entrepôt, etc. Dans quelle mesure est-il légitime de les en isoler ? Ce problème se pose-t-il différemment selon l’origine historique et culturelle de l’atelier ? Oskar Bätschmann, profes- seur émérite de l’université de Berne et Research Professor à l’Institut suisse pour l’étude de l’art à Zurich, est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont The Artist in the Modern World: The Conflict between Market and Self-Expression (1997). Architecte diplômé et profes- seur à la faculté d’architecture de l’université de Parme, Aldo De Poli a collaboré à de nombreuses expositions (la Biennale de Venise, Arti & Architettura...) et a publié sur l’architecture, les maisons- musées et la muséographie. Dario Gamboni est professeur d’histoire de l’art à l’université de Genève. Il prépare un ou- vrage sur les musées d’artistes et de collectionneurs pour la « Yale Series on the History and Theory of Art Museums » (à paraître). Daniel F. Herrmann est Eisler Curator & Head of Curatorial Studies à la Whitechapel Gallery. Conservateur en 2004-2010 à la Scottish National Gal- lery of Modern Art, il était en charge de la reconstitution de l’atelier d’Eduardo Paolozzi. Giles Waterfield est directeur des Royal Collection Studies et Associate Lecturer au Courtauld Institute. Il a signé de nom- breuses expositions (The Artist’s Studio, 2009) et publications académiques (The People’s Galleries, à paraître en 2015). L’AteLier 44 débat PERSPECTIVE 2014 - 1 2. Le cabinet de travail de Sigmund Freud, avec le bureau à gauche et le divan à droite, dans l’actuel Freud Museum London. Oskar Bätschmann. Il est sans doute préférable, ou à tout le moins sou- haitable, que soient conservés les ensembles architecturaux et fonc- tionnels dont faisaient partie les ate- liers. C’est ce qu’on a heureusement fait avec la Villa Stuck à Munich, par exemple (fig. 1). Mais le choix concret d’une solution ou d’une autre dépendra toujours moins de la doctrine de conservation à laquelle on adhère, et bien davantage des finances à dis- position, de la volonté et de la possibilité qu’une société, une fondation, une ville ou un État assume le soin de veiller à la conservation d’un ensemble. L’expérience com- mune montre que l’intérêt public pour un atelier d’artiste diminue rapidement une fois que l’attrait de la nouveauté s’est dissipé, et qu’il a tendance à disparaître tout à fait, ce qui a des conséquences graves pour la conservation matérielle. Giles Waterfield. L’atelier d’artiste, conservé ou en activité, a toujours fonctionné selon une grande variété de modalités : comme le foyer de la créativité artistique individuelle, comme un atelier de production d’œuvres exécutées mais non conçues par des assis- tants, ou encore comme un lieu d’exposition et de vente d’œuvres d’art, un lieu de vie, une retraite pour la méditation personnelle, un foyer d’hospitalité conviviale ou érotique. L’atelier conservé peut être considéré soit comme une sorte de document, soit comme un lieu de mémoire. Dans le premier cas, il peut être justifié de traiter le studio comme un phénomène isolé, ce qui implique que l’artiste soit placé sous un microscope et analysé comme un individu à part. Dans le second cas – qui, il faut le dire, séduit généralement un large public –, il est impensable d’isoler l’atelier de son environnement, ce qui reviendrait à considérer l’artiste non plus comme un individu, mais comme un simple moteur dans la création des œuvres d’art. La relation entre l’atelier et la demeure ou la galerie, ou toute autre entité ayant subsisté, n’enrichit pas seulement notre compréhension de la personne, elle reflète surtout le processus complexe selon lequel cet artiste (ou ses admirateurs) choi- sit d’être commémoré, ainsi que le contexte dans lequel son œuvre a évolué. Des notions telles que la « mort de l’artiste » – au sens de mort de l’au- teur, de rejet de la biographie – sont, assurément, particu- lièrement inopérantes dans ce contexte. L’atelier conservé fait partie d’un mouvement plus large qui vise à conserver, voire à monumentaliser la demeure des hommes (et, moins souvent, des femmes) illustres. Apparu au début du xixe siècle, ce mouvement concerne surtout la maison d’écrivain ; il peut aussi s’agir de la demeure d’un compositeur, d’un architecte, d’un homme politique, sans oublier Sigmund Freud (fig. 2). Ces habita- tions et lieux de travail conservés pourraient être regroupés sous le terme de « musées de personnalité », suggérant non seulement leur association avec tel individu mais aussi le statut particulier que cette personne a acquis au cours de sa vie, voire même après sa mort par le biais du musée. 1. Le salon et de la salle de musique de Franz von Stuck, construits vers 1897-1898, dans l’actuel Museum Villa Stuck, Munich. De l’atelier au monument et au musée débat PERSPECTIVE 2014 - 1 45 Daniel F. Herrmann. Ces dernières années ont vu émerger une tendance à intégrer des environnements d’ateliers au sein des musées d’art. Ces espaces sont pour la plupart des reconstitutions de lieux de travail ayant appartenu à des auteurs uniques. S’ils présentent de grands avantages, ils ne sont pas pour autant exempts d’inconvénients 1. Parmi les avantages potentiels, il faut citer l’effet spectaculaire et l’apport didactique d’une confrontation visuelle directe, la prise en charge immédiate de la conservation du matériel exposé, ainsi qu’un accès élargi pour les chercheurs comme pour les visiteurs 2. Quant aux écueils éventuels, ils incluent le risque de privilégier la biogra- phie comme principale méthode d’interprétation, et de perpétuer des conventions artistiques traditionnelles au détriment de modes alternatifs de production artistique. Ces dispositifs muséalisés ne montrent jamais qu’un état unique de l’ate- lier. Ils suggèrent un locus unicum de production du génie, alors que beaucoup d’artistes disposent de plusieurs lieux où exercer leur activité : planche à dessin, pièce à vivre, atelier d’imprimerie, fonderie, etc. Ces présentations mettent en outre l’accent sur un moment particulier et contingent de la production, au lieu de ren- seigner sur l’évolution des pratiques de l’artiste tout au long de sa vie. Si tel est déjà le cas lorsqu’un atelier d’artiste est converti en musée, l’intégration d’un ate- uploads/s3/ perspective-4345.pdf
Documents similaires






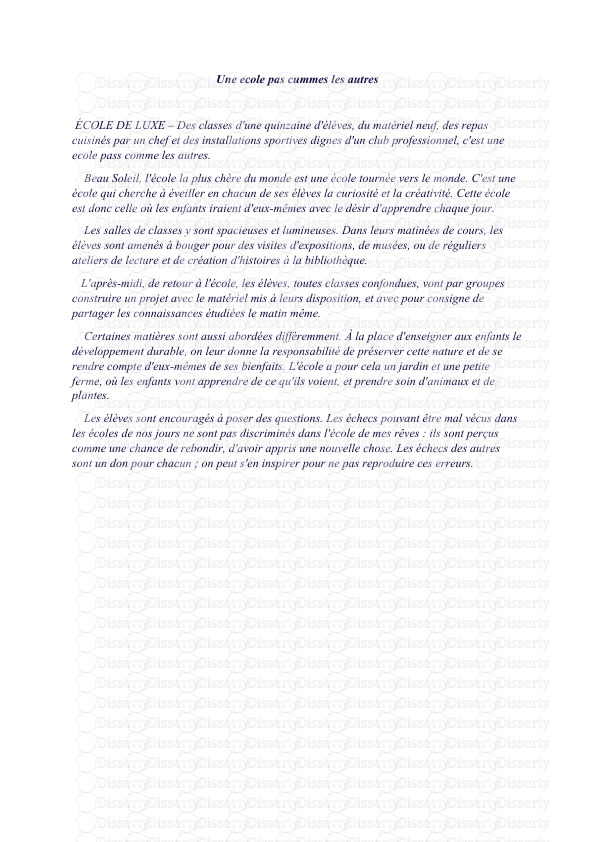



-
64
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 21, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 1.2553MB


