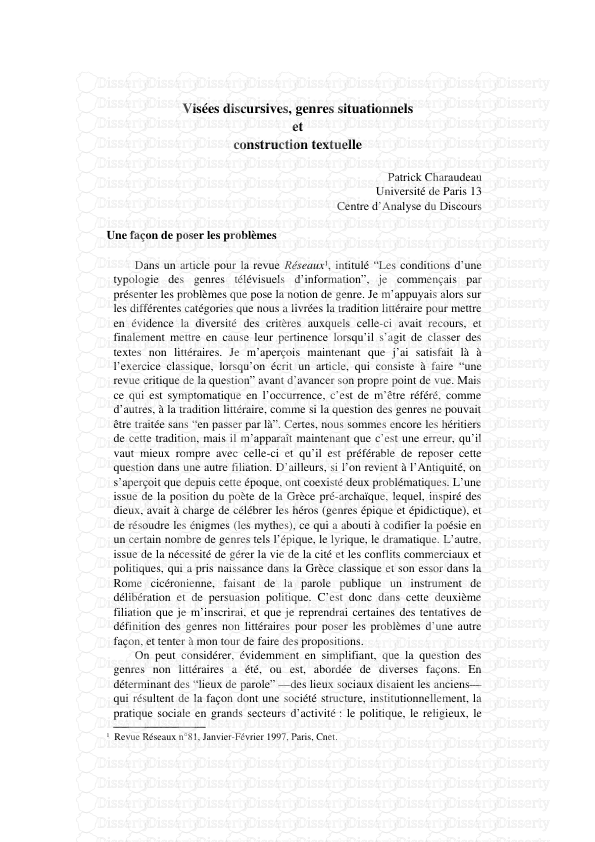Visées discursives, genres situationnels et construction textuelle Patrick Char
Visées discursives, genres situationnels et construction textuelle Patrick Charaudeau Université de Paris 13 Centre d’Analyse du Discours Une façon de poser les problèmes Dans un article pour la revue Réseaux1, intitulé “Les conditions d’une typologie des genres télévisuels d’information”, je commençais par présenter les problèmes que pose la notion de genre. Je m’appuyais alors sur les différentes catégories que nous a livrées la tradition littéraire pour mettre en évidence la diversité des critères auxquels celle-ci avait recours, et finalement mettre en cause leur pertinence lorsqu’il s’agit de classer des textes non littéraires. Je m’aperçois maintenant que j’ai satisfait là à l’exercice classique, lorsqu’on écrit un article, qui consiste à faire “une revue critique de la question” avant d’avancer son propre point de vue. Mais ce qui est symptomatique en l’occurrence, c’est de m’être référé, comme d’autres, à la tradition littéraire, comme si la question des genres ne pouvait être traitée sans “en passer par là”. Certes, nous sommes encore les héritiers de cette tradition, mais il m’apparaît maintenant que c’est une erreur, qu’il vaut mieux rompre avec celle-ci et qu’il est préférable de reposer cette question dans une autre filiation. D’ailleurs, si l’on revient à l’Antiquité, on s’aperçoit que depuis cette époque, ont coexisté deux problématiques. L’une issue de la position du poète de la Grèce pré-archaïque, lequel, inspiré des dieux, avait à charge de célébrer les héros (genres épique et épidictique), et de résoudre les énigmes (les mythes), ce qui a abouti à codifier la poésie en un certain nombre de genres tels l’épique, le lyrique, le dramatique. L’autre, issue de la nécessité de gérer la vie de la cité et les conflits commerciaux et politiques, qui a pris naissance dans la Grèce classique et son essor dans la Rome cicéronienne, faisant de la parole publique un instrument de délibération et de persuasion politique. C’est donc dans cette deuxième filiation que je m’inscrirai, et que je reprendrai certaines des tentatives de définition des genres non littéraires pour poser les problèmes d’une autre façon, et tenter à mon tour de faire des propositions. On peut considérer, évidemment en simplifiant, que la question des genres non littéraires a été, ou est, abordée de diverses façons. En déterminant des “lieux de parole” —des lieux sociaux disaient les anciens— qui résultent de la façon dont une société structure, institutionnellement, la pratique sociale en grands secteurs d’activité : le politique, le religieux, le 1 Revue Réseaux n°81, Janvier-Février 1997, Paris, Cnet. juridique, le scientifique, l’éducatif, etc. D’après des grandes “fonctions” de base de l’activité langagière, selon le pôle de l’acte de communication vers lequel elles sont orientées : ce sont les fonctions bien connues de Jakobson (émotive, conative, phatique, poétique, référentielle et métalinguistique)2, ou de Halliday (instrumentale, interactionnelle, personnelle, heuristique, imaginative, idéationnelle, interpersonnelle, etc.)3. En se fondant sur la “nature communicationnelle” de l’échange verbal selon que, comme le propose Bakhtine4, celle-ci est “naturelle”, spontanée (genres premiers), ou “construite”, institutionnalisées (genres seconds) ; ou que, comme d’autres le proposent, les textes produits sont dialogiques ou monologiques, oraux ou écrits. En s’appuyant sur l’“appareil formel de l’énonciation”, comme l’a proposé Benveniste avec l’opposition “discours / récit”5, et d’autres qui, dans cette lignée ou celle des travaux de Culioli, font des classifications en fonction des marques énonciatives. En tentant de définir des “types d’activité langagière”, ayant une valeur plus ou moins prototypique, tels le narratif, l’argumentatif, l’explicatif, le descriptif, etc. En décrivant les caractéristiques formelles des textes et en rassemblant les marques les plus récurrentes pour conclure à la détermination d’un genre textuel6. Enfin, en cherchant à déterminer un domaine de production de discours d’après des textes fondateurs dont la finalité est de déterminer les valeurs d’un certain domaine de production discursive, comme peuvent l’être le discours philosophique, le discours scientifique, le discours religieux, le discours littéraire, etc.7. Cette rapide revue des façons d’aborder la notion de genre ne prétend pas à l’exhaustivité. Elle rappelle au passage, si besoin était, la complexité de la question, mais elle est surtout destinée à montrer que ce qui est pris en compte pour définir cette notion concerne tantôt l’ancrage social du discours, tantôt sa nature communicationnelle, tantôt les activités langagières mises en œuvre, tantôt les caractéristiques formelles des textes produits. Or, on peut se demander si ces différents aspects ne sont pas liés. Je les reprendrai donc ici pour mettre en évidence les problèmes qu’ils posent lorsqu’on les considère séparément, et proposer une manière de les articuler. En premier lieu, l’aspect de l’ancrage social qui fonde les genres en les rattachant aux différentes pratiques sociales qui s’instaurent dans une société. Celles-ci peuvent jouer, pour les acteurs langagiers, un rôle empirique de point de repère, point de repère sans lequel, comme le dit 2 Jakobson R., Essais de linguistique générale, Ed. de minuit, Paris, 1963 3 Halliday M.A.K., “The functional basis of language”, in Bernstein D. (ed) Class, codes and control, vol.2, Routledge and Kegan Paul, London, 1973 ; “Dialogue with H. Parret”, in Parret H. (ed.), Discussing language, Mouton, La Haye, 1974.“ 4 Bakhtine M., Esthétique de la création verbale, Gallimard, Paris, 1984. 5 Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1969 6 Voir les carnets du Cediscor n°1 Un lieu d’inscription de la didacticité, Presses de la Sorbonne Nouvelle,1992. 7 Ce que D. Maingueneau et F. Cossuta appellent les “discours constituants”, voir leur article in Langages n°117, Paris, Larousse, 1995. 2 Bakhtine, “l’échange verbal serait impossible”8. Mais on peut aller jusqu’à les considérer comme un champ structuré (au sens de Bourdieu), où s’instaurent des rapports de forces symboliques entre les acteurs, rapports de forces plus ou moins hiérarchisés et institutionnalisés selon le champ concerné. Ces champs —que je préfère appeler “domaines de pratique langagière” parce que cette dénomination renvoie davantage à l’expérience communicative— déterminent donc par avance l’identité des acteurs qui s’y trouvent, les rôles qu’ils doivent tenir, ce qui fait que les significations des discours qui y circulent sont fortement dépendantes de la position de leurs énonciateurs. En radicalisant ce point de vue, on pourrait dire que c’est le statut de l’acteur social et le rôle qu’il joue qui sont déterminants pour juger de la conformité d’un discours vis-à-vis du domaine dans lequel il est produit. Ainsi, tout discours serait marqué au sceau d’une certaine “performativité”, dès lors que l’acteur social, qui en est l’origine énonciative, serait reconnu dans son statut : ce n’est plus ce qui est dit qui compte, mais l’origine énonciative externe de ce qui est dit. C’est pourtant ce qui fait question (d’où les conditionnels). A faire dépendre la signification des discours du statut de l’acteur producteur de l’acte de langage, de sa position de légitimité plus que de son rôle de sujet énonciateur, cela voudrait dire que quelle que soit la façon de parler, il produirait un discours typique du domaine concerné. Dès lors, le prêtre qui baptise pourrait aussi bien dire “Je te décore” que “Je te baptise”, ce qui veut dire qu’il n’existerait pas de caractéristiques discursives propres à un domaine9 : appartiendrait au genre politique tout discours produit dans le domaine de pratique politique, au genre médiatique tout discours produit dans le domaine de pratique des médias, au genre scientifique tout discours produit dans le domaine de pratique des sciences, etc. Or, on peut faire raisonnablement l’hypothèse que tout domaine de pratique sociale tend à réguler les échanges, et par voie de conséquence à instaurer des régularités discursives, voire, comme l’a montré l’ethnométhodologie, des ritualisations langagières, dont on pourrait même dire qu’elles constituent l’une des marques (au sens où l’on marque un territoire) du domaine10. Reste qu’il faut trouver le moyen d’articuler ce domaine de pratique sociale avec l’activité discursive. La difficulté provient du fait que ces domaines de pratique sont trop extensifs et englobants pour qu’on puisse y repérer des régularités discursives. La proposition qui va 8 Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, 1984. 9 C’est, finalement, pousser au bout la proposition de Bourdieu qui dit que “Le pouvoir des paroles n’est autre chose que le pouvoir délégué du porte-parole” du fait que le pouvoir ne se trouve pas dans les mots mais dans les “conditions sociales d’utilisation des mots”, (1982), Ce que parler veut dire, Paris Fayard, pp. 103. 10 Les anciens en avait fait l’hypothèse d’une façon peut-être un peu trop radicale dans la mesure où pour eux on ne pouvait être reconnu et légitimé dans un “lieu social” que si coïncidaient le rôle langagier que l’on tenait et la forme langagière que l’on produisait. Ce qui explique que la forme étant légitimante, elle puisse être catégorisée (Aristote). Sonia Branca rappelle, en citant les travaux de A. Collinot, F. Mazière et F. Douay-Soublin, que c’est ce modèle que les jésuites ont entretenu par les classes de rhétorique jusqu’au 18° siècle (voir : “Types, modes et genres”, à paraître dans la revue Langage et Société n°87). 3 suivre consiste précisément à structurer le domaine de pratique sociale en domaine de communication, ce qui constitue une réponse possible à cette question. En attendant, on prendra acte du fait que, uploads/s3/ charaudeau-visees-discursive.pdf
Documents similaires










-
33
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 23, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1441MB