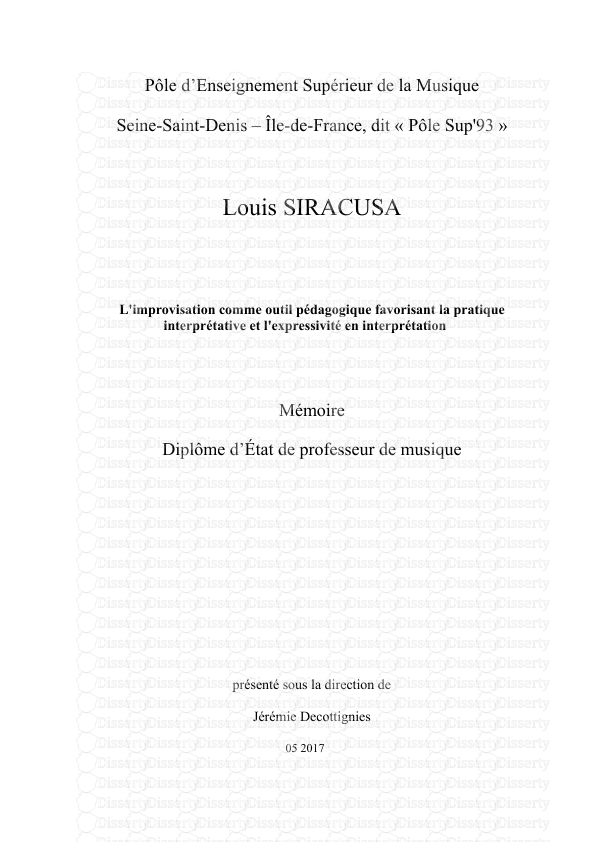Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique Seine-Saint-Denis – Île-de-France,
Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique Seine-Saint-Denis – Île-de-France, dit « Pôle Sup'93 » Louis SIRACUSA L'improvisation comme outil pédagogique favorisant la pratique interprétative et l'expressivité en interprétation Mémoire Diplôme d’État de professeur de musique présenté sous la direction de Jérémie Decottignies 05 2017 ENGAGEMENT RELATIF AU PLAGIAT Je soussigné(e), Siracusa, Louis, certifie qu’il s’agit d’un travail original et que toutes les sources utilisées ont été indiquées dans leur totalité. Je certifie, de surcroît, que je n’ai ni recopié ni utilisé des idées ou des formulations tirées d’un ouvrage, article ou mémoire, en version imprimée ou électronique, sans mentionner précisément leur origine et que les citations intégrales sont signalées entre guillemets. Signature : SIRACUSA Louis L'improvisation comme outil pédagogique page 2/57 RÉSUMÉ L'improvisation comme outil pédagogique favorisant la pratique interprétative et l'expressivité en interprétation par SIRACUSA Louis Ce mémoire cherche à mettre en lumière les liens entre l'improvisation et l'interprétation, dans l'optique de créer un outil pédagogique utile à l'apprentissage initial d'un instrument de musique en conservatoire. Seront analysés les liens entre la créativité interprétative et l'expressivité de l'improvisation, les enjeux pédagogiques de l'improvisation, ainsi que des cas particuliers ou l'improvisation a été utilisée pour favoriser une compréhension esthétique ou technique, c’est-à- dire favoriser et faciliter l'expressivité en interprétation. Mots-clés : Improvisation, créativité, interprétation, expressivité, outil pédagogique REMERCIEMENTS Je remercie mon directeur de mémoire, Jérémie Decottignies, pour ses conseils avisés, Je remercie également tous mes professeurs d'improvisation, et tous les improvisateurs qui m'ont accompagné le temps d'une masterclasse. SIRACUSA Louis L'improvisation comme outil pédagogique page 4/57 Table des matières Introduction......................................................................................................................................6 I. L'improvisateur, l'interprète et l'œuvre.........................................................................................8 I.A La créativité et l'expressivité en interprétation et dans l'improvisation................................8 I.A.A. L'autorité, la créativité de l'improvisateur et l'interprétation expressive.....................8 I.A.B. John Cage, l’indétermination et l'espace créatif laissé à l'interprète...........................9 I.A.C. Visions historicistes et expressionnistes....................................................................10 I.A.D. Expressionnisme, référentialisme et formalisme, l'expressivité à l'épreuve de l'esthétique............................................................................................................................12 I.A.E. Expressivité, créativité du musicien et temporalités..................................................16 I.B. L'histoire.............................................................................................................................18 I.B.A. Du baroque au romantique....................................................................................... 18 I.B.B L'improvisation non-idiomatique et le soundpainting................................................19 II.Utilisation de l'improvisation en pédagogie...............................................................................20 II.A. Les enjeux pédagogiques de l'improvisation....................................................................20 II.A.A L'écoute .................................................................................................................... 21 II.A.B. La créativité..............................................................................................................23 II.A.C. La réactivité..............................................................................................................23 II.A.D L'anticipation.............................................................................................................25 II.A.E. La présence scénique et le rapport au corps.............................................................25 II.A.E La construction d'un discours....................................................................................26 II.A.F. La confiance en soi................................................................................................... 27 II.B. Exemples pratiques...........................................................................................................28 II.B.A. Les problématiques générales.................................................................................. 28 II.B.A.a. le son, le timbre et le poids...............................................................................29 L'exercice :..................................................................................................................29 II.B.A.b. Le rythme et la conscience rythmique..............................................................30 L'exercice....................................................................................................................31 II.B.A.c. Analyse des cas proposés..................................................................................31 II.B.B. Les objectifs musicaux............................................................................................. 32 II.B.B.a. Les musiciens de Brême : L'analogie pour construire une improvisation........32 II.B.B.b. Les musiciens de Brême : déroulé et analyse...................................................34 Conclusion..................................................................................................................................... 37 Annexe...........................................................................................................................................39 Bibliographie................................................................................................................................. 54 Introduction Le premier acte musical est la vibration sonore. Comme les astrophysiciens procédant à l'étude harmonique des premiers instants observables de l'univers pour en déceler les potentielles évolutions passées, le fond diffus cosmologique, un simple son proposé ouvre la possibilité de l'étude d'un champ de possibilités, d'une potentialité musicale. Et là, un deuxième son apparaît. La dualité crée une tension, un contraste, ou encore une harmonie. Une nouvelle échelle temporelle s’est créée de l’intervalle entre ces deux sons À l'instar de la vision platonicienne de la musique, nous pourrions nous arrêter là. « il faut se garder de changer pour passer à une nouvelle forme de musique, comme on se garde de ce qui mettrait en péril l’ensemble. En effet, les modes de la musique ne sont nulle part ébranlés sans que le soient aussi les plus grandes lois politiques »1 La simplicité et la répétition inébranlable rend compte de la meilleure des façons de l'harmonie du monde des idées et des lois, l'harmonie céleste. « la multiplicité engendre ici le dérèglement, et là la maladie ; tandis que la simplicité en musique engendre dans les âmes la modération »2. Mais nous, les musiciens, allons plus loin, pour observer toutes ces possibilités, jouer de la régularité, de l'harmonie, des tensions, confronter les mondes et les lois à travers un agencement de vibrations. Malheureusement, la beauté est fugace, elle s'évanouit avec le temps. Il faudrait donc réduire cet acte en informations pour que tous puissent les découvrir également, créer pour l'autre, dans l’éternité. Une partition transmet suffisamment d'informations pour permettre à quiconque de recréer cet instant, me dira-t-on. Mais l'autre, comprendra-t-il le message, aura-t-il compris le propos même de cette œuvre ? N'aurait-il pas besoin lui-même de vivre cette création pour en comprendre réellement le sens ? Il y a dans cette question une problématique d'incarnation de l'œuvre par l'interprète. Incarner, c’est-à-dire trouver un rapport entre l'œuvre et soi dans l'interprétation. L'interprète face au compositeur possède un rôle très mouvant, en fonction des époques et des modes d'interprétation. Mais quel que soit son rôle attribué, il n'en reste pas moins qu'il est le garant de l'incarnation de l'œuvre, de sa transformation en phénomène physique que l'on peut entendre. Il peut être réduit à un état de machine, exécutant parfaitement les informations présentes sur la partition, mais, derrière ce corps réalisant, on décèle des indices d'une créativité. Si on considère l'éducation créative, qui est le courant de science de l'éducation défendant l'enseignement de la créativité, on remarque que leurs études à grande échelle se retrouvent 1. PLATON, La République , Livre IV, Traduction Émile Chambry 2 Ibid. Livre III SIRACUSA Louis L'improvisation comme outil pédagogique page 6/57 parfois contrariées par le manque de formation quant à cet enseignement de la créativité3 des professeurs de musique. Enseigner dans le but de développer la créativité des élèves s'apprend. C'est pourquoi j'essaye de me créer des outils pédagogiques adaptés afin d’enseigner la créativité et l’expressivité, et apprendre à l'enseigner, sur la base de mes lectures et expériences. Mon expérience la plus flagrante par son intensité et sa potentialité créative et expressive étant l'improvisation, je vais essayer à travers ce mémoire de créer un pont entre les pratiques, associer la créativité interprétative avec la créativité de l'improvisateur, pour amener l’apprenant à expérimenter la création, pour mieux comprendre l'interprétation. Les enseignements dans l'apprentissage initial de la musique dans les conservatoires de France sont principalement centrés autour de l'interprétation. Enseigner l'improvisation et enseigner par l'improvisation nécessite donc de penser les liens entre interprétation et improvisation chez l'instrumentiste. Nous allons étudier ces liens en prenant comme axe dominant l'expressivité et la créativité, et nous essayerons par là même d’en révéler le parallélisme. Cela implique une question principale, est-ce que la créativité et l'expressivité personnelle propre à l'improvisation ont une place dans le travail interprétatif ? Est-ce que l'expressivité et la créativité en improvisation sont assimilables à celle de l'interprétation, et est-il envisageable d'utiliser l'improvisation comme outil pédagogique pendant l'apprentissage initial de l'interprétation ? La créativité brille également par une grande multiplicité de ses définitions. Pamela Burnard la définit comme dépendante d'un contexte culturel, d'un produit social dépendant que de l'observateur, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas contenue dans l'esprit humain4 . Cela impliquerait que, tel la théorie de la relativité générale d'Einstein où tout événement physique dépend du point de vue que l'on prend, on ne pourrait juger la créativité d'un musicien que par le regard qu'on porte sur son interprétation, un regard teinté d'un contexte référencé. À la manière de l'observateur qui est acteur du phénomène physique, l'auditeur serait acteur de la créativité du musicien. Pour le développement du mémoire, nous partirons de la définition de T. Lubart, qui dit de la créativité qu'elle est « la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste »5, car elle permet à l'interprète d'être acteur de sa créativité. Nous assimilerons également l'expressivité à la créativité. Méthodologie 3 Zbainos, Dmitri, Anastasopoulou, Ariadni, « Such findings lead to suggestions for numerous changes in music teachers’ education, establishing training in teaching for creativity as a fundamental priority. » traduction personnelle, « de telles découvertes appellent à de nombreux changements dans l'éducation des professeurs de musique, pour établir l'enseignement pour la créativité comme une priorité fondamentale », créative éducation, vol 3. no 1, 2012, parlant d'une étude de grande échelle sur l'éducation à la créativité musicale en Grèce 4 Mili, Isabelle, créativité didactique dans l'enseignement musical, Créativité et création en éducation, Volume 40, n° 2, Automne 2012, définition rapportée de la vision de Pamela Burnard, p. 142 5LUBART, Todd, Psychologie de la créativité. Paris, Armand Colin, p. 11 Concernant l'axe d’étude de l'improvisation, bien que mes exemples pratiques soient dans un cadre majoritairement non-idiomatique, je n'ai volontairement pas limité le champ de l'improvisation à ce type d'improvisation, pour parler d'une pratique en général et pas uniquement d'un seul courant. En effet une grande partie du propos contenu dans ce mémoire porte sur l'expressivité dans son instantanéité en improvisation, comparée à celle de l'interprétation, il est donc possible de lier toutes les pratiques de l'improvisation et de l'invention musicale en temps réel à cette expressivité. Le cadre des improvisations dans les exemples de pratique en cours peut moduler en fonction du besoin. Les exemples présentés n'imposent pas de cadre idiomatique car cet attachement stylistique n'aurait aucune influence sur le résultat uploads/s3/ l-x27-improvisation-comme-outil-pe-dagogique-me-moire.pdf
Documents similaires










-
53
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 28, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.8771MB