Communication L’évolution du concept de mythomanie dans l’histoire de la psychi
Communication L’évolution du concept de mythomanie dans l’histoire de la psychiatrie The evolution of the concept of mythomania in the history of psychiatry T. Haustgena,*, M.-L. Bourgeoisb a CMP, 77, rue Victor-Hugo, 93100 Montreuil, France b Institut Pitres et Régis, hôpital Charles-Perrens, IPSO, université Victor-Segalen Bordeaux-II, 121, rue de la Béchade, 33076 Bordeaux cedex, France Disponible sur internet le 22 mai 2007 Résumé Au XIXe siècle, les allégations mensongères et l’exubérance imaginative sont signalées dans plusieurs formes d’aliénation mentale : mono- manie intellectuelle (Esquirol, 1819), folies héréditaires (Morel, 1860), mégalomanie (Dagonet, 1862 et 1876), délire de grandeur (Foville, 1871) — avec prévalence de thèmes de filiation — et surtout folie hystérique (J. Falret, 1866 ; Lasègue, 1881). Plusieurs mystificateurs célèbres dans l’histoire (fausses Jeanne-d’Arc, faux Louis XVII) auraient présenté ce type de troubles. Delbrück trace pour la première fois en Allemagne le tableau d’une forme d’aliénation reposant sur la déformation de la vérité qu’il nomme mensonge pathologique ou pseudologie fantastique (1891). Le Français E. Dupré (1862–1921) décrit en 1905 la mythomanie et ses trois formes : 1) vaniteuse (hâblerie fantastique, autoaccusation crimi- nelle, simulation de maladies) ; 2) maligne (mystification, hétéroaccusation calomnieuse) ; 3) perverse (escrocs, séducteurs d’habitude, mytho- manes errants). À partir de 1910, il en fait le fondement des délires d’imagination, soit chroniques (autosuggestion, fabulation), soit aigus (sou- vent symptomatiques de troubles mentaux organiques). En 1919, à travers sa doctrine des déséquilibres constitutionnels héréditaires, il en fait le substratum de l’hystérie. Cette conception est reprise par Delmas et Boll (1922), Heuyer (délire de rêverie, 1922), Vinchon (1926), Dide (1935), mais critiquée par l’école de Charcot (Janet), le courant phénoménologique (K. Schneider) et les adeptes de la notion de structure (Ey). Les paraphrénies confabulante et fantastique de Kraepelin (1913) sont rapprochées des délires d’imagination par les élèves de H. Claude (Nodet, 1937). Mais l’intuition devient un mécanisme délirant autonome (1931), tandis que Delay (1942), puis Guiraud (1956) différencient la fabulation de la mythomanie. Le terme disparaît des classifications à partir du DSM-III (1980), l’entité de Dupré se trouvant éclatée entre les troubles délirants (à type de grandeur), les troubles factices, les personnalités antisociales, narcissique et borderline. La tendance actuelle est en revanche de différencier le mensonge pathologique des troubles délirants, du syndrome de Ganser et de la confabulation (presbyophrénie ou syndrome de Korsakoff). Ses liens avec la personnalité histrionique restent par ailleurs controversés. © 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Abstract During the l9th century, morbid lying and imaginative exuberance are pointed out in several forms of the mental alienation: Intellectual monomania (Esquirol, 1819), hereditary madness (Morel, 1860), megalomania (Dagonet, 1862 and 1876), grandiose delusion (Foville, 1871) — with ideas of filiation — and over all hysterical madness (J. Falret, 1866; Lasègue, 1881). Several historical personages reincarnated (false Joan of Arc, false Louis XVII) have likely suffered from these disorders. For the first time in Germany, Delbrück isolates an autonomous form of pathological lying that he calls “pseudologia fantastica” (1891). The French alienist E. Dupré (1862-1921) describes in 1905 the mythomania and its three forms: 1) vain (fantastic boasting, criminal autoaccusation, malingering); 2) mischievous (hoax, slanderous accusation, anonymous letters); 3) perverse (swindlers, seducers, wandering mythomania). Dating from 1910, Dupré characterizes the delusions based on “imaginative” mechanisms, with grandiose ideas, either chronic (autosuggestion, confabulation), or acute (often symptomatic of delirium, dementia, amnestic or mood disorders). In 1919, he considers mythomania as the basis of hysteria, through its “constitutional” (or “temperamental”) theory of mental disorders. These conceptions are accepted by Delmas and Boll (1922), Heuyer (“délire de rêverie”, 1922), Vinchon (1926) and Dide (1935), but criticized by the pupils of Charcot (Janet), the phenomenologists (K. Schneider) and the “structuralist” school (Ey). Kraepelin’s confabulatory and fantastic paraphrenias are compared with Dupré’s imaginative delusions by the pupils of H. Claude (Nodet, 1937). But the intuition is http://france.elsevier.com/direct/AMEPSY/ Annales Médico Psychologiques 165 (2007) 334–344 * Auteur correspondant. 0003-4487/$ - see front matter © 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. doi:10.1016/j.amp.2007.03.013 separated from the imagination as an autonomous delusional mechanism (1931), whereas Delay (1942) and then Guiraud (1956) distinguish confabulation from mythomania. Since the DSM-III (1980), the word mythomania is no more retained into psychiatric classifications. The clinical entity of Dupré is divided in delusional disorders (grandiose type), facticious disorders, antisocial, narcissistic and borderline personality disorders. On the other hand, pathological lying is nowadays differentiated from malingering, delusions, Ganser’s syndrome and confabulation. Its boundaries with histrionic personality disorder are not clear. © 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Mots clés : Constitution ; Dupré ; Fabulation ; Hystérie ; Imagination ; Mégalomanie ; Mensonge ; Paraphrénie ; Pseudologie fantastique Keywords: Confabulation; Constitution; Dupré; Hysteria; Imagination; Lying; Megalomania; Paraphrenia; Pseudologia fantastica De tout temps, les moralistes et les philosophes se sont inté- ressés au mensonge. « Le revers de la vérité a cent mille figu- res et un champ indéfini », note Montaigne dans les Essais. Tandis que La Fontaine proclame, dans « Le Statuaire et la statue de Jupiter » : « L’homme est de glace aux vérités. Il est de feu pour les mensonges. » Il n’est guère surprenant que la médecine aliéniste ait mis longtemps à présenter une vue uni- taire et synthétique d’un phénomène dont les écrivains avaient décelé le caractère multiforme et universel. Par ailleurs, depuis la critique des monomanies de J.-P. Falret, l’inclusion dans la pathologie d’une conduite sociale frappée d’ostracisme sem- blait un peu suspecte aux cliniciens. Ce n’est donc pas avant la fin du XIXe siècle que vont être isolées des formes de mensonge pathologique, d’abord par plusieurs auteurs allemands [9,34], ensuite par le Français E. Dupré, qui forge en 1905 le néologisme de mythomanie [13]. Ce terme, passé dans le langage courant sous forme d’épithète, est resté très populaire chez les psychiatres français, alors qu’il n’est pratiquement pas employé dans les travaux angloaméricains qui lui préfèrent « mensonge pathologique » ou le vocable germanique « pseudologie fantastique » (pseudo- logia phantastica ou fantastica) [12,28,31,32,51]. 1. Les mythomanes avant la mythomanie Mais des cas de menteurs manifestement pathologiques se retrouvent bien sûr antérieurement dans les annales historiques, puis dans les écrits des premiers aliénistes. Avant Dupré, c’est à l’intérieur de deux registres de la pathologie mentale qu’on recense les futurs mythomanes : d’une part, les monomanies intellectuelles et les délires ; d’autre part, l’hystérie. Il nous faut d’abord passer en revue quelques-uns des pittoresques mystificateurs des siècles passés, épinglés par les historiens. 1.1. Les mystificateurs Les cas de falsification du réel qui ont longtemps symbolisé la folie aux yeux du grand public sont ceux de personnages historiques réincarnés, sans qu’on puisse toujours déterminer si les intéressés sont des escrocs, des individus suggestibles instrumentalisés ou de véritables délirants. Sainte-Beuve notait [25] : « On ferait une liste curieuse de pseudoprétendants qui ont surpris un moment la crédulité publique et celle des nations. Depuis le faux Smerdis qu’Hérodote nous raconte, les faux Agrippa, les faux Drusus, les faux Néron rapportés par Tacite, bien des têtes ont travaillé sur ce thème émouvant d’un prince mystérieusement disparu. » Condition de son accession à un statut mythique, le person- nage réincarné est en général mort jeune, soit violemment, soit dans des conditions mystérieuses. Au cours des siècles, l’on voit ainsi se succéder les fausses Jeanne d’Arc, dont la plus célèbre, la dame des Armoises, a fait l’objet d’une thèse de Strasbourg en 1951 [33], Perkin Warbek (prétendument l’un des enfants d’Édouard IV d’Angleterre, disparu en 1483 dans la Tour de Londres), Pougatchev (se disant Pierre III de Russie et dont la révolte manqua de faire basculer l’empire de la Grande Catherine), puis les faux Louis XVII : une trentaine de cas recensés, dont huit internés dans des maisons de santé au XIXe siècle [25]. Sérieux et Capgras considèrent le plus célèbre d’entre eux, Naundorff, comme un délirant interprétatif : « Loin d’être un imposteur, il fut, semble-t-il, un interprétateur de bonne foi quand il contait la substitution au Temple et son séjour en Vendée chez un individu qu’on n’a jamais retrouvé, dans un château qu’on n’a pu situer. C’est avec la même conviction qu’il publiait plus tard sa Doctrine céleste où il exposait ses élucubrations mystiques, affirmant que Jésus-Christ n’est pas un dieu, mais un ange » [50]. Plus proche de nous, la fausse grande-duchesse Anastasia de Russie (pour l’état civil, l’Américaine Anna Anderson, morte en 1984). Plusieurs personnages historiques semblent avoir présenté des thèmes (délirants ?) de filiation. Le plus célèbre est sans doute Christophe Colomb en personne, dont P. Erlanger décrit inimitablement la genèse des idées de grandeur : « Imaginatif, il l’était essentiellement et aussi doué de cette ambition poé- tique courante chez les contemporains de la chevalerie, aux yeux desquels un arbre généalogique recelait cent mystérieuses vertus. Le fils d’un tisserand de 1453 n’aurait pas seulement trouvé la société entière dressée contre lui s’il avait prétendu faire carrière. Il n’aurait jamais eu le courage de se poser en rival de ses supérieurs, les descendants des soudards de Guil- laume le Conquérant, des pouilleux soldats de Charlemagne. uploads/s3/ l-x27-evolution-du-concept-de-mythomanie-dans-l-x27-histoire-de-la-psychiatrie.pdf
Documents similaires



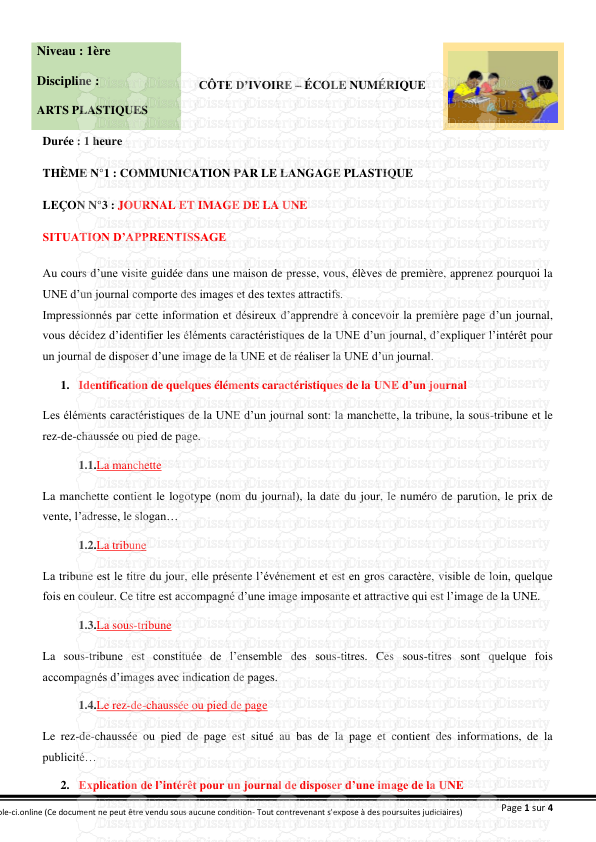
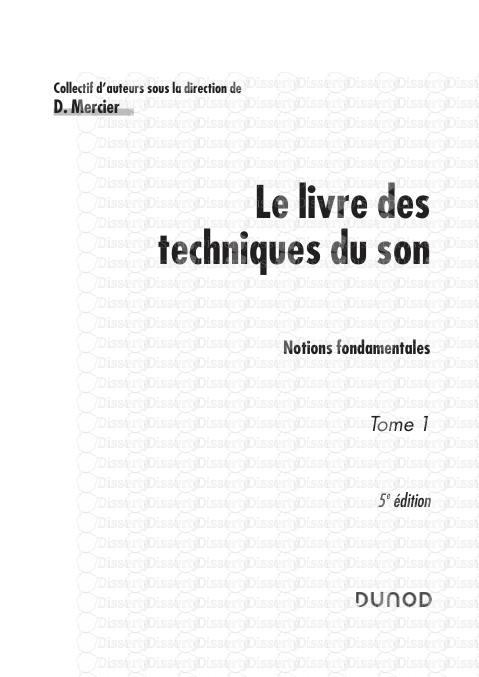





-
67
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 09, 2021
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2158MB


