Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques M 330 − 1 Aciers à outils par Robert LÉVÊQUE Ingénieur Civil des Mines Directeur Technique. Établissement d’Unieux. IRSID es aciers à outils sont utilisés, comme leur nom l’indique, dans tous les pro- blèmes de mise en forme des matériaux au sens le plus large. Il peut s’agir d’opérations d’usinage (tournage, perçage, fraisage...) de mise en forme à froid et à chaud (poinçons, matrices, cylindres de laminoirs), de moulage (alliages légers, alliages de zinc, plastiques renforcés ou non par des fibres), de filage et d’extrusion (alliages légers, plastiques...). Les aciers à outils font partie intégrante du domaine des aciers spéciaux, mais ils diffèrent sensiblement des aciers de construction mécanique, tant par les conditions de leur utilisation que par les critères d’emploi qui servent à les définir. En effet, dans le cas d’un outil de qualité, on recherche le maximum de durée, sans fixer de limite supérieure, alors que l’acier de construction mécanique doit présenter une aptitude suffisante à l’emploi avec des caractéristiques spécifiques bien déterminées comme la tenue à la fatigue, la résistance à la rupture brutale, l’aptitude à subir un cycle thermo- mécanique au cours de la mise en œuvre et l’usinabilité. 1. Composition chimique et structure.................................................... M 330 - 2 1.1 Éléments d’alliage ....................................................................................... — 2 1.2 Désignation des aciers à outils................................................................... — 6 1.3 Structure de solidification........................................................................... — 6 1.4 Structure à l’état recuit................................................................................ — 8 1.5 Structure après traitement thermique ....................................................... — 9 2. Élaboration et transformation.............................................................. — 13 2.1 Élaboration du métal liquide ...................................................................... — 13 2.2 Structure à l’état brut de coulée................................................................. — 13 2.3 Affinage de structure................................................................................... — 15 2.4 Outils moulés............................................................................................... — 17 2.5 Transformation des lingots......................................................................... — 17 2.6 Traitement de recuit .................................................................................... — 18 2.7 Contrôle des produits moulés, forgés et laminés..................................... — 18 3. Critères de mise en œuvre .................................................................... — 19 3.1 Usinage des ébauches ................................................................................ — 19 3.2 Traitement thermique.................................................................................. — 22 3.3 Aptitude à la rectification............................................................................ — 22 3.4 Traitements de surface................................................................................ — 25 4. Critères d’emploi...................................................................................... — 25 4.1 Ténacité ........................................................................................................ — 25 4.2 Dureté ........................................................................................................... — 28 4.3 Résistance à la fatigue thermique.............................................................. — 30 4.4 Résistance à l’usure..................................................................................... — 32 4.5 Tenue à la corrosion .................................................................................... — 34 5. Classification des aciers à outils......................................................... — 35 5.1 Aciers à outils non alliés pour travail à froid (classe 1)............................ — 35 5.2 Aciers à outils alliés pour travail à froid (classe 2) ................................... — 36 5.3 Aciers à outils alliés pour travail à chaud (classe 3)................................. — 40 5.4 Aciers à coupe rapide (classe 4)................................................................. — 42 Pour en savoir plus........................................................................................... Doc. M 333 L ACIERS À OUTILS ______________________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. M 330 − 2 © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques Par ailleurs, l’outil est sollicité dans la plupart des cas au niveau de sa surface qui doit supporter les contraintes les plus sévères alors que les sollicitations d’un acier de construction intéressent l’ensemble du matériau. Il en résulte que les aciers à outils ne peuvent pas être définis au moyen de lois de comportement simples et qu’il est nécessaire d’avoir une connaissance la plus précise possible des conditions de sollicitations pour apporter des critères de choix réalistes. Les solutions adoptées sont la conséquence d’une démarche essentiellement pragmatique et constituent des compromis entre des exigences souvent contradictoires. 1. Composition chimique et structure 1.1 Éléments d’alliage Lors des opérations de mise en forme, avec ou sans enlèvement de copeaux, les outils sont soumis à des sollicitations extrêmement complexes et les propriétés requises au niveau des aciers pour de tels emplois sont les suivantes : — une grande dureté, pour résister aux déformations géné- ralisées ou localisées de la surface lors du travail par enfoncement, ou par cisaillement du métal, ou par pénétration dans ce dernier pour en enlever une partie sous forme de copeaux ; suivant l’emploi auquel est destiné l’outil (travail à froid ou à chaud), on attache plus ou moins d’importance au fait que la dureté persiste lorsque l’acier est porté à température élevée ; — une bonne résistance à l’usure, c’est-à-dire la résistance à l’arra- chement de particules lors du frottement contre une autre surface ; — une absence de fragilité, notamment dans les emplois pour lesquels l’outil est soumis à des chocs fréquents ; — une bonne résistance aux chocs thermiques, surtout dans les aciers pour moules, les outillages de forge et les cylindres de lami- nage à chaud qui sont soumis à des changements de température brusques et répétés ; — une bonne trempabilité pour que la structure soit homogène sur de très grandes épaisseurs après le traitement thermique de trempe. Cette dernière propriété doit être complétée par une résis- tance convenable à la surchauffe et au grossissement du grain. Cet ensemble de caractéristiques peut être atteint si l’on ajoute à l’acier au carbone un certain nombre d’éléments d’alliage que nous allons énumérer. 1.1.1 Carbone C’est l’élément essentiel pour durcir l’acier, et la variation de la dureté HRC en fonction de la teneur en carbone d’un acier non allié après transformation martensitique est illustrée par la figure 1. Au-delà de 0,6 % de carbone, on atteint la zone des aciers à outils caractérisée par de haut niveaux de dureté et qui correspond au domaine des aciers de travail à froid et des aciers à coupe rapide. Il faut noter que l’augmentation progressive de la teneur en carbone conduit à un abaissement de la température du liquidus et du solidus et, par voie de conséquence, à une réduction des domaines de tem- pérature correspondant à la transformation à chaud et au traitement thermique. 1.1.2 Éléments carburigènes Les éléments carburigènes tels que le chrome, le tungstène, le molybdène et le vanadium, ajoutés séparément ou conjointement à l’acier au carbone, ont des influences communes sur le compor- tement de cet acier, qu’il est bon d’énumérer avant de parler des actions spécifiques de chacun de ces éléments : — difficulté de remise en solution complète des carbures lorsque les proportions de l’élément métallique et du carbone augmentent, ce qui rend difficile et même impossible l’affinage des carbures par traitement thermique ; — présence de carbures insolubles qui gênent le grossissement du grain austénitique ; — précipitation de carbures spéciaux par revenu entre 500 et 600 oC, ce qui entraîne le durcissement secondaire. 1.1.3 Vanadium Il est utilisé essentiellement comme élément générateur de carbures. C’est un élément d’alliage important dans les aciers rapides pour l’obtention d’une bonne dureté à chaud et d’une bonne résis- tance à l’usure en raison de la présence de particules très dures de carbures de vanadium dont les propriétés tribologiques sont par ailleurs très intéressantes. De petites additions, voisines de 0,2 % en masse, sont très efficaces pour éviter le grossissement du grain lors du traitement thermique. Le vanadium est rarement utilisé seul dans les aciers à outils, mais la plupart du temps en association avec le chrome, le molybdène et le tungstène. Il entraîne en effet une aug- mentation substantielle des cinétiques d’oxydation à l’air dès 600 oC et cette action est contrebalancée par l’influence bénéfique du chrome sur la résistance à l’oxydation. La teneur en vanadium est étroitement associée à la teneur en carbone. La figure 2 montre les effets combinés du vanadium et du carbone sur les propriétés de base de l’acier rapide classique à 6 % W, 5 % Mo et 4 % Cr. Comme on peut le voir sur cette figure, il n’y a qu’une bande de composition étroite en carbone et vanadium pour laquelle les propriétés des aciers sont satisfaisantes. Pour chaque 1 % de vanadium ajouté, il faut augmenter la teneur massique en carbone de 0,25 % ; des additions de vanadium trop importantes entraînent des problèmes de trempabilité, et des additions de carbone trop importantes entraînent des difficultés de forgeage. ______________________________________________________________________________________________________________________ ACIERS À OUTILS Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Matériaux métalliques M 330 − 3 Historique Les aciers à outils constituent une gamme d’aciers extrê- mement ancienne qui est probablement la première forme d’uti- lisation des métaux ferreux. C’est en effet vers 1000 ans avant J.C. que semble remonter la découverte de ces aciers grâce à la technique de la cémentation et à l’art de la trempe, qui ont été trouvés par hasard, le fer absorbant du carbone au contact des matières organiques qui servaient à le chauffer pour le marteler. Ces méthodes permettaient de produire un fer carburé dit acier naturel. Vers 350 avant J.C., on voit apparaître en Inde, et peut-être antérieurement, en Chine, le fer fondu : le fer était extrait de son minerai au moyen de fours dont le fonctionnement était voisin de celui de nos hauts-fourneaux. Le bloc spongieux obtenu était martelé pour être débarrassé de ses crasses, puis refondu dans de petits creusets que l’on laissait uploads/s3/ aciers.pdf
Documents similaires



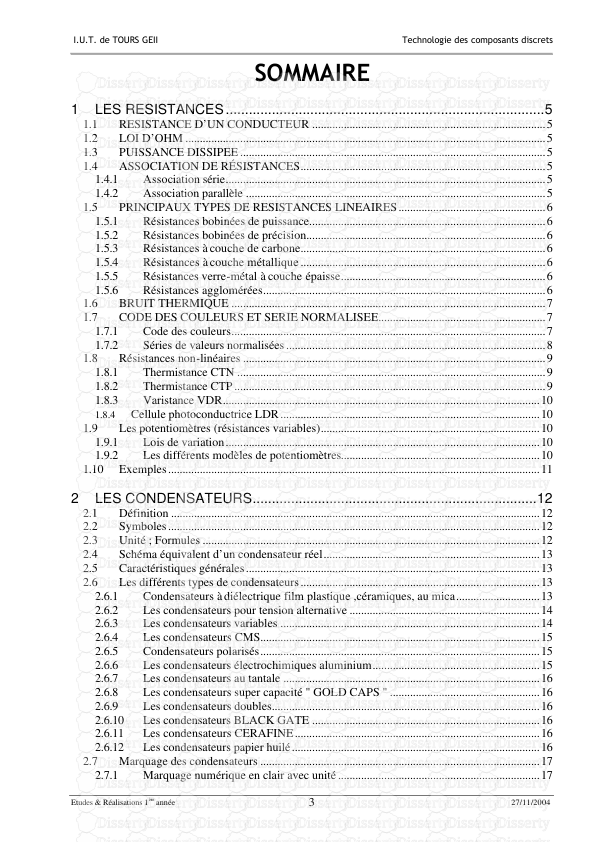






-
103
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 07, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 2.2800MB


