LES PRONOMS PLAN SI LE SUJET TOMBE SUR LES PRONOMS 1) LES PRONOMS REPRESENTANTS
LES PRONOMS PLAN SI LE SUJET TOMBE SUR LES PRONOMS 1) LES PRONOMS REPRESENTANTS (ENDOPHORIQUES) a. Les pronoms personnels i. Morphologie ii. Syntaxe iii. Sémantique b. Les pronoms démonstratifs i. Morphologie ii. Syntaxe iii. Sémantique c. Etc. 2) LES PRONOMS NON REPRESENTANTS (EXOPHORIQUES & PAR DEFAUT) a. Les pronoms personnels i. Morphologie ii. Syntaxe iii. Sémantique b. Les pronoms démonstratifs i. Morphologie ii. Syntaxe iii. Sémantique c. Etc. OU 1) LES PRONOMS REPRESENTANTS (ENDOPHORIQUES) a. Morphologie i. Les pronoms personnels ii. Les pronoms démonstratifs iii. Les pronoms relatifs iv. Etc. b. Syntaxe i. // c. Sémantique i. // 2) LES PRONOMS NON REPRESENTANTS (EXOPHORIQUES & PAR DEFAUT) a. Morphologie i. Les pronoms personnels ii. Les pronoms démonstratifs iii. Les pronoms relatifs iv. Etc. b. Syntaxe i. // c. Sémantique i. // PLAN SI LE SUJET TOMBE SUR LES PRONOMS PERSONNELS 1) LES PRONOMS PERSONNELS NON-REPRESENTANTS (P1, P1, P4 & P5) a. Morphologie b. Syntaxe c. Sémantique 2) LES PRONOMS PERSONNELS REPRESENTANTS (P3 & P6) a. Morphologie b. Syntaxe c. Sémantique 3) LES CAS PARTICULIERS a. Il impersonnel b. Pronom indéfini « on », c. Pronoms adverbiaux « en » et « y » PLAN SI LE SUJET TOMBE SUR LES DEMONSTRATIFS 1) MORPHOLOGIE a. Déterminants démonstratifs (forme simple / composée ; genre et nombre) b. Pronoms démonstratifs (forme simple / composée ; fém. / masc. ; animé / inanimé) 2) SYNTAXE a. Déterminants démonstratifs (place par rapport au nom, non supprimables ; combinables avec les déterminants secondaires) b. Pronoms démonstratifs (Sujet, COD, COI ou CC ; place dans la phrase) 3) SEMANTIQUE a. Valeurs exophoriques (ou déictique) b. Valeurs endophoriques (cataphore / anaphore) PLAN SI LE SUJET TOMBE SUR LES PRONOMS INDEFINIS 1) MORPHOLOGIE : a. Donner l’étymologie des indéfinis b. Certains distinguent le genre et d’autres pas c. Certains renvoient à de l’animé ou à de l’inanimé 2) SYNTAXE : a. Sujet b. Complément d’Objet (COI / COD) c. Attributs d. Compléments circonstanciels e. En apposition 3) SEMANTIQUE : a. Quantificateurs b. Nominaux ou représentants c. L’usage comme forclusif (ne… rien / ne… pas / etc.) INTRODUCTION • Même problématique pour tous les pronoms : le terme pronom indique « qui remplace un nom ». Il faut s’interroger sur cette notion de remplacement d’un nom, en sachant qu’un pronom peut remplacer un nom lorsqu’il est anaphorique (lorsqu’il reprend un nom qui est devant lui), lorsqu’il est cataphorique (lorsqu’il est derrière lui) : il le remplace ou l’annonce. La question devient problématique lorsque le pronom ne remplace plus le nom. • On retrouve ce cas dans 3 degrés de problématique : o Dans un rapport déictique (exophorique) Ex : Regardez-le ! (le référent de « le » n’est pas un nom présent dans le texte, mais un objet ou une personne qui se trouve dans la situation d’énonciation. o Les pronoms personnels de 1ère et de 2ème personne : Ex : Tu es venu me voir hier (le « tu » ne prend de sens que par rapport à la situation dans laquelle on se trouve) o Lorsque le pronom ne remplace vraiment rien du tout : Ex : Il était une fois (il impersonnel) Ex² : Il y a Ex3 : S’en aller • Comment va tomber la question des pronoms ? o Soit tous les pronoms o Soit une catégorie de pronoms particulière : ▪ Les démonstratifs (pronoms + déterminants) ▪ Les pronoms personnels (sujet, compléments, déplaçables ou non, etc.) ▪ Les autres peu de chance que ça tombe (trop restreint) • Notion essentielle : les pronoms NOMINAUX / les pronoms REPRESENTANTS : o PRONOM NOMINAL (EXOPHORIQUE / DEICTIQUE ou PAR DEFAUT) : il ne remplace jamais un substantif (et n’a jamais d’antécédent) : ▪ Déictique : Il ne peut pas être remplacé par un nom (Je / Tu) : Ex : Je mange du pain. ▪ Il est général, pas besoin de connaître le référent remplacé : Ex : Aujourd’hui, personne ne joue plus collectif. (personne = aucun individu) o PRONOM REPRESENTANT (ENDOPHORIQUE) : il remplace un nom qu’il représente : Ex : Pierre est arrivé lundi. Il était malade (« Il » remplace « Pierre ».) • Classe syntaxiquement homogène mais sémantiquement et morphologiquement très hétérogène. Marc Wilmet remarque que la dénomination même des pronoms est problématique car : o « Personnel » est une dénomination morpho-syntaxique, o « Possessif, démonstratif » est sémantique, o « Relatif » est fonctionnel, o « interrogatif « est mélodique. Morphologie • Toutes les formes de pronoms sont issues du latin • Ils varient morphologiquement en formes simple (nous) et complexe (quelqu’un, celui-ci) et à l’intérieur d’une même série (Je, j’, me, moi) • Si certains varient en genre, d’autres non (il/elle mais rien) • Certains apparaissent dans des types de phrases : pronom interrogatif ou exclamatif • Certains marquent la subordination comme les pronoms relatifs • Certaines formes mixtes viennent se rajouter aux PP (les pronoms adverbiaux, en et y, le pronom indéfini on et le pronom impersonnel « il »). Syntaxe • Ils ne sont pas forcément l’équivalent d’un nom dans la mesure où ils peuvent remplacer d’autres catégories grammaticales : o Un nom avec déterminant Ex : Les réponses sont toutes arrivées sauf celle de Jean. o Tout un GN Ex : J’ai acheté de la crème solaire, il n’avait pas la sienne o Un adjectif Ex : Il est mécontent, je le suis aussi o Un groupe prépositionnel Ex : Je vais à la campagne, j’y vais aussi o Une proposition Ex : Pierre nous aidera, c’est certain • Comme le nom, ils peuvent avoir des fonctions différentes. Sémantique • Pellat les appelle symboles incomplets tout simplement parce que le sens est codé et le pronom comporte des instructions qui permettent à l’interprétant d’identifier à quoi se réfère le pronom : o Référence déictique : le référent est identifiable à partir de la situation d’énonciation : Ex : Je, mais aussi « Il » dans « Il se noie ! » o Référence anaphorique par le contexte qui peut être très variable : ▪ Reprise du même référent : Ex : Pierre est venu, il m’a dit […] ▪ Reprise du signifié seulement : Ex : La voiture du directeur est confortable mais celles de ses adjoints sont plus rapides. ▪ Anaphore indirecte lorsque la valeur référentielle est construite par inférence à partir d’informations sélectionnées dans le contexte ou bien un savoir commun : Ex : Dans le Midi il fait beau, ils ont de la chance (les gens qui habitent dans le Midi) o Référence par défaut : interprétation générique lorsque rien dans le contexte ne permet d’identification : Ex : Chacun pour soi. • A l’exception des pronoms Je et Tu qui sont des déictiques purs, les autres peuvent être à la fois déictiques et anaphoriques suivant leur emploi. 1. LES PRONOMS PERSONNELS • Description de la catégorie : o Contrairement au latin qui identifie la personne par les désinences verbales, en français, les formes sujets assurent la distinction de personne alors que les formes verbales sont souvent indistinctes. o Dans les langues qui différencient les désinences, on n’a pas besoin de pronom personnel (italien, espagnol VS anglais, français) o Ils portent le nom de personnels parce qu’ils fonctionnent comme des indicateurs de rang pour distinguer les six personnes. o On trouve à la fois des PP sujets et des PP compléments, les uns et les autres ayant des fonctions grammaticales distinctes. • Problématiques : o La dénomination de pronom personnel. ▪ Pourtant, si le terme est adéquat pour désigner les personnes 1, 2, 4, 5, il l’est moins pour la personne 3 et la personne 6, qui désignent une personne hors de l’interlocution et qui sert aussi à désigner une chose. ▪ Le pronom il/elle sera exclusivement représentant alors que les autres sont totalement ou partiellement nominaux o Classe hétérogène : ▪ Morphologiquement : il s’agit d’une classe hétérogène parce qu’elle comporte des pronoms qui sont toujours sujets et d’autres compléments et à l’intérieur de ces compléments des pronoms toniques, atones, prédicatifs ou non prédicatifs, disjoints, conjoints, clitiques, non clitiques. ▪ Syntaxiquement : les pronoms clitiques ne peuvent être séparés du verbe que par le discordantiel ne et un ou deux clitiques compléments (ex : Je ne leur en ai pas parlé). Les pronoms personnels sujets ne peuvent être coordonnés. Ils partagent cependant un ensemble de propriétés morpho-syntaxique : les fonctions. ▪ Sémantiquement. Ils se partagent entre : • Déictiques / exophoriques qui se réfèrent à la situation d’énonciation et ne sont pas remplaçables par un nom et jouent le rôle de nom, d’où leur appellation de nominaux. Ils ont la valeur d’un nom propre. • Endophoriques (anaphoriques ou cataphoriques) qui sont représentants • Annonce du plan : o Comme d’habitude, il faut faire apparaître la morphologie (paradigme du pronom concerné, origine étymologique, formes diverses de ce pronom, etc.), la syntaxe (fonction grammaticale et place de ce pronom) et la sémantique (est-ce qu’il est endophorique ou exophorique ? Est-ce qu’il représente quelque chose uploads/s3/ 1-2-les-pronoms.pdf
Documents similaires





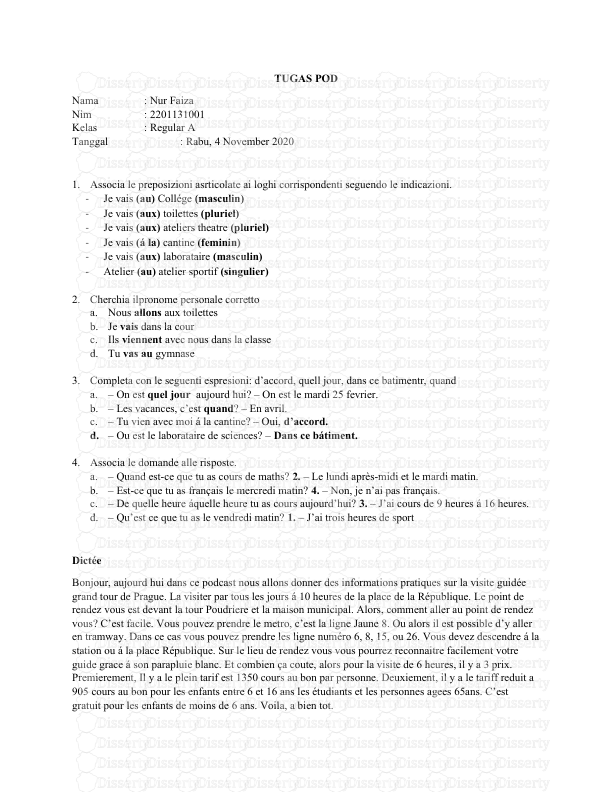




-
65
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 18, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.5445MB


