Le Recentrage pornographique J’aimerais vous exposer le contexte artistique dan
Le Recentrage pornographique J’aimerais vous exposer le contexte artistique dans lequel s’inscrivent Nana (1879) et et La Fille Elisa (1877), celui d’un double recentrage : thématique et artistique. Le premier concerne l’âge d’or de la prostitution, période de l’histoire -située dans la IIIème République, entre l’Ordre moral et la Belle Epoque- voyant l’apogée de la demande et de l’offre de corps féminins, voyant l’ascension sociale des prostituées par l’argent et voyant l’aura des bordels faire vaciller celle des églises. Ce recentrage thématique gagne les débats scientifiques, les préoccupations socio-économiques et les inspirations artistiques. Artistiquement, justement, c’est l’éloquence majestueuse des romantiques, le beau idéal des classiques et la vision éthique de l’art qui se brisent sur la volonté “moderne” (au sens de Georges Bataille) de ne plus rien représenter, mais au contraire, de simplement présenter une réalité quotidienne, dans l’indifférence à la hiérarchisation des valeurs, et dans la nudité de tous jugements. Ainsi, le recentrage pornographique symbolise le nouage de l’arrivée de la prostituée comme archétype de la féminité et de l’arrivée de la quotidienneté comme archétype de la modernité. Apparu sous la plume de Restif de la Bretonne, en 1769 (!), le terme de “pornographie” est composé des deux mots grecs : “graphein” et “porneia”. “Graphein” est un verbe à entendre au sens large de “tracer”, caractéristique première de tous les arts (par ex., la “photographie” trace la lumière). “Porneia” est un nom signifiant “prostitution” en un sens bien précis : au-delà du sens étymologique (‘prostituere’ = ‘exposer publiquement’) -traduit par Baudelaire dans ses Fusées par la phrase “Qu’est-ce que l’Art ? Prostitution !”-, “porneia” désigne l’exposition du corps féminin dans les maisons closes (‘porneion’), davantage que l’exposition publique des courtisanes (‘hetairai’). Ainsi, la pornographie trace la prostitution des ‘pornai’ (prostituées de maisons closes) comme mise-en-oeuvre publique de l’obscène (‘ob-scenus’, c’est ce qui est hors-scène, échappant au regard traditionnel). Mais rappelons aussi, premièrement que ‘porneia’ est traduit bibliquement par ‘culte de la luxure et des idoles’, et deuxièmement, que le nom sous-entend l’échange monétarisé du corps féminin contre la richesse symbolique de l’homme (traduction du terme grec ‘pernemi’). Donc, le recentrage pornographique dans lequel Zola et les Goncourt, passionnés d’histoire et éminents critiques d’art, se situent est la dynamique moderne -initiée par le réalisme et le naturalisme- qui consiste à mettre en oeuvre l’obscénité mythologique de la prostitution comme symbole de la présentation publique propre à la quotidienneté moderne de la féminité. I La modernité artistique de l’époque II L’ancrage pictural de Nana III La variété esthétique de La Fille Elisa I. La modernité artistique de l’époque - La Femme caressant un perroquet (Eugène Delacroix, 1827 : romantisme) vs. La Femme au perroquet (Gustave Courbet, 1866 : réalisme) mais aussi La Femme aux bas blancs (E. Delacroix, 1825) vs. Femme nue couchée (G. Courbet, 1862) et juste avant, La Femme aux bas blancs (1861, angle de vue par la fente) Le déshabillé, les ouvertures (décroisés et poses) et les visages font la différence. - Art moderne, de 1853 à 1907 : du réalisme à l’impressionnisme, recentrage pornographique passant par les tassements, les ouvertures (fentes, en particulier) et les nouages. - Gustave Courbet : Les Baigneuses (1853) et Les Demoiselles des bords de la Seine (1856) : réalisme Dans Le Peintre de la vie moderne, Baudelaire parle des “rondeurs de l’adiposité, cette hideuse santé de la fainéantise” : nous reconnaissons là un topos naturaliste, basé notamment sur les travaux de Parent-Duchatelet. Ces corps sont en effet épais, alanguis, mais surtout, vautrés, dans un relâchement absolu, un laisser-aller jouissif. Chez Courbet, le relâchement est à la fois morphologique et dynamique. Cela provoque une esthétique du tassement ou de l’étalement, y compris celui des tissus pourtant précieux, gisants. Cette affalement des courtisanes provoque ce que Pernoud appelle une “apparence flottante”, c’est- à-dire une déhiérarchisation, une indétermination du statut social, et, une in différence aux conventions, propre à l’art moderne. Le Bordel en peinture (Emmanuel PERNOUD) “Les types étaient vrais, sans être vulgaires; les chairs, fermes et souples, vivaient puissamment; les fonds s'emplissaient d'air et donnaient aux figures une vigueur étonnante. La coloration, un peu sourde, a une harmonie presque douce, tandis que la justesse des tons et l'ampleur du métier établissent les plans et font que chaque détail a un relief étrange. En fermant les yeux, je revois ces toiles énergiques, d'une seule masse, bâties à chaux et à sable, réelles jusqu'à la vérité. Courbet appartient à la famille des faiseurs de chair” (“Les Chutes”, article d’E. Zola, paru dans L'Evénement, le 15 mai 1866) Aurélien MARION - 3ème année - Edouard Manet : Olympia (1863) : réalisme “La force de ce nu ne vient pas de qu’il est provocant, sale ou malade, comme le soutiennent ses détracteurs, mais de ce qu’il est tout court” “En 1865, Edouard Manet est encore reçu au Salon; il expose un Christ insulté par les soldats et son chef-d'oeuvre, son Olympia. J'ai dit chef-d'oeuvre, et je ne retire pas le mot. Je prétends que cette toile est véritablement la chair et le sang du peintre. Elle le contient tout entier et ne contient que lui. Elle restera comme l'oeuvre caractéristique de son talent, comme la marque la plus haute de sa puissance. J'ai lu en elle la personnalité d'Edouard Manet, et lorsque j'ai analysé le tempérament de l'artiste, j'avais uniquement devant les yeux cette toile qui renferme toutes les autres. Nous avons ici, comme disent les amuseurs publics, une gravure d'Epinal. Olympia, couchée sur des linges blancs, fait une grande tache pâle sur le fond noir ; dans ce fond noir se trouve la tête de la négresse qui apporte un bouquet et ce fameux chat qui a tant égayé le public. Au premier regard, on ne distingue ainsi que deux teintes dans le tableau, deux teintes violentes, s'enlevant l'une sur l'autre. D'ailleurs, les détails ont disparu. Regardez la tête de la jeune fille : les lèvres sont deux minces lignes roses, les yeux se réduisent à quelques traits noirs. Voyez maintenant le bouquet, et de près, je vous prie : des plaques roses, des plaques bleues, des plaques vertes. Tout se simplifie, et si vous voulez reconstruire la réalité, il faut que vous reculiez de quelques pas. Alors il arrive une étrange histoire : chaque objet se met à son plan, la tête d'Olympia se détache du fond avec un relief saisissant, le bouquet devient une merveille d'éclat et de fraîcheur. La justesse de l'oeil et la simplicité de la main ont fait ce miracle; le peintre a procédé comme la nature procède elle-même, par masses claires, par larges pans de lumière, et son oeuvre a l'aspect un peu rude et austère de la nature. Il y a d'ailleurs des partis pris; l'art ne vit que de fanatisme. Et ces partis pris sont justement cette sécheresse élégante, cette violence des transitions que j'ai signalées. C'est l'accent personnel, la saveur particulière de l'oeuvre. Rien n'est d'une finesse plus exquise que les tons pâles des linges blancs différents sur lesquels Olympia est couchée. Il y a, dans la juxtaposition de ces blancs, une immense difficulté vaincue. Le corps lui-même de l'enfant a des pâleurs charmantes; c'est une jeune fille de seize ans, sans doute un modèle qu'Edouard Manet a tranquillement copié tel qu'il était. Et tout le monde a crié : on a trouvé ce corps nu indécent; cela devait être, puisque c'est là de la chair, une fille que l'artiste a jetée sur la toile dans sa nudité jeune et déjà fanée. Lorsque nos artistes nous donnent des Vénus, ils corrigent la nature, ils mentent. Edouard Manet s'est demandé pourquoi mentir, pourquoi ne pas dire la vérité; il nous a fait connaître Olympia, cette fille de nos jours, que vous rencontrez sur les trottoirs et qui serre ses maigres épaules dans un mince châle de laine déteinte. Le public, comme toujours, s'est bien gardé de comprendre ce que voulait le peintre ; il y a eu des gens qui ont cherché un sens philosophique dans le tableau; d'autres, plus égrillards, n'auraient pas été fâchés d'y découvrir une intention obscène. Eh ! dites-leur donc tout haut, cher maître, que vous n'êtes point ce qu'ils pensent, qu'un tableau pour vous est un simple prétexte à analyse. Il vous fallait une femme nue, et vous avez choisi Olympia, la première venue; il vous fallait des taches claires et lumineuses, et vous avez mis un bouquet; il vous fallait des taches noires, et vous avez placé dans un coin une négresse et un chat. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? vous ne le savez guère, ni moi non plus. Mais je sais, moi, que vous avez admirablement réussi à faire une oeuvre de peintre, de grand peintre, je veux dire à traduire énergiquement et dans un langage particulier les vérités de la lumière et de l'ombre, les réalités des objets et des créatures.” (E. Zola, Edouard Manet. Etude biographique et critique, 1867) Pour Bataille, la “souveraineté désigne «le mouvement de violence libre et intérieurement déchirant qui anime la totalité, se uploads/s3/ 04-le-recentrage-pornographique 1 .pdf
Documents similaires









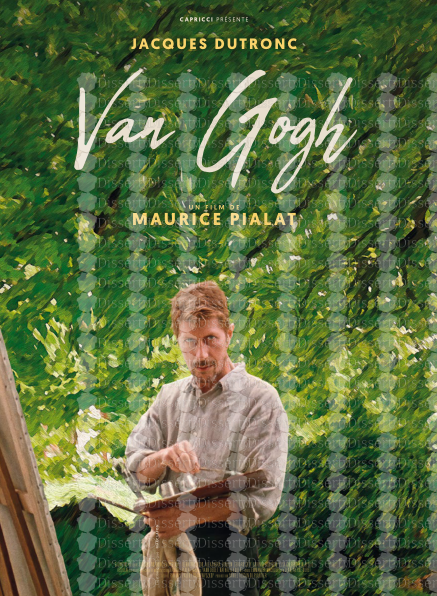
-
95
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 02, 2022
- Catégorie Creative Arts / Ar...
- Langue French
- Taille du fichier 0.1962MB


