/^.^ ESSAI SUR LA RHÉTORIQUE GRECQUE AVANT ARISTOTE i ESSAI SUR LA RHÉTORIQUE G
/^.^ ESSAI SUR LA RHÉTORIQUE GRECQUE AVANT ARISTOTE i ESSAI SUR LA RHÉTORIQUE GRECQUE AVANT ARISTOTE Octave NAVARRE DOr.TKUR es LETTRES Maître de Conléreiiccs de Langue et Littérature grecques à la i-'acullc des Lettres de l'Lniversité de Toulouse. PARIS LIBRAIRIE HACHETTE ET C*' 79 , BOULEVARD SAINT-GERMAIN , 79 1900 pft a/3 M. Alfred CROISET Membre de l'Institut, ioyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Paris, Professeur d'Éloquence grecque. Hommage de respectueuse recon7taissaJice, O. N. PREFACE Il ne manque pas, à l'étranger ni en France, de bons livres sur la rhétorique grecque. Le pre- mier en date, comme en importance, est la ïuvxywtï; T£/vû)v de Leonhard Spengel, Slullgard, i8mH, à côté de laquelle on doit citer encore Die Jihc- torik der Grieclien iind Homer de R. Volk- mann, Leipzig, 2" édition, 187^, et La Rhétorique, et son /tisloh'e par A. Ghaignet, Paris, 1888. En- fin il y a beaucoup à puiser dans les quatre volu- mes du beau livre de M. F. Blass, /Jie nftisr/ie JJeredsamheit, Leipzig, 18G8-77 '. Malgré la valeur et le nombre de ces travaux*, je n'ai pas cru que 1. Il a paru depuis une seconde édition, 2. Parmi les travaux anciens il faut encore nommer, 'pour mé- moire ; Cressolius, Theatrum rhelorum , oralorum, etc. (dans le Thesaur. graec. antiquit. de Gronovius, t. X) — Hardion, Dissertation sur l'orig. et les progrès de la. rhétorique en Grèce (dans les Mém. de l'Acad. dett Inscript., t. IX, Xlll, XV, XVI, XIX, XXI). — Je nommerais en outre, et au tout premier rang, la belle Élude sur la rhétorique d'.iristole d'Ern. Havet (Paris, 184(5), si Aristote n'était eu dehors do mon sujet. cet i^ssai sur la rliéloi'i(/ue (jrecque avant Aris- tote fut iniilile. Il faul dire pourquoi. Esl-il besoin de montrer d'abord que mon Es- sai ne fera pas double emploi avec les livres de MM. Volkmann et Ghaig-net? Ces deux savants décrivent la rhétorique en son état d'achèvement, au moment où elle offre un système complet et dé- finitif. Mon dessein, au contraire, a été de suivre le développement prog-ressif de cet art, et cela du- rant une période limitée, depuis les débuts jus- qu'à Aristote. En un mol, tandis que l'exposé de MM. Volkmann et Chaignet est dog-matique, le mien sera surtout historique. Quant à l'ouvrag-e de M. Blass, il traite spécialement de l'éloquence, non de la rhétorique g-recque, et par conséquent ne touche qu'accessoirement à mon sujet*. Seul Leonh. Speng-el s'était déjà placé au point de vue qui est le mien^. Reprenant le sujet et le titre même de la Somme, aujourd'hui perdue, où Aris- tote avait condensé toute la substance des rhétori- ques antérieures', il s'est efforcé, dans la mesure 1. Cela est vrai également des ouvrages suivants, que j'ai con- sultés à l'occasion : G. Perrot, L'Éloquence judiciaire à Athènes, 1873; J. Girard, Études sur Véloquence atlique, 1874; Jebb, The atlic orators from Anliphon to Isaeos, 2* éd., 1893. — Les histoires générales de la littt'rature grecque (et en particulier le IVe vol. de celle de MM. Alf. et Maur. Groiset) m'ont fourni aussi d'utiles indications. 2. La thèse de Gh. Benoist, Essai historique sur les premiers manuels d'invention oratoire, 1846, n'ajoute rien de nouveau aux recherches de Spengel. 3. Voyez plus bas, p. 211. XI du possible, de réparer celle perle. Tâche difficile, où Spengel a déployé les ressources d'un savoir 1res vasle, très iuvenlif el 1res sur. Bien rares sont les Iravaux d'érudilion qui, comme le sien, car- dent encore, soixanle-dix ans après leur publica- tion, toute leur valeur. On nue demandera sans doute pourquoi, dans ces conditions, j'entreprends de le refaire. En réalité, il ne s'ajs^-it pas de le refaire, mais de le compléter et de l'enrichir. Les seules sources ovi Spen','-el ail puisé sont : i" les reliifuiae des rhéteurs anté- rieurs à Aristote ; 2" les témoignages anciens rela- tifs à ces rhéteurs. Ce sont, sans contredit, les plus sures; mais en revanche combien ce qu'on en peut tirer est misérable. En faul-il d'autre preuve que la sécheresse même et les lacunes de l'exposé de Spengel? La nouveauté de mon livre résidera surtout dans l'emploi continu et systématique de deux autres groupes de documents, savoir : la collection des plaidoyers attiques, et toute la série des traités de rhétorique postérieurs à Aristote. Parlons d'abord du premier groupe. La plupart des logographes athéniens, entre autres Antiphon, Lysias, Isocrate, Isée (et proba- blement aussi Démosthène) ont été en même temps maîtres de rhétorique. C'est là une rencon- tre qui n'est pas sans conséquence i)our l'objet de notre étude. Il suit de là, en effet, que chez ces écrivains pratique el théorie étaient étroitement liées : ce sont, si je puis dire, les deux faces d'un môme tissu. L'endroit, ce sont les plaidoyers des Xll log-ographes; Venvers, les règles théoriques qu'ils enseignaient. Restituer celles-ci à l'aide de ceux- là est une opération légitime : d'autant plus légi- time que nous ne ferons ainsi que l'inverse, et, en quelque sorte, la contre-épreuve de ce que faisaient eux-mêmes les rhéteurs logographes, lorsqu'ils lisaient dans l'école, à titre de démonstration con- crète et de justification de leurs théories, les plai- doyers qu'ils avaient composés pour des causes réelles', .l'ai donc usé de cette méthode très large- ment ; elle m'a permis, en particulier, de recons- truire à grands traits la rhétorique de Gorgias, celle d'Antiphon, celle d'isocrate. L'étude des traités postclassiques ne m'a pas été moins utile. Nul doute, en effet, que tout l'es- sentiel de la rhétorique des cinquième et qua- trième siècles avant Jésus-Christ ne s'y soit trans- mis. Nous avons sur plusieurs points particuliers la preuve frappante de celte fidélité de tradition. J'en citerai deux exemples. Les rhéteurs de Rome et de Ryzance enseignent unanimement que la fonction de l'exorde est triple : rendre l'auditeur docile, ^attentif et bienveillant. Ne serait-on pas tenté de croire, au premier abord, que c'est là une formule toute récente et de leur invention? Or Aristote la critique déjà^ De même pour la nar- ration : vous lirez chez les mêmes rhéteurs que cette partie du discours exige trois qualités essen- tielles : brièveté, clarté et persuasion. Or Quinti- 1. Voy. p. 151. 2. P. 213. XllI — lien nous apprend que celte Iriple prescriplion remonte à Isocrate'. Mais il ne suffirait pas de constater qu'il y a dans les traités de basse époque des parties primitives. Où trouverons-nous le cri- lériuni nécessaire jjour les reconnaître, pour sé- parer de l'ivraie le bon grain? Voici la règle prin- cipale que j'ai suivie. Lorsque tel ou tel précepte de la rhétorique classique, qui nous est parvenu isolément, se répète dans les traités plus récents, et y fait partie intégrante d'un corps de doctrine qui lui donne tout son sens, je me suis cru en droit d'attribuer à la doctrine entière une date aussi reculée qu'à ce précepte lui-môme. Il va de soi que, si cette coïncidence s'étend à deux ou plu- sieurs détails, le critérium gagne encore en va- leur. Far ce moyen j'ai restitué presque dans leur intégrité plusieurs chapitres de la rhétorique grec- (jue, telle (ju'on l'enseignait au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Reprenons pour exemple le chapitre de la narration. Chez Quintilien, aussi bien que dans le de Inventione de Gicéron ou dans la Rhétorique à Hérenniiis , l'énoncé des trois (jualités nécessaires à la narration est suivi d'une longue liste de moyens — moyens d'être bref, d'être clair, d'être persuasif— sans lesquels cette théorie resterait en effet vaine et dépourvue d'in- térêt pratique. N'ai-je pas eu raison dès lors d'ad- mettre qu'il y avait déjà dans les manuels anté- rieurs à Aristote des listes de ce genre*? 1. P. 245. 2. P. 246-251. XIV On voit assez par ces brèves observations quel précieux parti on peut tirer des deux sources indi- rectes nég-ligées par Speng-el. Je suis le premier à reconnaître qu'elles sont d'un usage très délicat, périlleux même. Il y faudrait infiniment de pru- dence, de tact, de sag-acité. En quelle mesure ai-je réussi? C'est au lecteur d'en juger. 11 ne me reste plus qu'à dire un mot du plan de cet ouvrage. Il comprend deux parties. Dans l'une j'ai essayé de retracer le développement de la rhé- torique, et spécialement de la rhétorique judiciaire chez les Grecs depuis les origines jusqu'à Aris- tote'. On m'y reprocherait à bon droit plus d'une lacune*, si je ne prévenais immédiatement que mon ambition n'a pas été d'écrire une histoire complète et continue de la période que je viens d'indiquer, mais simplement d'éclaircir quelques- i. En me bornant presque à la rhétorique judiciaire, je n'ai fait que suivre l'exemple même des anciens rhéteurs qui traitaient de ce genre avec une prédilection marquée et pour ainsi dire à l'ex- clusion des deux autres (Aristote, Rhélor., I, 1; Isocrate, So- phisl., 19). Le fait s'explique aisément, du reste. Le genre judi- ciaire était celui qui intéressait le plus grand nombre de person- nes. De plus, il présente des conditions fixes, grâce auxquelles il était relativement uploads/s1/essai-sur-la-rhetorique-grecque-avant-aristote-navarre-pdf.pdf
Documents similaires









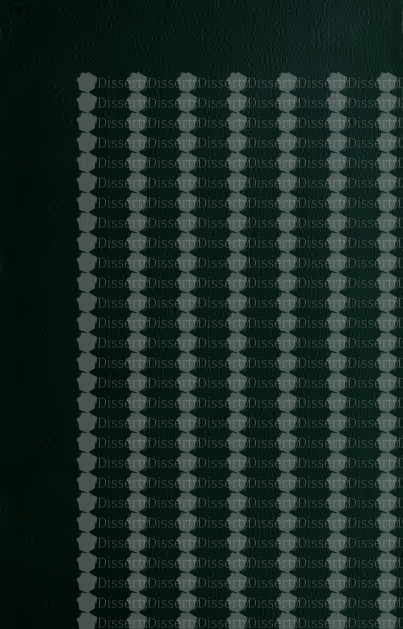
-
47
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 31, 2022
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 10.9861MB


