LA PROCEDURE D'ELABORATION DES ACTES ADMINISTRATIFS * EN DROIT FRANÇAIS par M.
LA PROCEDURE D'ELABORATION DES ACTES ADMINISTRATIFS * EN DROIT FRANÇAIS par M. RAYMOND ODENT Les règles qui régissent la procédure d'élaboration des actes administratifs n'ont été dégagées que très progressivement par le droit public français: elles n'ont jamais été codifiées. Il existe néanmoins sur ce point un corps de doctrine très solide mais assez complexe: il s'est constitué, d'une part, par la généralisation de disposi- tions contenues dans le droit écrit et dont l'application introduite presque par accident dans une législation particulière, a été peu à peu étendue à l'ensemble de la législation et, d'autre part, par l'effort jurisprudentiel qui a dégagé des principes dont le Conseil d'Etat impose le respect à l'action administrative. La plupart de ces règles furent à l'origine destinées à protéger l'admini- stration contre elle même: ainsi les avis qui doivent être recueillis avant de prendre une décision garantissent la valeur de la solution finale après que tous les aspects d'un problème auront été examinés. Mais certaines formalités ont des vertus propres et procurent aussi des garanties aux intérêts légitimes des administrés: c'est le cas des droits de la défense. Encore faut-il qu'un formalisme tatillon n'entrave pas le fonction- nement normal des services publics et ne nuise pas à leur efficacité. C'est le rôle du juge administratif, par référence notamment à la théorie dite des « for- malités substantielles », d'obtenir un équilibre entre ces exigences contradictoires. Les pages suivantes préciseront où en est le Conseil d'Etat dans la recherche de cet équilibre, toujours discutable, à propos de l'élaboration des actes ad- ministratifs. I. - LES ENQUÊTES ET AVIS PRÉALABLES. Les consultations préalables jouent un rôle de plus en plus important dans l'administration moderne. Ce phéno- mène bien connu a des causes à la fois politiques et techniques; il traduit le souci d'associer plus largement les administrés au fonctionnement de l'admi- nistration; il se développe surtout dans le domaine économique et social, où les interventions de la puissance publique se multiplient; la consultation des intéressés, des usagers, des professionels, doit permettre en effet aux autorités administratives de prendre des décisions à la fois mieux étudiées et mieux ac- cueillies. La consultation peut prendre deux formes : l'enquête publique et la demande d'avis. Dans la procédure d'enquête, le projet de décision est rendu public, et tous les intéressés ont la possibilité d'en prendre connaissance et de formuler leur opinion. La demande d'avis est au contraire adressée à une personne ou à un organisme déterminés, qui sont chargés de se prononcer sur un plan technique, ou qui ont la mission de représenter l'opinion des différentes ca- (*) Rapport présenté par M. Raymond ODENT, président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, assisté par MM. FOURNIER et BRAIBANT, Mme QUESTIAUX, MM. GALMOT et MASSOT, au Colloque des Conseils d'Etat français et italien (Paris 12-14 Décembre 1966). 91 tégories d'intéressés. C'est surtout cette dernière forme de consultation qui tend aujourd'hui à se développer dans l'administration française. En l'absence d'un code général de procédure administrative, le régime ju- ridique de ces consultations préalables doit être recherché à la fois dans des textes particuliers, tels que la loi sur l'expropriation ou le statut des fonction- naires, et dans la jurisprudence du Conseil d'Etat. Les textes instituent les procédures et règlent avec une précision variable leurs modalités. Le juge, de son côté, a établi, à l'occasion des litiges dont il est saisi, un corps de règles générales qui s'appliquent à tous les textes, soit pour interpréter leurs dispo- sitions, soit pour combler leurs lacunes. Dans l'élaboration de cette jurisprudence, le Conseil d'Etat s'efforce de con- cilier deux impératifs: d'une part, il veille à ce que la loi ne reste pas lettre morte, et à ce que les garanties qu'elle a instituées pour la protection des citoyens ou dans l'intérêt d'une bonne administration soient appliquées; mais d'autre part, il se préoccupe d'éviter que l'accumulation des consultations pré- alables ait pour effet de paralyser la puissance publique, et qu'un formalisme exagéré entraîne trop souvent l'annulation de mesures opportunes et justifiées. Les consultations préalables sont soumises par la jurisprudence à deux théories générales du formalisme administratif. Il s'agit, en premier lieu, de la notion de formalités substantielles, qui permet de faire une distinction entre les garanties essentielles, qui doivent toujours être respectées, et les règles mineu- res, dont la violation ne motivera l'annulation de l'acte qu'en fonction des circon- stances de l'affaire: par exemple, la publicité de l'enquête appartient à la première catégorie, et sa durée à la seconde. Il s'agit, d'autre part, de la théorie des formalités impossibles, qui est la transposition de la notion de force ma- jeure dans le domaine de la procédure administrative: l'acte n'est pas irré- gulier si la formalité prévue par les textes n'a pu être accomplie pour un motif indépendant de la volonté de l'administration, par exemple si l'organis- me qui devait être consulté à refusé de donner son avis. Outre l'application de ces théories générales, le Conseil d'Etat a formulé un certain nombre de règles propres aux consultations préalables, qui ont trait à l'obligation de consulter, aux modalités de la consultation, et à ses effets juridiques. 1. - L'obligation de consulter. — Dès lors qu'ils sont prévus par un texte législatif ou réglementaire, les enquêtes ou avis sont obligatoires; leur omis- sion constitue une cause de nullité de l'acte; en d'autres termes, la consulta- tion elle-même a toujours le caractère d'une formalité substantielle. C'est seu- lement dans le cas où, pour un motif quelconque, la consultation s'est avérée impossible, que son défaut n'entache pas la régularité de la décision. En dehors des cas expressément inscrits par les textes, le Conseil d'Etat a décidé, par application de la règle du parallélisme des formes, que les consul- tations prévues pour l'intervention d'une décision s'imposent également pour son retrait ou son abrogation, à moins que le texte n'ait édicté une procédure spéciale; ce principe ne joue d'ailleurs que si la consultation initiale était obli- gatoire. Il arrive en effet qu'une autorité administrative procède à des consulta- tions de son plein gré, sans y être obligée : elle peut prendre l'avis d'une autre autorité, ou utiliser une procédure déjà existante et prévue pour d'autres af- faires, ou enfin créer de toutes pièces une procédure ad hoc pour une affaire déterminée. La jurisprudence du Conseil d'Etat admet en principe la validité de ces procédés; toutefois, elle lui a assigné certaines limites: l'administration n'a le droit ni de substituer une procédure spéciale à la procédure normale, 92 ni d'ajouter à celle-ci une consultation supplémentaire qui aurait pour effet d'affaiblir ou d'altérer les garanties données aux intéressés par la loi; par exemple, elle ne peut doubler la consultation d'un conseil de discipline par celle d'un jury d'honneur spécialement composé pour une affaire; de même elle ne peut limiter la portée de la consultation des commissions paritaires d'avancement en instituant un système de concours préalables. Telles sont les règles essentielles dégagées par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le principe même de la consultation. 2. - Les modalités de la consultation. — Les consultations préalables com- portent souvent la mise en oeuvre des règles générales relatives aux droits de la défense et à la procédure des organismes collégiaux; il est en effet fréquent que l'avis porte sur une affaire disciplinaire, ou qu'il soit demandé à une commission. Ces questions étant examinées par ailleurs, nous nous bornerons ici à indiquer la jurisprudence propre aux procédures consultatives; cette juri- sprudence, qui a pour objet d'assurer la loyauté et l'efficacité des consulta- tions, concerne leur ouverture, leur déroulement et l'utilisation de leurs ré- sultats. a) En premier lieu, l'administration doit informer complètement les per- sonnes dont la consultation est obligatoire. Pour les enquêtes, le juge veille d'une part à ce que leur publicité soit correctement assurée, par exemple par voie d'insertion dans la presse locale et d'affichage en mairie, et d'autre part à ce que le dossier mis à la disposition des intéressés comprenne tous les ren- seignements nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause. Quant aux organismes consultatifs, ils doivent être en possession des éléments d'information que détient l'administration, et ils doivent être saisis de toutes les questions qui seront réglées par la décision à intervenir. Toute- fois, la jurisprudence fait preuve, là encore, d'une certaine souplesse, pour éviter d'alourdir ou d'affaiblir l'action administraîtve. Pour prendre un exemple récent, les textes relatifs à l'expropriation prévoient que si l'opération projetée comporte des travaux, l'estimation sommaire de leur coût doit figurer dans le dossier d'enquête; le Conseil d'Etat a néanmoins admis que, dans le cas de vastes opérations d'urbanisme qui nécessitent de longues études préalables, l'administration peut se borner à indiquer les dépenses prévues pour l'acqui- sition des terrains; elle est ainsi mise à même d'exproprier plus rapidement, sans attendre que la spéculation foncière fasse monter le prix des terrains, De même, sauf dans le cas de la consultation du Conseil d'Etat lui-même, l'ad- ministration a le droit d'apporter à son projet, après l'enquête publique ou la délibération de l'organisme consulté, certaines modifications, à uploads/s1/ france-2.pdf
Documents similaires






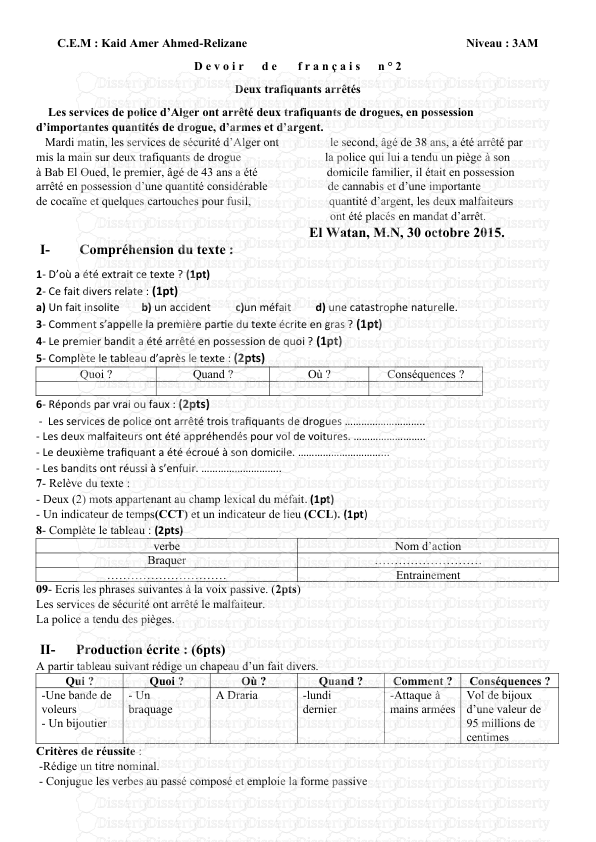



-
109
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 27, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.1589MB


